Dans le cadre de la préparation des expositions de l'enseignement primaire public, le Ministère de l'Instruction Publique demande aux instituteurs, à la fin du XIXe siècle, de rédiger une monographie de la ville dans laquelle ils exercent. Ainsi, pour la ville de Frouard, l'instituteur LAJEUNESSE réalise ce travail sur un cahier d'école de 115 pages. Pour les aider dans la rédaction de cette étude, un questionnaire type était fourni par le ministère. Voici la retranscription de la monographie de | 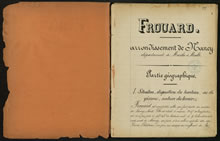 |
FROUARD.
Arrondissement de Nancy
Département de Meurthe-et-Moselle.
..Partie Géographique
|
Partie géographique
|
I. Situation, disposition du territoire, ses divisions, nature du terroir.
|
Frouard est une petite ville qui fait partie du canton de Nancy-Nord. Elle est située à environ 3° 47' de longitude est, et à peu près à 48° 45' de latitude nord ; à 9 kilomètres nord-nord-ouest de Nancy, au pied d'une colline appelée côte du Vieux-Château, un peu au-dessus du confluent de la [page 2] Meurthe et de la Moselle, à la bifurcation des lignes de chemin de fer de Paries-Avricourt et de Nancy-Metz ; sur le canal de la Marne au Rhin et la grande route nationale de Metz à Besançon, Son altitude est de 212 mètres 896, prise devant l'hôtel-de-ville.
….............Elle comprend deux parties : le bourg de Frouard, proprement dit, qui se trouve entièrement resserré entre la colline du Vieux-Château et le canal ; le faubourg, qui s'étend le long de la route nationale, depuis le pont de la Moselle jusqu'à la gare. La disposition générale de ses habitations est celle d'une ligne qui irait de l'Ouest à l'Est directement, puis d'une autre ligne, de longueur à peu près égale, qui se dirigerait vers le sud-est, se rattachant à la première par une courbe assez tendue.
….............Le territoire a pour limites : au Nord-Est et à l'Est une petite partie de la Moselle, puis la Meurthe qui le sépare du territoire de Custines ; au Sud-Est, la Meurthe encore qui le sépare du territoire de Bouxières-aux-Dames (en suivant l'ancien cours) ; au sud, le chemin de Bouxières à Nancy, le territoire de Champigneulles ; au Sud-Ouest et à l'Ouest, le territoire de Liverdun ; au Nord-Ouest et au Nord, la Moselle qui le sépare du ban de Pompey.
….............[page 3] La superficie totale est de 1280 ha. , dont près de la moitié (583 ha.) sont en forêts. La superficie occupée par les maisons, est, d'après les documents les plus récents de 3 ha. et demi.
….............La forme générale du territoire se rapproche assez de celle d'un triangle presque isocèle, dont la base serait au Sud, et le sommet un peu au-dessus de la Gueule d'Enfer (confluent de la Meurthe et de la Moselle). La partie située au Nord de la commune est très étranglée entre la Meurthe et la Moselle, et ne comprend qu'une grande prairie appelée la prairie de la « Gueule d'Enfer ». La limite à l'Est est assez irrégulière, vu qu'elle se confond avec le concours de la Meurthe qui forme là des sinuosités assez nombreuses et assez accentuées.
….............Une bonne moitié du territoire (la partie au Sud de la localité ) est située sur un plateau élevé de 358 mètres ; elle est occupée presque totalement par les bois communaux et les bois de l’État (forêt domaniale de Haye). Au centre de ce plateau , au milieu des bois, se trouve une grande clairière cultivée appartenant à la Commune, dite « portion des Rays » autrefois divisée en pâtis communaux partagés entre les habitants. Cette clairière existe depuis 1631. Cette année, les habitants de Frouard, (nous fait connaître un ancien titre déposé aux archives communales), donnent leurs reversales au duc de Lorraine, Charles IV, pour la permission qu'ils en ont obtenue, le 1er mai 1630, d'essarter 600 arpents de leurs bois communaux, [page 4] à charge de payer un gros de reconnaissance par arpent.
_ C'est à l'endroit où ce plateau avance au-dessus de Frouard, comme pour le dominer, que l'ont voit les ruines de l'ancien château. Si, partant de ce vieux château, on suivait le bord du plateau en allant vers les Sud-Est, on verrait qu'il est entaillé par une profonde échancrure , et , si arrivé là , on s'avançait dans le bois , on ne tarderait à se trouver au milieu d'une clairière existante depuis quelques années seulement : depuis la construction du fort. C'est là en effet que ce dernier se trouve. La pente qui conduit du plateau à la vallée est très rapide, surtout du côté du Vieux-Château et de la Moselle.
___________________Divisions___Terroir. ______ Le reste du territoire, compris dans les vallées de la Meurthe et de la Moselle, est en culture ou en prairie.
….............Les principales divisions du territoire de Frouard sont, au Nord, la section de la Gueule d'Enfer (prairie) ; à l'Est la section de l'Embanie, la section de Villers, la section du Bois des Garces ; au Sud-Est à l'Ouest, la section dite des Bois qui s'avance vers le centre ; au centre, la section du Village, celle de Liverdun, du Vieux-Château, de la Salle, du Haut-des-Plantes et celle des Rays.
….............Chaque section comprend à son tour plusieurs divisions appelées lieux dits. Ce sont, pour chaque section : [page 5]
....1° Gueule d'Enfer _ La Saussaie des Oies, la Gueule-d'Enfer proprement dites, le Ban-la-Dame, la Saussaie de l'Ilotte, le pré des Varayes, le pré des Chardons, la Saussaie Vaultrin, la Saussaie des Vaches. _______________ La prairie comprise dans cette section est d'un excellent rapport, excepté à l'endroit désigné « pré des Chardons » où des chardons, appelés vulgairement chardons d'âne, croissent en abondance et ne permettent que le pâturage. Ce qui contribue à sa fertilité, ce sont les débordements annuels, en hiver, des eaux de la Moselle et de la Meurthe qui, en se retirant, laissent un dépôt fertilisant.
....2° Embannie _ comprend les Bas Paquis, le Château de Frouard, derrière le Château, à la Grande Auberge, Devant la tuilerie, Pic Baré, en Combru, le Haut du Faubourg, l'Embannie proprement dite, le Reile de l'Embannie, Grande saussaie, l'Escargot et le Fait. _______________ Ici le terroir est d'un rapport moindre ; toutefois, en certains endroits, il y a des potagers excellents, principalement aux environs de la ferme. Le reste, qui comprend en grande partie des prairies, est formé par places de bas-fonds marécageux, les endroits qui ont pu être assainis sont assez fertiles.
....3° Villers _ comprend : aux Tanges, le Gué le Sureau, Villers proprement dit, le Clocher, le pré du Séminaire, pièce de Lonchère, le Reile de Villers, au-dessus des Tanges, Montant de la Côte Saint-Jean, à la Source, sous le Reile, au-dessus [page 6] du Reile de Villers, le Grand Pré, le Haut de Villers, sous les Terres, la Corvée Chaudron, le Boeuf Chauna, la Corvée du Boeuf Chauna, la Rouchotte, le pré Grieyr, le pont de Bouxières. ___________ Le rapport des terrains dans cette section est une moyenne. La surface cultivable est de beaucoup réduite du reste depuis l'établissement du canal de la Marne au Rhin, du canal de jonction de la Moselle à ce premier, des lignes de Chemin de fer, de la gare, de la Chaudronnerie, de la fonderie. La terre est compacte au lieu dit « à la Source » moins au lieu dit « le Boeuf Chauna ». Le reste en prairie est très frais, l'herbe qui y pousse renferme passablement de carex.
....4° Bois des Garces : comprend le Gouttier de Saint-Jean, au-dessus du courrier, près du Parc, Montant de la Penotte, sous le Parc, la Croix des Hussards, sous le Bois des Garces, Montant du Bois des Garces, Saule Gaillard, les Montants de Nerbevaux, la Vieille Pierre, corvée Milliant et le ruisseau de Nerbevaux. _________ Naguère encore, ces terrains, de valeurs médiocre, étaient couvert de broussailles. Ils sont remplis de rocaille, surtout vers le sommet et aux abords du parc. Le fond est d'une épaisseur très mince ; les céréales qui y croissent ont de petites tiges grèles qui dénotent le peu de fertilité de la terre qui les nourrit. [page 7]
....5° La Salle : comprend à la Croix de Mission, montant du ruisseau Pinotte, la Tuilerie, Derrière la Tuilerie, la Salle proprement dite, Montant de la Pinotte, la Haye du Bas, à la Ravage fosse des Bourguignons, montant de l'Aunoye, Montant derrière Saint-Jean, Corvée des Vaux, Haut du courrier, Montant de Raybois, Montant du Molmond , fond du Molmond, fond de Ratelot. ___________ Les terrains compris dans cette section sont des terrains de première qualité, les meilleurs de tout le territoire ; comme cette section est au-dessous du Faubourg, les habitantsy ont leurs potagers .
....6° Haut des Plantes : comprend : Patroce, les Simones, les Esquoelles, canton de la Croix, Fortes terres, les Bouchères, Chères-Vignes, Perhaye-les-Rayons, au-dessus des Terres, Saussenotte, Raybois, Jardins de Raybois, aux Croix, Chambre-haute, aux Mallaux, aux Bassas, les Cougots, Bajean, Hauts des Plantes, aux Haouï, les Grèves, Rapailles du Haut des Plantes. ________ Le haut des Plantes est rocheux, néanmoins il est excellent ; les céréales, les pommes de terre, les betteraves y croissent aisément. Il y a aussi des vignes ; celles « des grèves » particulièrement sont de bon rapport comme quantité et comme qualité.
....7° Vieux-Château : comprend : Vieux-Château proprement dit, sous le Vieux-Château, Montant le Vieux-Château, Pertuis, Hauts-Jardins, Fortes-Terres, en Deux-Vaux, aux Jaillets, aux Aubies, aux Braconnières, aux Louvières, aux Marquis, [page 8] aux Fleurettes, aux Landres, aux Poiriers, en Dédelle, aux Messelins, sous les Côtes, aux Côtes, Plantes Chandelées, les Vieux-Châteaux. _________ Une partie de la section est occupée par des broussailles aux environs des ruines du Vieux-Château ; beaucoup d'arbres fruitiers de bon rapport y croissent. Le versant exposé à l'Est et au Sud-Est de la colline de ce château est planté de vignes productives fournissant un bon vin ; de même dans le canton dit « du Perthuis » il y a aussi des vignes, mais de rapport moindre. Le terrain y est de bonne qualité ; c'est le meilleur terroir avec celui de « la Salle ».
....8° Les Bois : comprend : Bois communal, forêt domaniale de Haye (partie) dite de la Voiletriche, Bois particulier du parc ou Parc Lattier (au fort). ________ On sait que ces bois sont au sommet d'un plateau oolithique dont la terre, de quelques centimètres seulement d'épaisseur, repose sur une couche de rocaille qui, elle-même ; leurs racines ne s'enfoncent pas généralement bien avant dans la terre, mais en revanche elles s'étendent au loin dans toutes les directions.
....9° Rays : comprend : saison Notre-Dame, saison Saint-Jean. __________ Une partie de cette vaste clairière, au milieu de grands [page 9] bois, celle qui avoisine le Vieux-Château en longeant le bois à l'Est est en friche parce que le terrain (oolithique) est rocailleux ; la couche de terre a une épaisseur insignifiante ; c'est une terre rougeâtre reposant sur de la pierre. On a ouvert dans ces terrains incultes des carrières de moellons et de castine. Le reste peut-être classé comme étant très favorable à la culture ; ce seraient des terres de bien bonne qualité s'il y avait des engrais en suffisances.
....10° Section de Liverdun : comprend : Fond de Hardillon, au-dessous de Saint-Mitte, aux d'Emboulins, aux Longues, au Plafond, Saint-Mitte, Côte Mahaut, aux Dérochers-les-David, aux Fossés, Vieux-Château, aux Bouhauts, Beau-Séjour. _________ Toute la section est de bonne qualité, excepté « le fond de Hardillon », car les plantes qui y poussent ne reçoivent presque pas de soleil : une partie est située sur une côte abrupte, exposée au nord, l'autre se trouve constamment ombragée par les bois qui croissent sur l'autre versant très incliné également.
....11° La Ville : comprend : aux Faux-Murs, sous la Ville, Fort-Joly, Jardins du Cul Chaudé, Parc des Boeufs, aux Bouhauts, aux Voinesson, Derrière le moulin, Devant le Moulin, Hauts-Paquis, à la Côte du Moulin, au Jardin des Refuges, au-dessus des Paquis, Jardin Labarre, à la Côte du Paquis, Fortes-Terres, aux Hauts-Jardins. _________ [page 10] Ces terrains sont très bons ; situés aux alentours des habitations, la plupart sont des jardins, des potagers, quelques-uns des vignes. Beaucoup aussi sont occupés actuellement par l'emplacement de maisons qui ne figuraient pas en 1809 sur le plan cadastral : hôtel-de-Ville, écoles, casernes du moulin, bureau de poste et autres.
II. Notices sur les principaux lieux dits, accident géographiques.
|
….............Nous avons dit que la ville de Frouard était divisée en deux parties : la Ville proprement dite et le faubourg. La première est demeurée la même pendant longtemps, mais depuis la création des voies ferrées, du canal, l'installation des forges et de plusieurs usines, elle s'est agrandie d'un tiers.
Quoique beaucoup de maisons aient été restaurées, on distingue facilement la « ville vieille » de la « ville neuve » - si l'on peut s'exprimer ainsi. Dans cette dernière les maisons paraissent plus modernes, les rues sont plus larges. On y voit le nouvel Hôtel-de-Ville, comprenant les nouvelles écoles, et bâti en 1880.
….............Quant au faubourg, on peut dire qu'il est de fraîche date. En 1809, le plan cadastral n'y portait au plus que 8 maisons, existant encore, mais dont une a été [page 11] restaurée complètement. Actuellement, les maisons s'y touchent presque sur une longueur de près de 2 kilomètres et des deux côtés de la route ; cet accroissement presque subit doit être attribué principalement à l'établissement des hauts fourneaux et des forges de Frouard et de Pompey, village important, séparé du premier par le pont de la Moselle.
___ Ferme et château d'En-Bas. _________ Dans le faubourg on remarque une des premières maisons de son extrémité Nord : une ferme importante qui est portée sur les plans sous le nom de Château d'En-Bas. Construit en 1713 par le marquis de Lunati-Visconti, il appartient à M. le Comte O'Gormann, domicilié à Nancy. Ce nom de Château d'En-Bas nous semble maintenant assez peu mérité, car il n'a en rien l'aspect d'un château : c'est une vraie maison de ferme, avec ses bâtiments couverts de tuiles creuses. On y entre par une grande cour carrée au milieu de laquelle coule une fontaine ; à droite et à gauche sont les engrangements, les écuries, les hangars, les lieux de décharge et en avant, à droite, sont les corps de logis, dont la disposition et l'arrangement des pièces témoignent qu'elles ont été faites plutôt pour un fermier que pour un châtelain. _______ Il convient d'ajouter que ce que nous venons de décrire concerne seulement les restes de ce château, car il était plus vaste ; les autres parties ont été démolies totalement lors de la création de la ligne de Paris qui passe précisément[page 12] au milieu de son emplacement, ou ont été occupées par la construction de maisons particulières.
….............En ce qui concerne ce château, sous le rapport historique, nous n'avons pu recueillir que quelques notes éparses. Le 4 avril 1735 Paul Antoine d'Estherhazy et de Galantha, prince du Saint-Empire romain, « fait ses foi et hommage » à cause d'Anne Louise de Lunati-Visconti, sa femme, pour raison du marquisat de Frouard et de la terre et seigneurie de Clévant. Le 2 avril 1772, Louis Charles, comte de Chabot, lieutenant général des armées du roi, seigneur du Grand-Liers, de la terre et seigneurie du Ban-la-Dame (partie du territoire portant encore ce nom et qui se trouve comprise aux environs de ce château, dans la section de la « Gueule d'Enfer » auprès de la Moselle) séante à Frouard, des terres et seigneurie du dit Frouard, de Pompey, Marbache, et des deux Saizerais, fait ses reprises pour ces terres du roi de France. Le 3 avril 1781, Alexandre Louis de Lattier et de Bayane, fait ses foi et hommage pour la terre et seigneurie du « Ban-la-Dame » consistante en haute, moyenne et basse justice, deux châteaux, (celui-ci et le vieux château) maisons, parc, pourpris, jardins, basse-cour, droit de bergerie, de chasse, de pêche dans la rivière de Meurthe qu'il possède matrimonialement comme héritier du comte de Chabot.
….............En l'an III de la République (un document des archives nous l'apprend), le concierge du château déclare à l'agent[page 13] municipal qu'en son absence on a forcé les portes du dit château pour y établir un bal ; on a enlevé une serrure et fait disparaître la glace de l'une des salles. Les auteurs sont découverts et condamnés à une amende. _______ Le 22 ventôse, an VII , le marquis Alexandre Louis Lattier de Bayane intente une action en justice contre les habitants de Frouard et Pierre Parfait, agent municipal de la localité. Les habitants revendiquaient la possession des biens du « Citoyen Lattier » prétendant que ces biens lui avaient été transmis par l'effet de la puissance féodale ; qu'ils en avaient obtenu possession par jugement arbitral du 26 septembre 1793. Louis Lattier de Bayane, rappelant que ce jugement avait été annulé et cassé par le tribunal de Cassation le 14 fructidor an V, cita les habitants devant le tribunal pour se voir débouter de ler réclamation et condamner pour dégradations commises pendant qu'ils avaient joui de ses domaines. L'affaire s'arrangea amiablement de telle façon que le « citoyen Lattier » resta en possession des biens que la commune avait détenus, en renonçant à toute réclamation de dommages et intérêts. (Pour la suite des possesseurs, voir les propriétaires du Vieux-Château, partie Historique, page 89.)
___ Grande Auberge. _________ Presque en face de cette ferme se trouve une maison assez importante en étendue portée sur le plan cadastral sous le nom «Grande Auberge». Cette maison était en effet une vaste auberge, à l'époque où les voies [page 14] ferrées n'existaient pas à Frouard ; elle était un relais de poste pour les voitures, diligences, qui conduisaient les voyageurs de Nancy à Metz. Maintenant elle appartient à un horticulteur qui l'a un peu restaurée et qui a converti les nombreuses pièces qu'elle renfermait pour loger les voyageurs, en pièce à louer. D'après le dernier recensement de 1886, on a compté 12 ménages dans cette maison. Rien que son aspect actuel fait deviner à peu près ce qu'elle était à l'origine : auprès d'une place, sur la grande route de Metz à Besançon ; par devant est une vaste cour qui était abritée pour recevoir les voitures et dans laquelle on entre par deux grandes portes opposées et faites en pierre ; les pièces à l'intérieur sont construites à l'ancienne mode : gros piliers en bois, murs non unis et blanchis à la chaux, escaliers très hauts et grossiers, peu de symétrie dans la disposition des pièces. Les écuries pouvaient contenir 150 chevaux : elles ont été reconvertis en en corps de logis et sont louées présentement à des ouvriers. Au-dessus de la porte d'entrée de la cour était une enseigne en fer, faite par le célèbre Jean Lamour et déposée actuellement dans un musée de Paris. Au-dessus du petit mur du jardin, on voit encore une grille en fer, faite par cet artiste serrurier.
….............Nous n'avons pu savoir à quelle époque a été fondé ce relais de poste. Le propriétaire croit qu'il a été établi [page 15] en 1521 ; mais cette date n'a rien de fondé. S'il date réellement de 1521, il a dû être reconstruit presque totalement en 1713, époque du château de la ferme. Ce qui apparaît le prouver, ce sont les portes des engrangements semblables à celles de la ferme et les colonnes qui supportent le manteau de la cheminée dans l'une et l'autre maison. On sait que le marquis de Lunati-Visconti y logeait les piqueurs et les chevaux de ses amis qui venaient chasser dans ses propriétés. Aucun document des archives ne fait mention de ce relais.
….............Le propriétaire a trouvé, sous un escalier, une vierge en bois dans une grotte également en bois. La statue de la vierge n'est pas fixée ; les côtés de la grotte, représentés par des moulures qui forment colonnes , sont ornés de deux statuettes dont la partie inférieure du corps, à partir du creux de l'estomac, est remplacée par une sorte de sculpture imitant un feuillage. Le tout est assez bien travaillé et à dû se trouver sur la devanture de quelque porte de la « Grande-Auberge ».
___ Moulin. ___________ Il y a longtemps que Frouard possède un moulin : la date exacte de sa création est 1460. Comme toutes les usines de ce genre, il faisait partie du domaine ducal. Le 20 avril 1522 , le duc Antoine racheta des mains de Renault de Prény 15 francs de [page 16] rente qu'il prenait et lui étaient assignés en partie sur les moulins de Frouard. En 1588, ils étaient affermés, moyennant un cens de 400 francs par an. En 1643, ils étaient gérés par un sieur Didier Barrois dont la veuve reçut cette année 108 francs en considération de ce que son mari avait été enlevé par les Croattes au dit moulin et tué après lui avoir pris ce qu'il possédait de meilleur. _______ En 1758, ils furent aliénés sous un cens annuel de 930livres dont le rachat, autorisé par l'administration centrale, fut fait par Christophe Courtois pour 16.020 francs.
….............Depuis son établissement, le moulin avait été l'objet de bien des réparations nécessitées par les dégâts que causaient les inondations. Depuis 1492, on trouve presque chaque année des sommes payées par le Receveur, pour remettre en état les moulins à blé qui avaient eu à souffrir des débâcles des glaces. EN 1507, cette usine fut fort endommagée. En 1514, le 16 février, les glaces et les grandes eaux qui survinrent rompirent les vannes et on fut obligé de ré-fectionner le moulin. La terrible inondation de 1778, si connue sous le nom de déluge de la St Crépin, lui causa de graves avaries.
….............Le moulin, à l'heure présente, ne ressemble plus à ce qu'il était à cette époque ; le petit-fils de Christophe Courtois sus-nommé y fit des réparations et des agrandissements importants. [page 17] Sur une pierre posée dans un mur, on lit : « Cette pierre a été posée par Hyacinthe Courtois âgé de 12 ans, le 17 mai 1818. _______ Soli Deo Honore et gloria. Amen ». Il appartient à M.M. Marchal et Duhamel qui l'ont loué à M. M. Simon et Bouchotte après y avoir encore fait des améliorations.
….............Il compte 5 étages et deux corps de bâtiments ; l'un est le moulin proprement dit, l'autre est le magasin. Le canal de prise d'eau qui fait partie de la Moselle a une profondeur moyenne de 1m10 près du moulin. Pendant l’hiver de 1879-1880, les eaux, à cet endroit, ont atteint, le 1er janvier, une hauteur de 2m20, ce qui est beaucoup, l'inondation qui charriait aussi des glaces a causé des dégâts considérables dans la partie inférieure des bâtiments. _______ Dans ce moulin, le mouvement est produit par deux turbines d'une force de 60 chevaux chacune. En 1882, les 20 paires de meules ont été remplacées par 24 paires de cylindres pouvant moudre en moyenne 11.000 quintaux de blé par mois. Par suite de sa situation sur le bord de ma ligne de chemin de fer de Paris, cet établissement de meunerie, par une voie spéciale qui se détache de la principale, peut écouler facilement ses produits et s'approvisionner de blé aussi aisément. [page 18]
___ Collines. _____ Frouard, avons-nous dit, est placé au pied d'une colline, dite colline du Vieux-Château, qui tire son nom de l'ancien manoir seigneurial dominant jadis le village. Nous avons dit ce qu'il y avait à dire sur cette colline en parlant de la disposition du territoire ; nous en donnerons encore quelques détails en parlant de l'ancien château.
….............Une autre colline qui n'est séparée de la précédente que par une étroite et profonde vallée, ou plutôt une gorge, est la colline de Piedmont, dont le sommet est couronné par la forêt communale et les flancs livrés à la culture. Elle limite le territoire de Frouard et celui de Liverdun et court vers l'Ouest-Sud-Ouest. Dans son sein on a creusé plusieurs mines d'où l'on tire du minerai de fer qui alimente les fonderies de Liverdun. La Moselle coule au pied de cette colline.
___ Plateau. _____ La colline du Vieux-Château est une extrémité du plateau couvert par la forêt de Haye. Comme nous l'avons déjà fait remarquer, c'est sur ce plateau qu'est construit le fort ; sa limite est en face de la colline de Bouxières-aux-Dames. De ce point on découvre une vaste étendue de pays qui s'étend de la vallée de la Moselle, de l'autre côté Nord de Custines à Pixérécourt. L'horizon n'est pas très veste au nord et à l'Est, parce qu'il [page 19] est borné au nord, par les collines de Pompey, de Marbache, de Custines, à l'Est, par celle de Bouxières et au Sud-Est par la côte d'Amance et celle qui domine Pixérécourt, mais l'administration militaire sait le mettre à profit pour la surveillance des vallées de la Moselle, de la Mauchère (Rivière du canton de Nomeny qui se jette dans la Moselle à Custines), de l'Amezule (Rivière qui vient de Lay-St-Christophe et se jette dans la Meurthe un peu en amont du pont de Bouxières), et de la Meurthe.
--o--o--o--o--
III. Vallées
|
___ Vallée de la Moselle : ______ La vallée est assez resserrée entre la colline du Vieux-Château, sur la rive droite de la Moselle, et celle de l'Avant-Garde (territoire de Pompey) rive gauche ; elle devient plus spacieuse quand elle se confond avec celle de la Meurthe. C'est une des plus belles vallées durant la belle saison, pour s'en rendre compte il faut monter sur l'emplacement du Vieux-Château d'où on peut l'embrasser d'un seul coup d’œil. Les promeneurs nombreux en été, venant des environs et surtout de Nancy, s'accordent à dire qu'à cet endroit, c'est-à-dire sur le territoire de Frouard et de Pompey, la vallée de la Moselle offre un aspect des plus charmants et des plus grandioses : du côté de Liverdun, deux collines très approchées, abruptes, [page 20] formées à leur sommet de roches massifs que l'on aperçoit comme de vieilles murailles couvertes de bois dont la croissance laisse supposer qu'ils se trouvent dans un endroit favorable à leur développement ; sur le penchant de la colline, rive gauche, croissent la vigne et beaucoup d'arbres fruitiers ; le versant de la colline, rive droite, est livré à la culture des céréales, des arbres fruitiers, de la vigne qui y réussit très bien et des légumes ; tout cela offre pendant l'été une verdure de divers tons qui dénote la fertilité du terrain.
….............En avançant vers Pompey et Frouard, la vallée s'élargit un peu. De chaque côté on voit disposée chacune des deux communes précitées, d'aspect ancien, ayant chacune leur vieux château sur la colline qui les domine et au milieu des arbres qui ont un crû sur leur emplacement ou des plantes grimpantes qui soutiennent encore les restes des vieilles murailles ou des vieilles tours. Au fond de la vallée coule la Moselle, qui, avant d'alimenter le moulin se divise en plusieurs branches formant de petites îles converties en prés, en bosquets, ou en jardins, prenant ainsi une largeur double de celle qu'elle avait et qu'elle conserve jusqu'au près des forges de Pompey. Elle est côtoyée par la ligne de Paris et par le canal de la Marne au Rhin qui lui sont parallèles depuis un peu au-delà de Liverdun jusqu'au moulin de Frouard. [page 21]
___ Vallée de la Meurthe : ______ Alors la vallée se confond avec celle de la Meurthe. Prenons un peu celle-ci et nous reviendrons à celle que nous quittons.
….............Bien que moins belle, elle n'est pas dépourvue d'agréments ; elle est moins encaissée, d'aspect plus uniforme, pour ne pas dire monotone, en ce sens que les collines qui la limitent, moins hautes que les précédentes ne présentent sur leur versant que des terres livrées à la culture des céréales. Quelques points pittoresques contribuent à lui donner de l'attrait : le village de Bouxières-aux-Dames, très élevé, sur le sommet et le flanc d'une côte escarpée qui ferme la vallée de l'Amezule ; le château de Clévant, bâti en dessous de la forêt qui couvre le plateau sur la rive droite de la Meurthe, au milieu d'un bouquet d'arbres aux essences variées et dont le feuillage, variés pareillement, offre un joli coup d’œil en été. Le fond de la vallée, plus large que celui de la vallée de la Moselle, présente beaucoup d'analogie avec ce dernier là aussi se trouvent une rivière, la Meurthe, une ligne de chemin de fer et un canal, qui tous trois sont parallèles jusque bien avant sur le territoire, vers Champigneulles. Le faubourg de Frouard est dans la vallée de la Meurthe, et la ville dans celle de la Moselle.
___ Vallée de la Moselle (suite.) ______ Lorsque la vallée [page 22] de la Meurthe se confond avec celle de la Moselle, on a sous les yeux un beau paysage, surtout le matin, au soleil levant. De chaque côté de la vallée, des collines assez élevées : celles de Pompey, abruptes, couronnées de bois, en courbe assez pronocée se dirigeant vers Marbache ; celles de Custines, à la pente plus douce ; le sommet de celles qu encaissent la vallée de la Mauchère et enfin celles qui limitent à l'Est le territoire de Custines. Ces dernières sont très fertiles ; la culture des céréales et des prairies artificielles, vers le bas, y réussit très bien.
….............Dans le fond de la vallée on aperçoit comme deux rubans d'argent : l'un, d'un cours rectiligne, aux rives régulières ; c'est la Moselle ; l'autre, beaucoup sinueux, aux abords accidentés et garnis d'arbres ou de saules, échappe à la vue en certains endroits ; c'est la Meurthe, dont le cours disparaît caché par de petits ravins, pour reparaître plus loin. A un certain point les deux rubans se joignant pour n'en plus former qu'un : c'est là le confluent des deux rivières, appelé « Gueule d'Enfer »
….............Dans cette même vallée, bien en amont du confluent, entre le faubourg de Frouard et celui de Pompey, se trouve le canal de jonction de la Moselle au canal de la Marne-au-Rhin. Deux ponts assez proches l'un de l'autre sont bâtis sur la Moselle : l'un en pierre, qui fait partie de la route nationale, l'autre en aval, construit en fer [page 23] pour le passage de la ligne de Metz. Enfin, notons que cette vallée, aux environs et au-delà du confluent, es souvent enfumée par les gaz épais et abondants qui s'échappent des hauts-fourneaux et des forges de Pompey, construits sur la rive gauche, à 4 ou 500 mètres au-dessus de la « Gueule d'Enfer ».
___ Gueule d'Enfer : ______ Pourquoi ce nom de « Gueule d'Enfer » ? les antiquaires ne s'accordent pas sur l'origine de cette dénomination. Les uns prétendent que là existait un cimetière ; d'autres disent que les cadavres des martyrs qui accompagnaient St-Euchaire ont été ensevelis, ou plutôt jetés dans la rivière à cet endroit. D'autre enfin, et c'est à cette cause que les habitants des lieux attachent le plus d'importance et le plus de foi, prétendent qu'à l'époque des invasions barbares, plusieurs peuples, poursuivis, ont tenté de s'enfuir par la vallée de la Moselle, et on trouvé au confluent leur chemin barré, car il n'y avait pas de pont. Pressés, les uns se sont jetés à l'eau et y ont trouvé la mort ; les autres ont été massacrés par ceux qui les pourchassaient. L'origine de ce nom, donnée comme nous venons de le faire en dernier lieu, nous paraît la plus vraisemblable et celle qui paraît le mieux l'expliquer.
___ Vallées secondaires : ______ On remarque dans le territoire deux autres petites vallées. La 1ère appelée fond de St-Jean, du nom de l'ermitage qui se trouvait dans cette vallée, [page 24] et dont nous n'avons pu obtenir aucun renseignement, si ce n'est que sur un plan dressé en 1752, on voit porté « Ermitage St-Jean » auprès du ruisseau de ce nom et sur le bord de la grande route. Cette petite vallée au fond de laquelle coule le ruisseau St-Jean, est au pied du plateau sur lequel est bâti le fort ; elle est dominée par la batterie d'artillerie.
______ La deuxième, qui est plutôt une gorge profonde et étroite, est appelée « Fond de Hardillon » ; elle est couverte de bois et n'offre de particulier que ceci : en été les vipères y sont nombreuses et principalement sur le versant qui regarde le midi.
___ Etangs : ______ Il n'existe pas d'étang à Frouard, mais il y a quelques mortes, depuis l'établissement des voies ferrées de Paris à Metz. Tracées comme elles le sont, ces lignes eussent nécessité la construction de plusieurs ponts sur la Meurthe (de trois au moins) ; et comme le canal de la Marne-au-Rhin a été créé à la même époque en suivant la même direction, on a reconnu qu'il était plus avantageux de détourner le cours de la Meurthe que d'y construire des ponts.
….............Le cours actuel de la rivière est plus direct que l'ancien. Celui-ci, coupé par le canal de la Marne-au-Rhin, par le chemin de fer, le canal de jonction et la maçonnerie qui le sépare du nouveau cours, a formé quantité [page 25] mortes, dites « Mortes de l'Escargot » par allusion à la forme qu'affectait la rivière. Elles sont situées aux environs de la gare, vers la jonction des deux lignes de chemin de fer. Elles sont profondes par endroits, mais moins larges que l'était autrefois la rivière. Elles appartiennent en partie à M. Vigneron, officier retraité à Nancy. _______ Une autre petite morte ayant même origine que les précédentes est resserrée entre la voie verrée et le canal, sur le parcourt de Frouard à Champigneulles.
_____ Canaux. _____
___ 1° Canal de la Marne-au-Rhin. ______ Le canal de la Marne-au-Rhin entre sur le territoire au chemin dit « Chemin du faux Mur » en passant sous un pont. Il suit la ligne de Paris à laquelle il est parallèle, passe en-dessous des jardins du Fort-Joly, derrière le moulin, sous le pont du chemin qui conduit à Pompey ; fait une courbe légère, passe sur le côté de « la Grande-Auberge » sous le pont de la route nationale, après quoi il s'élargit pour former un port où se chargent et déchargent principalement des céréales, des bois, des moellons, des pierres de taille. Il suit le faubourg, à 100 mètres environ des habitations ; arrivé en face du ruisseau St-Jean, il reçoit l'embranchement, à gauche, du canal de jonction qui le relie à la Moselle. [page 26] Après avoir passé sous le pont de la « Rue de la Gare » il arrive derrière celle-ci en formant un nouveau port où d'habitude les bateliers font du chargement ou des déchargements de céréales, mais surtout de fonte provenant de la fonderie Montataire. Le canal continue à suivre la ligne du chemin de fer en passant sur un pont sous lequel est le chemin qui conduit à la fonderie. Parvenu au canton dit « la Rouchotte » où un ravin s'élève sur sa droite, il ressere entre sa gauche et la ligne ferrée l'ancien cours de la Meurthe. La ligne cesse de lui être parallèle : il va à peu près en ligne droite à Champigneulles, quittant le territoire un peu avant d'entrer dans cette localité.
….............Le navigation est très importante sur cette partie du canal ; son importance s'explique : 1° par le nombre des usines qui sont à Frouard même et aux environs, usines qui écoulent une partie de leurs produits, qui reçoivent leurs matières premières ou leur combustible par bateaux ; 2° par la jonction de ce canal avec la Moselle ; 3° par le voisinage d'une ville populeuse et commerçante comme Nancy. _______ Le canal a été creusé de 1846 à 1852, date qui est aussi celle de la construction du chemin de fer.
___ 2° Canal de jonction. ______ Il prend naissance dans la Moselle, derrière les forges de Pompey, [page 27] lieu dit « Pré des Varayes » à l'endroit même où autrefois la Moselle faisait, sur sa rive droite, une étroite languette d'eau, mais profondément avancée dans les terres. Il suit la Meurthe un instant en la côtoyant sur sa rive gauche dont il est séparé par un remblai de 8 mètres à peu près de haut. Il passe derrière l'emplacement du Château d'En-Bas, et jusqu'à l'écluse de Clévant il est profondément encaissé. Sorti de cette écluse, il est creusé dans un remblai de 5 ou 6 mètres de hauteur qui coupe l'ancien cours de la Meurthe en deux points, en dernier lieu avant de former le ort spacieux qui environne les bâtiments de la Chaudronnerie. C'est aussi à ce point même, à l'entrée du port, qu'il forme à droite une branche qui passe sous la ligne du chemin de fer, et, franchissant les « Ecluses accolées » il rejoint celui de la Marne-au-Rhin. La branche principale qui forme le port dont nous venons de parler, se resserre et finit à 50 mètres au-delà de la Chaudronnerie, auprès de la Fonderie.
….............Ce Canal est beaucoup hanté par les bateaux qui veulent aller de la Moselle au canal de la Marne-au-Rhin et réciproquement ; par ceux qui amènent du combustible aux usines qu'il dessert ou qui en emportent les produits. Il a été fait en 1876.
--o--o--o--o--
IV. Cours d'eau.
|
___ Moselle. ______ Quatre cours d'eau arrosent le territoire, [page 28] dont deux principaux qui lui servent de limite sur presque la totalité de leur cours : la Moselle, la Meurthe, le ruisseau de St Jean et celui de Nerbevaux.
….............La Moselle commence à arroser le territoire de Frouard, sur sa rive droite, en face du « Chemin du Faux-Mur ». A cet endroit elle a 160 mètres de largeur et 4 de profondeur. A certains moments de la journée, avant le lever du soleil, après son coucher, cette rivière se distingue à peines des prairies qui l'avoisinent ; très tranquille, elle forme une grande nappe d'eau qui ressemble à un vaste miroir et qui reflète la verdure des bois, des collines de l'Avant-Garde (rive gauche) ; verdure qui se confond avec celle des prés d'autant mieux que le lit est peu encaissé et les eaux bien limpides.
….............Plus bas, la Moselle se divise en deux branches qui, en se réunissant un peu plus loin, forment une grande île plantée d'arbres présentant cette particularité qu'ils sont tous penchés sensiblement et sous un angle à peu près égal du côté du courant des eaux, inclinaison qu'ils reçoivent, depuis qu'ils sont plantés, par la force de l'eau quand elle déborde. L'eau est retenue, pour couler dans la branche de droite, qui est le canal du moulin, par une vanne qui part de la pointe de l'île pour aller rejoindre la rive gauche en obliquant fortement : la [page 29] branche de gauche n'est que le déversoir du trop-plein du canal.
….............Cette vanne a été enlevée entièrement, il y a quelque 30 ans, par de grandes eaux telles qu'on n'en avait vu de pareilles depuis longtemps ; le courant ayant eu prise dans les terrains de gauche taillé, à l'extrémité de la vanne, une échancrure qui a détruit à cette place la régularité de l'île. La construction de la nouvelle vanne, faite plus solidement, à nécessité de grosses dépenses de la part des propriétaires du moulin. On a d'abord planté des pilotis ferrés à leur extrémité inférieure, et seulement m'a élevé la maçonnerie.
….............L'île, qu'entourent ces bras de la Moselle, qui était coupée autrefois par un petit courant qui a été supprimé depuis que l'on a muré le côté gauche du canal du moulin. Ce canal se divise lui-même en deux branches, autrefois en trois : la principale alimente les turbines, l'autre n'est qu'un déversoir qui rejoint le bras principal. Ce dernier forme lui-même en recevant le canal d'alimentation une grande île en amont du pont, île en pré, rongée lentement par un courant très rapide. Derrière le moulin, la distance entre les deux rives est de 240 mètres. La Moselle passe alors sous le grand pont de pierre.
….............En aval de ce pont, la rivière enferme encore dans deux branches une île assez grande qui a subi plusieurs transformations dues, les unes à l'empiétement de l'eau, les [page 30] autres aux mains des hommes au moment de l'établissement du grand pont de fer de la ligne de Metz. Sa rive gauche est très régulière et fortement encaissée surtout depuis que les hauts-fourneaux de Pompey déposent leurs scories sur les bords. Avant la création du canal de jonction, la rivière formait une languette qui revenait en arrière sur sa rive droite ; on avait maçonné cette espèce d'isthme ; on a continué la maçonnerie ce qui fait de ce golfe étroit une lagune.
….............L'île appelée « Pré des Varayes » subsiste encore, mais elle est réduite.
….............A partir de là la rivière a été canalisée ; [page 31] les rives sont tirées au cordeau : la rive droite est taillée à pic dans un terrain complètement sablonneux, la rive gauche, élevées de 3 ou 4 mètres au-dessus des eaux, est murée. Derrière les forges, sur la rive droite, on voyait autrefois au lieu dit « saussaie Vaultrin » une grande île formée par une sorte de déchirure de cette rive ; un bras se détachait de la branche-mère pour s'enfoncer profondément dans la prairie de la « Gueule d'Enfer » et venait s'y réunir à environ 300 mètres plus bas. Depuis la canalisation de la rivière les lieux ont changé d'aspect : cette déchirure ne communique plus à la Moselle que par sa partie inférieure ; l'endroit où elle commençait a été maçonnée ; des terres coupent son cours en son milieu, ce qui a donné naissance à une nouvelle lagune. La rive droite et la rive gauche de la branche principale sont murées ; la première sert à maintenir les terres et fait vanne. Un barrage retient les eaux de la branche mère parce qu'à partir de ce lieu elle ne sera plus canalisée : ses eaux alimenteront un canal qui, prenant sur sa gauche, suit la ligne de Metz et rejoint la Moselle un peu en amont de Marbache ; il a pour but d'éviter le long détour que va faire la Moselle qui se dirige sur Custines.
….............De ce barrage au confluent, la rivière est plus large, le courant rapide et la profondeur de 2m50 en moyenne, le lit est très encaissé, les rives un peu rongées par l'eau, celle de gauche très élevée, cachée par les saules. [page 32]
….............Au confluent elle a une largeur de 50 mètres (la Meurthe, 37 mètres) et de 115 environ après avoir reçu don affluent. Les deux courants sont loin d'avoir la même vitesse : la Meurthe paraît paisible et la Moselle semble s'élancer pour emporter les eaux de celle qui va grossir les siennes. Ces deux courants, de vitesse inégale, en se rencontrant sous un angle de 60 degrés font un tourbillon et un remous qui fait remonter l'eau dans l'ouverture de l'angle en y creusant un golfe peu large, mais avancé dans les terres. Ces terres sont formées en grande partie de sable, de gravier et d'un peu de limon, où croissent des herbes impropres à la nourriture des bestiaux et des orties de 2 mètres au moins de hauteur.
….............Lorsqu'elle a reçu la Meurthe elle s'élargit ; elle creuse un vrai golfe sur la rive droite, peu élevée par rapport à la rive opposée sur la rive droite, peu élevée par rapport à la rive opposée qui est aussi fortement minée par les eaux. Après avoir repris une direction nouvelle vers le nord, elle quitte le territoire pour s'engager sur celui de Custines, après un parcours de 3 km 900 sur celui de Frouard et avec une largeur de 95 mètres.
….............Sa largeur moyenne est de 120 mètres et la moyenne de sa profondeur, 2m50. Son courant est rapide au-dessous du moulin jusqu'au pont de fer où ses eaux ressentent déjà la résistance que leur oppose le barrage. [page 33] De l'autre côté de cet obstacle, elle reprend la vitesse qu'elle avait. Ses eaux sont limpides ; quelle que soit la profondeur, on voit le fond du lit, pourvu que les eaux soient à leur état normal. Leur limpidité tranche nettement au confluent avec les eaux impures de la Meurthe.
….............Les inondations ont causé de grands ravages au moulin, maintenant, avec la nouvelle direction que les propriétaires ont donnée aux eaux, ces crues ne sont plus à craindre, excepté dans les temps des débâcles de glaçons.
….............Les îles en amont et en aval du pont subissent chacune d'elles une transformation lente il est vrai, mais réelle, particulièrement les îles en aval, car les eaux passant sous les arches du pont qui les emprisonnent un instant, en sortent sous forme de courants, de tourbillons, dont la fureur se déchaîne sur ces îlots.
….............Les eaux de la Moselle et de la Meurthe, sortant de leur lit, se joignent dans toute la prairie de la « Gueule d'Enfer » , présentent une immense nappe jaune qui va du pont de fer jusqu'au-delà du confluent, c'est-à-dire sur une longueur de plus d'un kilomètre et demi et une largeur de 700 mètres. En se retirant dans leur lit, elles laissent un dépôt terreux et sableux qui fertilise les prés qu'elles couvraient et remplissent d'eau les bas-fonds nombreux répandus sur toute la surface de la section. Puis le [page 34] fond du lit a changé : l'an dernier il y avait un trou à telle place ; cette année il sera comblé, tandis que où l'on prenait pied, il y aura 3 mètres et plus de profondeur.
___ Meurthe. ______ La Meurthe commence à couler sur le territoire auprès du pont de Bouxières-aux-Dames , où elle faisait autrefois sur sa ligne droite deux pointes qui n'existent plus ; par contre, si elle s'est retirée de la droite, à 100 mètres plus bas elle s'est rejetée vers la gauche dont la rive est peu à peu rongée par ses eaux qui viennent, aux époques des grandes pluies, fouetter avec force contre cette rive très élevée.
….............Plus bas la rive droite est à peu près régulière et peu élevée, tandis qu'à gauche, en suivant le « pré Grieyr » elle n'est pas bien déterminée. Autrefois elle formait une languette qui avançait beaucoup dans ce pré ; actuellement cette languette est à sec et ne communique plus à la rivière par suite des apports successifs des eaux qui ont bouché la communication au détriment des parties en dessus qui sont fortement endommagées. Les propriétaires riverains de gauche ont fait une maçonnerie à l'endroit où la rivière fait un coude très prononcé vers le Nord pour mettre fin à cette anticipation des eaux sur leurs prés.
….............Jusqu'alors la Meurthe a suivi une [page 35] ligne presque droite vers l'Ouest en pente rapide qui donne à ses eaux une assez grande vitesse. A cet endroit elle formait un coude brusque en se dirigeant vers le Nord. Ses eaux, changées subitement de direction, avaient, par leur relux, formé à gauche une sorte de golfe très étendu. Quand on a créé le chemin de fer et le canal, on a coupé la rivière à ce coude même, ce qui a un peu rendu son cours plus direct ; on a établi un mur pour empêcher l’empiétement des eaux sur le remblai de la voie, ce qui n'aurait pas tardé, vu la rapidité du courant et le peu de consistance des terres du remblai.
L'ancien cours, compris entre le canal et la ligne, forme une morte qui peut communiquer avec le nouveau cours au moyen d'un petit aqueduc.
….............Jusque derrière la fonderie ; la Meurthe va en ligne droite vers le Nord-Nord-Ouest. Son lit est en général peu profond, les rives peu élevées, à peu près régulières et cachées par les saules, particulièrement la rive gauche ; mais en face du dépôt de scories des hauts-fourneaux, dépôt fait sur le bord de la Meurthe, les rives ont été modifiées lentement : la rivière s'est éloignée de sa rive gauche primitive pour se rejeter sur sa rive opposée ; des saules qui étaient jadis baignés sur celle-là, sont à 3 mètres environ de ce bord, au milieu des eaux. Cette rive droite [page 36] est rongée par le courant qui mine toujours plus profondément à l'époque des inondations. Le rejet des eaux de droite est peut-être causé par cet amoncellement des crasses de la fonderie qui forment muraille ; au moment des débordements, l'eau sortant du lit ne peut s'étendre librement à gauche ; refoulée sur la droite elle tourbillonne en désagrégeant les terres.
….............Derrière la fonderie la rivière est encaissée par des rives élevées. Un peu plus bas on a établi une passerelle en fer dont la pile du milieu est bâti dans le cours d'eau qui a là 50 centimètres de profondeur. Elle est réservée exclusivement au passage des wagonnets qui vont chercher le minerai de la mine de Bouxières pour le conduire à l'usine.
….............Avant l'existence du chemin de fer, la rivière abandonnait la direction qu'elle avait pour faire un long circuit vers l'Ouest, désigné sous le nom de « l'escargot ». La Meurthe a maintenant un cours redressé ; elle va directement de cette passerelle au lieu dit « Saussaie des Vaches ». Son ancien cours, coupé en différents endroits par la ligne ferrée et le canal de jonction, a donné des mortes. (Voir : Etangs, page 24). Quelques-unes sont à sec ; d'autres communiquent encore avec la rivière ou reçoivent le trop plein du canal ; toutes sont couvertes par des roseaux et par [page 37] des saules qui y croissent abondamment. L'ancien lit à sec permet de connaître la profondeur de la rivière à cette place, profondeur insignifiante ; rive droite élevée, rive gauche très basse, fond couvert de cailloux et de gravier.
….............A l'endroit où le nouveau cours rejoint l'ancien on a construit un mur qui ne permet aux eaux des mortes de se mélanger avec celles de la Meurthe que par un petit aqueduc.
….............A quelques dizaines de mètres plus bas, sur sa rive droite, la rivière forme trois petits golfes qui sont encore autant de mortes quand les eaux deviennent basses. La rivière est très profonde aux environs ; sa rive droite, plus bas, est très élevée. A partir de là le cours d'eau devient bien plus large ; sa rive droite après avoir été si élevée est à peine de quelques décimètres au-dessus des eaux ordinaires ; sa rive gauche a dû subir une transformation lente : il y a près de 10 mètres entre le ravin qui formait rive et le bord des eaux ; cet espace est couvert d'arbres qui cachent sous leurs branches des bas-fonds se remplissant à chaque débordement.
….............Sur la rive droite, un peu plus bas que cette saussaie enfoncée et marécageuse, longue de 50 à 60 mètres, un petit chemin descend de la route qui conduit de Custines à Bouxières et aboutit à la rivière : c'est un gué pour les voitures, gué employé exclusivement par les fermiers du [page 38] château de Clévant pour la rentrée des récoltes qu'ils ont sur le ban de Frouard, mais il peut être utilisé que lorsque les eaux sont basses, le courant étant très rapide. Ce gué paraît cependant, par le chemin qui y conduit, avoir été beaucoup plus fréquenté autrefois : y a-t-il eu un bac à cette place ? Si oui, c'est peut-être de ce bac qu'il est parlé dans l'acte par lequel Jean Gillet de Liverdun, châtelain de Maizières-sur-Madon, vendait le 29 mars 1453 aux chanoinesses de Bouxières le tiers du passage au bac de Frouard pour la somme de 100 francs.
….............La rivière fait alors un coude brusque vers l'avant. C'est à ce coude que l'on peut remarquer la même transformation que celle que nous avons déjà remarquée en amont de la fonderie, mais dans un sens contraire : au lieu d'anticiper sur la rive droite, la rive avance sur la gauche, l'eau mine en-dessous et, quand elle s'élève, elle emporte le morceau qu'elle a désagrégé peu à peu, tandis que la rive droite, dont elle s'éloigne, se couvre d'herbe.
….............Dès lors la rivière sera peu encaissé sur sa rive droite, fortement sur l'autre. C'est arrivée au point où elle reprend une direction vers le Nord-Est, lieu dit « Pic Barré » que se trouve le bac actuel pour le passage des [page 39] piétons. _______ La rivière est très peu profonde, presque à sec, un peu plus bas et encore sur son parcours tant qu'elle longe le canal de jonction : elle est murée de ce côté , afin de parer à l'action des eaux.
….............Le plan de 1809 indique une île au milieu de la rivière, en amont du canton de la « Saussaie des Vaches ». Cette île n'existe plus, la branche de la Meurthe qui était à gauche est devenue une morte par suite de la maçonnerie qui la sépare de la branche droite ; l'ancienne île est couverte de hautes herbes et de saules. En aval de cet endroit, la Meurthe à 3m.50 à 4 mètres de profondeur qu'elle conserve jusqu'un peu au-dessus de la « Saussaie de Ilotte » entre des rives qui l'encaissent bien, mais qui se sont rapprochées l'une de l'autre.
….............A la « Saussais de l'Ilotte », le cours d'eau paraît être barré à droite par un ravin de 5 à 6 mètres de hauteur ; il reprend une nouvelle marche directe au Nord qu'il conservera jusqu'à son confluent tout en étant bien encaissé, d'une profondeur de 1 mètre, à peu près, sur une longueur de 200 mètres, bordé de quelques saules atteignant parfois une grande hauteur. _______ Un peu au-dessus du confluent, la rivière en mordant la rive gauche l'a taillée à pic avec d'autant plus de facilité que les bords sont sablonneux : on peut constater que le lit s'élargit petit à petit. Enfin, elle arrive au confluent après un parcours de [page 40] 5 kilomètres 700 mètres sur notre territoire (excepté aux places où elle a été déviée, son nouveau cours à ces endroits sur le territoire voisin) et de 7 kilomètres 400, autrefois, sur une largeur moyenne de 58 mètres, une profondeur moyenne de 1m.10, une pente assez rapide, surtout de Bouxières à son entrée dans la prairie de la « Gueule d'Enfer ».
….............Son fond est couvert de cailloux et de gravier. Autrefois, on utilisait beaucoup son cours pour le flottage, maintenant il est rare d'y voir passer des flottes. De même elle était navigable de Nancy à Frouard, à l'heure présente la navigation est abandonnée depuis la création du canal ; cette navigation était du reste très difficile, car le fond du lit est très irrégulier, très mouvant et par place, en été, il n'y a au plus que 30 centimètres d'eau.
….............L'eau de la Meurthe est tout à fait impure, quelle que soit l'époque de l'année elle est noirâtre comme si elle coulait sur un fond de marais. Elle a été limpide, mais, depuis que des usines de toutes sortes se sont élevées sur son cours, elle s'est corrompu, elle charrie des malpropretés repoussantes qui s'arrêtent parfois sur les bords et y séjournent. Heureusement que des débordements assez fréquents emmènent au loin ces dépôts ; nous disons fréquents, car une pluie qui tombe quelques jours suffit pour élever le niveau de ses eaux : en hiver il y a déjà [page 41] longtemps que la meurthe a débordé quand la Moselle commence à monter.
….............Les grandes eaux n'ont d'autre effet sur cette rivière que de miner peu à peu les rives à quelques endroits ; de laisser, où elle fait des courbes, des cailloux sur les prés qu'elle submerge, mais qu'elle fertilise aussi en y laissant des terres d'alluvion ; de remplir les mortes qui avoisinent la rivière d'une eau nouvelle ainsi que les bas-fonds qui se trouvent le long de son cours. La prairie qu 'elle arrose de Bouxières à son confluent est littéralement couverte d'eau ; de très loin on aperçoit le pont de Bouxières qui tranche si bien sur les eaux, qu'on en peut voir le nombre des arches.
Ruisseau de Saint-Jean . _______ Ce ruisseau prend sa source dans la section de « la Salle », lieu dit « Corvée des Vaux ». Son eau pure coule dans un petit fossé où les ménagères du quartier vont laver. Rencontrant la route nationale, il la suit un instant et la traverse sous un aqueduc d'où on le voyait se répandre dans la prairie dite au « Fait » et se jeter dans la Meurthe avant la construction du canal. Mais sorti de l'aqueduc, il entre sous un autre, passant ainsi sous le canal, et se jette un peu plus loin dans une morte de la Meurthe après un parcours de quelque 660 mètres.
Ruisseau de Nerbevaux . ________ Prend sa source au sud de la section du « Bois des Garces » lieu dit [page 42] « Entre la Corvée Milliant et le ruisseau de Nerbevaux » ; descend en ligne droite sur la route nationale qu'il traverse sous un aqueduc, acquiert une pente rapide, suit un instant le canal en remontant vers Champigneulles, passe sous le canal et verse ses eaux dans une morte de l'ancienne Meurthe, lieu dit « la Rouchotte » après 400 mètres de parcours. Il est à sec une moitié de l'année.
______ Ponts. _____
….............Sur le territoire de Frouard, la Meurthe n'a d'autre pont que la passerelle dont nous avons parlé ; (page-36-), au service de l'usine. Sur la Moselle il y a deux ponts distants l'un de l'autre de 280 mètres, l'un en pierre, l'autre en fer.
...____ Pont en pierre. ____ Il fait suite à la route nationale et unit Frouard à Pompey : sa longueur de 175 mètres est formée de 7 arches, sa largeur est la même que celle de la route. C'est un beau pont qui, disait-on, rappelle celui de Neuilly. _______ Avant sa création, comment passait-on la rivière ? Occasion de faire l'historique des ponts qui se sont élevés successivement à cette place.
….............En 1619, le duc Henri, afin de prévenir les abus qui se commettaient au préjudice des passants par le fermier du bac de Frouard, avait publié un règlement qui fixait les droits qu'il lui était permis de prélever. Ce règlement, [page 43] applicable à tous les bacs existants sur les rivières fut renouvelé par Charles IV le 11 juillet 1628 et il fut enjoint aux fermiers de s'y conformer, à peine de prison et de 200 francs d'amende.
….............Ce document nous montre qu'il n'existait pas de pont sur la Moselle à Frouard et qu'on était obligé d'y passer la rivière à l'aide d'un bac appartenant au domaine ducal et affermé à son profit. Le premier pont fut sans doute construit au commencement du XVIIIe siècle, lorsque Léopold s'appliqua à rendre plus praticables qu'elles ne l'étaient jusqu'alors les routes de ses Etats : mais la terrible inondations de 1778 le ruina à peu près complètement. Il était construit à environ 30 mètres en aval de celui qui existe, dans la direction de l'ancienne route ; on en voit encore les ruines sur la droite de la Moselle. Les murailles en pierre de taille et gros moellons qui supportaient sa première arche sont encore debout ; la place de la chaussée est désagrégée par les grandes eaux ; quelques unes de ses piles devaient reposer sur les îles qui sont au milieu de la rivière.
….............En attendant qu'on put en bâtir un nouveau, on en construisit un en bois, sur lequel en vertu d'un arrêt du Conseil d'Etat du 22 novembre 1778, il était perçu en droit de péage.
….............L'adjudication du pont en pierre fut passée en 1781 au profit d'un nommé Honoré François, pour 308.000 livres, cours de France. Les plans et devis furent [page 44] rédigés par Le Creulx, ingénieur en chef des ponts et chaussées de la Généralité de Lorraine.
...____ Pont en fer. ____ L'autre pont, en fer, placé en aval du précédent est aussi très bien fait : il compte 4 arches très élevées au-dessus des eaux. Sur la couronne qui forme la partie supérieure de ses arches, on lit : MDCCCXLVII – André au Val-d'Osne. On sait qu'il appartient à la ligne de Metz.
V. Particularités météorologiques.
|
….............Frouard est exposé aux vents de l'hiver. Les vents du Nord et du Nord-Est y sont rendus d'autant plus froids qu'ils s'y abattent après être sortis de deux vallées très étroites : celle de la Moselle au Nord et celle de la Mauchère au Nord-Est. Venus comme resserrés, ils s'étendent dans la vallée pour se resserrer de nouveau entre les collines du vieux château, de Piedmont, d'un côté, et celles de Pompey de l'autre et suivre la vallée de la Moselle pour s'abattre sur Liverdun. Frouard est donc placé sur le trajet d'un courant d'air froid. Quant aux vents chauds du Sud-Ouest, ils s'y font rarement sentir, parce que la colline du Vieux-Château leur barre le passage ou plutôt les détourne de leur direction.
….............Mais la particularité météorologique la plus frappante est celle que l'on observe fréquemment en été et [page 45] tous les ans. Il arrive qu'après de nombreux jours de chaleur on voit à la fin paraître à l'horizon de gros nuages noirs qui promettent une pluie bienfaisante dont la terre à temps besoin ; on entend le tonnerre gronder dans le lointain, puis les nuages vont se rapprochant et déjà les premiers vont s'élever au-dessus de Frouard. Malgré ces signes précurseurs, il arrive souvent que l'on a peu de pluie et quelquefois pas du tout : l'orage a été détourné de la direction qu'il allait suivre par la colline du Vieux-Château qui l'a rejeté sur Nancy ou Saizerais ; ou bien encore, elle l'a coupé en deux parties qui vont, chacune d'elles, sur ces localités. Cependant, si l'orage, après s'être massé, si je puis m'exprimer ainsi, a franchi cette barrière qui s'oppose à son passage, il éclate avec fureur : ce n'est plus qu'éclairs et coups de tonnerre très secs, comme des coups de fouet ; une pluie torrentielle, souvent accompagnée de grêle, il abîme les récoltes au lieu de féconder la terre. Les rues de la ville et celles du faubourg sont en peu de temps couvertes d'eau. Aussi les habitants de Frouard redoutent-ils ces orages qui, après avoir longtemps tourné, finissent par surmonter la côte.
….............L'orage du mois d'août 1886 qui a causé tant de dégâts à Nancy et sur bien d'autres points de la France, a laissé dans notre commune un souvenir qui ne s'échappera jamais de la mémoire de ceux qui en ont été témoins : les éclairs se succédaient sans interruption ainsi que les coups de tonnerre, le vent soufflait avec violence ; une sonnerie électrique située à [page 46] l'hôtel-de-ville carillonnait comme si à instants précipités on avait fait passer un courant sur le fil. Dans la forêt, des chênes quasi séculaires, aux dimensions colossales, ont été renversés complètement, enlevant avec leurs racines une couche de terrain de 12 à 15 mètres carrés sur une épaisseur de 40 centimètres.
VI . Statistique de la population.
|
….............Frouard n'a pas toujours été une petite ville. Il a été d'abord un village, puis un bourg qui a été réduit à certaines époques à un chiffre d'habitants des plus minimes. Au XVIIe siècle il est déjà dénommé avec le titre de bourg. C'est dans ces temps qu'il fut réduit considérablement par suite des guerres. Une requête adressée par les commissaires délégués des habitants de Frouard, à la Chambre des Comptes, en 1632, nous apprend que le 24 juin de cette année les armées du roi de France venant de Liverdun s'étaient campées dans les blés, les avoines et les orges de Frouard, de Pompey et de Champigneulles ; ces céréales servirent de pâture aux chevaux ou de litière, si bien, que d'après cette requête, dans 300 jours de terre on ne devait pas faire une gerbe de récolte. Les soldats vivaient à discrétion dans les habitations, sur le dos du peuple ; les fourrages étaient consommés par les chevaux et l'ouvrage des champs [page 47] ne se faisait pas. A leur départ, les greniers étaient vides ; les foins piétinés par les troupes furent livrés à la pâture et les habitants se virent dans le dénuement le plus complet.
….............La peste, apportée par les gens de guerre, ne fit qu'accroître les maux ; le duc de Lorraine, par compassion, fit l'aumône de 40 réseaux de blé. En 1633 une nouvelle plainte des habitants leur fait obtenir la quittance de l'aide St Rémy, montant à la somme de 316 francs et 8 gros.
….............Dans les années suivantes, la misère ne fit que s'étendre. En 1640, le Receveur des Domaines dit, dans son rapport « qu'il n'a pu faire de recettes, tant le peuple est pauvre ; et qu'au lieu de 120 bourgeois, il n'en reste que 5 ou 6 tous pauvres » ; les autres ont quitté la localité tant la misère y était grande. Le rapport de 1641 nous dit que le cens de Frouard s'élevant à 38 francs n'a pu être payé et que les terres sont abandonnées et en friches. La dépopulation fut telle qu'en 1661, Frouard ne comptait plus que 6 ménages. Et il en était de même dans les villages environnants.
….............En 1708 il y avait 90 habitants dont plusieurs pauvres et même mendiants.
….........En 1792 il y avait 670 habitants.
…....En l'an VIII _______ 759 ________
….........En 1836 _______ 852 ________
….........__ 1841 _______ 898 ________ [page 48]
….........__ 1846 _______ 886 ________
….........__ 1851 _______ 1005 _______
….........__ 1856 _______ 984 ________
….........__ 1861 ________1203 _______
….........__ 1866 _______ 1576 _______
….........__ 1872 _______ 1654 _______
….........__ 1877 _______ 2771 _______
….........__ 1882 _______ 3391 _______
….........__ 1886 _______ 3121 _______
….............On voit qu'en 1851 le chiffre de la population s'élève de beaucoup : il faut attribuer cet accroissement à l'établissement des voies ferrées et du canal.
….............En 1861 le chiffre s'élève de de nouveau par suite de l'installation des forges de Frouard et de l'ouverture des mines. En 1877 il augmente encore par suite de l'annexion, et antérieurement à cette date, d'autres industries s'installent ou prennent de l'extension : Boulonnerie – Chaudronnerie – Moulins – mines – forges de Pompey.
….............Cet accroissement de population, cette concentration d'ouvriers d'usines avaient nécessité pour le maintien du bon ordre dans la commune et celles avoisinantes, la création d'une brigade de gendarmerie qui s'est établie à Frouard en 1864 et qui existe encore. En 1886, le chiffre des habitants faiblit un peu par suite du chômage dans beaucoup [page 49] d'usines, arrêt qui force plusieurs familles à quitter le pays pour aller chercher de l'ouvrage ailleurs. La population est un peu remontée, par suite de la reprise du travail et l'installation de nouvelles industries.
…...............Statistique établie d'après les actes de l'Etat-Civil.
….De 1802 à 1813 ____il y a eu 288 naissances, 58 mariages et 251 décès
____ 1813 à 1822 __________ 231 _________ 62 __________ 196 ____
____ 1823 à 1833 __________ 252 _________ 72 __________ 206 ____
____ 1833 à 1843 __________ 244 _________ 65 __________ 210 ____
____ 1843 à 1853 __________ 302 _________ 92 __________ 271 ____
____ 1853 à 1863 __________ 404 _________ 95 __________ 418 ____
____ 1863 à 1873 __________ 519 _________ 113 _________ 447 ____
____ 1873 à 1883 __________ 976 _________ 201 _________ 693 ____
____ 1883 à 1888 (en 5 ans)__ 517 _________ 119 _________ 376 ____
….......En 1886, la population se répartissant ainsi :
.Population agricole …..............228 |
| |
Force publique ….........305 |
VII. Mœurs, constitutions physique des habitants.
|
….............A Frouard, comme partout ailleurs, se trouvent des [page 50] hommes robustes et d'autres à la santé débile ; on peut dire que la majeure partie des habitants jouit d'une assez bonne santé. Néanmoins, on n'y rencontre pas les forces, les vives couleurs, ces visages sur lesquels ont lit la vigueur et qui sont le partage des habitants de nos campagnes. La population agricole offre à peu près le même type que celui de nos villages, mais la population industrielle diffère.
….............D 'abord celle-ci est constamment dans les usines, exposée la plupart du temps à une température très élevée , respirant un air plus ou moins vicié, mais jamais pur ; travaillant une semaine pendant le jour et la semaine suivante pendant la nuit, quelque fois la nuit et le jour ; habitant des logements trop petits pour une nombreuse famille parfois, et des logements où l'hygiène n'est pas connue et encore moins suivie : tout cela ne suffit-il pas pour compromettre la santé ?
….............Quand les ouvriers reviennent du travail, ils sont noirs de fumée ; lavés, il ont la figure pâle, jaunâtre, ou bronzée. Il y en a qui ont le visage osseux, les yeux tachés de rouge ; il semblerait que quelques-uns ont les joues coloriées avec du carmin : ceux-là sont exposés à l'ardeur des fours à puddler. Ils se couchent de bonne heure, leurs jambes se raidissent et il est rare de le voir arriver à un âge avancé.
….............Leurs enfants se ressentent de cette constitution [page 51] affaiblie : il en est qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans même et auxquels on ne donnerait que 7 ou 8 ans , tant ils sont petits, frêles et peu rigoureux ; ils sont très souvent malades, indisposés.
….............Dès qu'ils quittent l'école, ces enfants embrassent ordinairement la même profession que le père ; ils entrent dans une usine ou un atelier de la localité. Lorsqu'ils y ont passé une année, leur physique s'est changé ; le travail de l'atelier a déjà commencé son œuvre de transformation chez ces adultes qui ne tardent pas à avoir une mine et des allures comme celles de leurs devanciers.
….............On ne peut en faire un reproche à quelques-uns, à beaucoup même ; c'est déjà bien triste pour eux qu'ils usent leur santé et leurs forces à une âge tendre, dans les usines et pour le bien de l'humanité ! Mais il est de ces ouvriers qui perdent leur santé trop vite et par leur faute : ce sont ceux qui perdent leur santé trop vite et par leur faute : ce sont ceux qui, à la fatigue du travail, joignent l'abus du tabac , de la cigarette principalement : abus qu'ils commettent depuis leur apprentissage et même avant. Ajoutons à ces malheureux fumeurs les individus passionnés pour les boissons alcooliques !
….............Comme nous l'avons dit, beaucoup de ces ouvriers sont logés à l'étroit, d'autant plus que d'habitude ils n'ont guère moins de 3 enfants ; plusieurs même ont une famille nombreuse. Les logements et les vivres sont chers, le gain, dans la crise industrielle de cette heure, n'est pas bien important et les [page 52] arrêts en hiver sont fréquents. Dans bien des ménages la nourriture est plus ou moins suffisante et principalement plus ou moins saine, eh bien ! Malgré cette pénurie, bon nombre d'individus laissent dans les cabarets l'argent qui ferait tant de bien à leur famille.
….............La population peut se diviser en 3 catégories : la première comprendrait les vrais habitants, ceux qui demeurent à Frouard depuis plusieurs générations ; la 2°, les employés, commerçants, etc, qui sont venus s'y établir ; la 3°, la population industrielle, la plus nombreuse, originaire en partie des pays annexés. Cette dernière, venue d'un peu partout, a apporté avec des mœurs plus ou moins bonnes, des coutumes plus ou moins saines et un langage plus ou moins correct et plus ou moins convenable, en sorte que la petite ville de Frouard n'est pas renommée pour avoir des mœurs bien honnêtes. Ce qui contribue encore à ce trop de laisser-aller dans les paroles et les actes de la population ouvrière, et ce qui le perpétuera encore longtemps, malgré l'éducation que l'on s'efforce continuellement de développer, c'est l'obligation imposée à la jeune fille d'aller gagner à la ville voisine de quoi augmenter le gain journalier du père et des frères. Elle y récolte un peu d'argent, il est vrai, mais en retour, et triste retour ! Elle acquiert dans le chemin qu'elle fait de chez elle à son atelier, dans son atelier même, des [page 53] mœurs peu enviables, qu'elle ne pourra que transmettre à ses enfants, car on ne peut donner à quelqu'un que ce que l'on possède et on ne peut lui enseigner que ce que l'on sait.
….............Une chose facile à remarquer parmi ces ouvriers, c'est leur humeur belliqueuse ; pour un rien, ils passent vite des injures aux coups. Il est rare de voir une fête ou une réunion quelconque sans qu'il y ait quelque rixe. En revanche, il faut dire que cette humeur n'exempte pas chez eux la bonté de caractère et surtout l'amour patriotique. La majorité nous a prouvé qu'en cas d'alerte ils seraient prêts.
….............Nous ajouterons que depuis que la presse peut parvenir dans tous les foyers, tous ces ouvriers suivent au jour le jour la marche des affaires du pays. Jusqu'alors on n'a pas encore entendu circuler dans leurs conversations ces utopies dangereuses des socialistes ; un ou deux se sont laissés perdre par ces théories fausses, mais les autres ne font que rire des cris et des plaintes qu'ils entendent pousser contre la propriété et ceux qui la détiennent. Ils souffrent avec patience la crise qu'ils traversent avec l'industrie.
….............Il est difficile de faire une distinction entre le caractère de la classe ouvrière des usines et celui de la population originaire de Frouard, parce que celle-ci a à peu près acquis les habitudes de la première dont le chiffre lui est de beaucoup supérieur. Ses mœurs ne sont pas plus pures, [page 54] mais cependant elle commet moins d’excès. Elle n'est pas très franche et se qui lui fait surtout défaut, c'est l'esprit de solidarité : il existe chez elle un courant de jalousie qui lui fait regarder d'un mauvais œil le voisin qui acquiert de l'aisance ou qui s'élève un peu.
….............En résumé : constitution physique en dessous de la moyenne par suite du travail dans les usines et des excès ; mœurs légères, esprit querelleur, un peu jaloux et avec cela bon fond de caractère, dévouement pour la patrie, intérêt aux affaires du pays, éloignement des chimères du socialisme et courage dans les temps d'épreuve, voilà ce que l'on peut remarquer parmi la population de Frouard.
_______ Statistique scolaire. __________
….............Les archives communales font mention de l'instituteur depuis la fin du XVIIe siècle ; elles nous font voir dans quelles conditions il exerçait alors ses fonctions de « maître d'école » (jamais on n'employait le mot Instituteur). Dans les pièces qui précèdent et suivent de quelques années la Révolution , on le désigne sous le nom de « régent d'école ». Jusque un peu avant le milieu de notre siècle, les anciens registres des délibérations du Conseil municipal relatent les conditions dans lesquelles il était admis dans la localité, conditions qui [page 55] n'avaient pas changé depuis le premier traité que nous avons pu trouver.
….............Un registre porte, à la date du 15 septembre 1810, un de ces traités entre la municipalité et l'instituteur. L'aspirant doit être muni avant tout de « certificats de bonne conduite, mœurs et capacités confirmés par son Excellence, le grand-maître de l'Université impériale » ; avant d'entrer en fonctions « il doit avoir obtenu du prêtre le suffrage pour les objets du culte et les suffrages du Maire et des Conseillers. »
….............Les anciennes écoles, affectées maintenant à des logements de particuliers, étaient en face de l'église. Jusqu'en 1822 les enfants des deux sexes étaient réunis dans la même salle. A cette date l'école des filles fut séparée. En 1847, création de l'asile.
….............Nous n'avons pu donner que les chiffres suivants, parce qu'une partie des archives scolaires est disparue.
Élèves inscrits au registre matricule. [page 56]
____ Garçons ____ |
___ Filles __ |
___ Asile ___ . . . . . . . . . . . . . . . Enfants des 2 sexes . . ___ 140 ____ ___ 195 ____ ___ 155 ____ ___ 184 ____ ___ 180 ____ |
….............Si on se reporte à la statistique de la population (page 46.) on voit que le chiffre de la population augmente sensiblement après 1860 et avec lui doit s'élever celui de la population scolaire. En 1864 le premier poste d'adjoint à l'instituteur est crée. En 1868 création du premier emploi d'institutrice-adjointe. Tous ces nouveaux emplois et l'accroissement [page 57] du nombre des enfants dans les écoles ont nécessité leur agrandissement. En 1873, sur une demande du Conseil municipal, en date du 4 décembre 1872, un deuxième poste d'adjoint est créé, et sur une autre demande du 16 novembre 1873 est installée une deuxième adjointe. Les locaux scolaires sont insuffisants pour contenir la jeunesse : une classe pour les garçons, tenue par un adjoint, est installée dans la maison commune.
….............Les années suivantes nouvelle progression, nombre de maîtres et de maîtresses insuffisant et impossibilité de l'augmenter faute de local. C'est alors que les anciennes écoles sont abandonnées et que les enfants reçoivent l'instruction dans le nouveau groupe scolaire, bâti en 1880, faisant partie de l'Hôtel-de-Ville et très spacieux. Par décision ministérielle du 11 avril 1881, le troisième poste d'adjoint est créé.
….............En 1882 les écoles de filles et l'asile qui étaient tenus par des congréganistes sont laïcisés ; le 29 septembre le personnel qui y enseignait est remplacé. Enfin, une décision ministérielle en date du 22 novembre 1882 approuve la création d'un quatrième poste d'adjoint à l'école de garçons, d'un troisième d'adjointe à l'école de filles et d'un poste de sous-directrice d'école maternelle avec maintien d'une aide. Telle est encore la composition du personnel enseignant : directeur, directrice, adjoints et adjointes [page 58] ont chacun leur classe.
….............Ajoutons que la fonderie de Frouard a une école libre tenue par deux congréganistes et comptant environ 30 élèves.
Liste des instituteurs qui se sont suivis à Frouard depuis 1678 :
Chapeau Joseph.......1678-1682. |
Tannier Joseph........... 1789-1792 . |
Directeur actuel : Lajeunesse Emile Justin (depuis 1886)
….............A la suite de cette statistique disons que les ouvriers, pères de famille, apprécient les bienfaits de l'instruction ; les indifférents sous ce rapport ne sont pas nombreux. Il s'en trouve encore une certaine partie qui sont dépourvus [page 59] de connaissances ; ressentant leur infériorité, ils ne voudraient pas que leurs enfants fussent privés comme ils le sont des connaissances que l'on répand maintenant dans nos écoles. Parmi les élèves qui manquent les classes, quelques-uns n'ont aucun motifs sérieux ; mais les autres sont empêchés par des causes vraiment dignes d'intérêts ; les uns appartiennent à une nombreuse famille et sont obligés de temps à autre de rester au logis pour garder le dernier né pendant que la mère vaque aux soins du ménage ; les autres aident leur mère indisposée, malade, pendant que le père et les aînés travaillent à l'usine.
VIII. Etat des terres
|
….............Le territoire , non compris le bois, est cultivé partout, excepté à l'entrée de la section dite « des Rays » qui reste en friches ; là il n'y a qu'une mince couche de terre de quelques centimètres d'épaisseur qui repose sur un sol rocheux tout à fait ingrat. Ce lieu ne demeure pas complètement improductif : il s'y trouve une carrière de pierres d'où l'on retire des moellons, de la castine employée pour l'empierrement des routes et beaucoup pour les routes stratégiques qui sillonnent la forêt communale.
….............Le seul engrais employé est le fumier. L'assolement est triennal. La surface du territoire se divise comme il suit : [pages 60]
Terres labourables ….... 277 Ha 86.. |
Terres vaines ….......... 1 Ha 87.. |
IX. Culture de toutes pièces, leur importance dans l'alimentation.
|
….............La culture comprend celle des céréales : blé, seigle, avoine, orge. Ceux qui les cultivent récoltent pour le besoin de leur famille ; s'il ont un surplus, ils le vendent, soit au moulin de Frouard, soit au marché de Nancy ou aux quelques habitants de passage : marchands forains, bateliers, voituriers. Une bonne partie des terres avoisinant la localité et même assez distantes sont livrées à la culture des légumes ; elles renferment beaucoup d'arbres fruitiers. La récolte des fruits et des légumes est employée par les particuliers pour leurs besoins ; quelques-uns livrent ce qu'ils ont de trop aux fruitiers de la localité ou emportent ces denrées de bon matin au marché de Nancy.
….............Quant aux vignes, elles sont loin de produire depuis plusieurs années à leur propriétaires de quoi [page 61] compenser leurs travaux ; ils retiennent donc pour eux le fruit de leur récolte, ou s'ils le vendent, c'est pour s'imposer l'eau comme breuvage.
….............Ainsi donc les diverses cultures ne fournissent guère que pour les besoins de la population industrielle et commerciale, et même ne suffisent pas. Cela se comprend, puisque la population agricole ne représente guère que le dixième des deux autres . __ C'est justement pour suppléer à cette insuffisance de production que le Conseil municipal a obtenu autrefois, sur sa demande, l'autorisation de créer dans la localité un marché qui se tenait les mardis et les vendredis. Depuis plusieurs années ce marché n'a plus lieu. Des marchands vont chercher les denrées à Nancy ou dans les villages environnants et en crient la vente dans les rues.
X. Poissons et gibier.
|
….............La Moselle et la Meurthe à Frouard sont poissonneuses, moins cependant qu'elles l'ont été. De vrais pêcheurs, il y en a quelques-uns, mais des pêcheurs d'occasion, des pêcheurs qui font de la pêche un passe-temps en même temps qu'un moyen de trouver de quoi se rassasier pour un repas, il y en a beaucoup. Dès l'ouverture, on voit un grand nombre d'individus, d'ouvriers des usines surtout, stationner sur le bord du canal ou de [page 62] l'une des rivières, ou encore le long du grand pont de la Moselle, avec une ligne ou deux et y passer des heures entières, des journées même à attendre, comme le héron, qu'ils aient pris de quoi régaler leur famille. Nous avons dit que les ouvriers travaillaient quelquefois les nuits : en effet, dans les forges et les fonderies ils ont à tour de rôle leur semaine de nuit. Ce sont ceux qui sont de nuit, qui, revenus de leur besogne dès six heures du matin, prennent sur les heures d'un repos bien mérité un temps plus ou moins long pour se livrer au plaisir qu'ils trouvent dans la pêche à la ligne. Pour être juste, il faut dire que ce n'est pas uniquement par plaisir, mais en vue de faire durer plus longtemps la bande de lard.
….............Nous allons donner la liste des poissons, petits et grands, qui peuplent les deux rivières du territoire.
___ Petits poissons. ___ Moutoile, poisson très gluant, difficile à saisir à la main, _ têtards - épinglé, couvert d'arêtes très aïgues, se tient dans les marais (Epinoche, nom en français.) _ le véron _ bandoise _ boulange, resemble ressemble à la rousse, plus petite, nageoires plus courtes et d'un rouge vif.
___ Autres poissons. ___ Goujon, _ ablette _ rousse _ brême _ bouxet, devient jaune en vieillissant, prend les petits vers qui sont collés après les cailloux. _ perche _ [page 63] barbot (barbeau) menace de disparaître de nos rivières ; en toute saison, mais en été principalement on le trouve rempli d'abcès internes _ la chive (ou chiffe) se plaît à frapper contre les pierres, tanche _ carpe _lotte _ truite _ brochet_ saumon, qui est devenu plus rare. _ perce-pierre, se colle après les pierres _ anguille.
___Gibier. ___ Comme partout ailleurs, les chasseurs de Frouard sont ceux qui n'ont pas trop de besogne à faire et qui ont à peu près leur vie gagnée. Il n'y a pas de chasseurs qui chassent pour vendre le produit qu'ils retirent de cette occupation.
….............Le pays est assez giboyeux et c'est facile à comprendre quand la moitié d'un territoire est occupée par des bois et que ces derniers tiennent à une des principales forêts de France (forêt de Haye).
….............Le gibier que l'on chasse comprend : le chevreuil, très rare ; le sanglier, assez rare, le blaireau, le renard, très commun ; le hérisson qui est assez répandu ; le loup, la fouine, le chat sauvage, l'écureuil, beaucoup la belette, le lapin de garenne qui se tient principalement dans les bois de Liverdun, le lièvre. A l'occasion, et sans être chasseur, on détruit les vipères, assez communes sur le territoire et dans certains endroits en particulier. Les couleuvres subissent le même sort que les vipères. Au premier coup d’œil elles ont de la ressemblance, on s'inquiète fort peu si leurs actions ressemblent à celles de vipères : avant que le [page 64] jugement n'ait parlé, la sentence de mort est exécutée.
...............____________________________
...............Fin de la partie géographique
--o--o--o--o--
Partie historique et archéologique
|
Commune de Frouard, 3121 habitants,
Noms anciens : Froardum, Froardi-arx, Froardidunum, Frowart, Frouart.
….............Il nous est impossible de donner l'étymologie du nom de Frouard. Sur les archives communales du XIVe siècle, nous l'avons trouvé orthographié : Frowart, puis vers la fin du XVe : Frouart. Frouardum, tel est son nom inscrit sur les armoiries que l'on a trouvées en enlevant une croix de pierre en 1883, érigée sur la place de la ville, et qui se trouve actuellement dans la cours du musée lorrain. De quelle date ces armoiries ? C'est ce que nous ne pourrions nous même préciser. On constate que les armoiries de Lorraine , n'étaient pas encore fixées au XIIe siècle et qu'elles [page 65] changeaient avec les ducs. Sur l'écu de Lorraine, sous Ferri I, on distinguait sur la bande transversale de l'écusson les trois alérions qui sont sur les armoiries de Frouard. On les retrouve également sur un sceau de Frédéric II qui est au Trésor des Chartes de Lorraine, et sur l'écu de Thiébaut 1er fils de Ferry II ; ce qui nous porterait à croire qu'elles datent de vers cette époque, et particulièrement de Ferri II qui a fait bâtir l'ancien château. Dans les armoiries de Frouard il y a une crosse qui traverse la bande transversale.
….............Nous ne savons rien de précis sur l'origine de la commune. Il n'en est fait mention que dans des titres du XIe siècle, mais rarement. On en parle un peu plus souvent à partir du milieu du XIIe. Quoique l'on n'en parle pas dans des titres antérieurs, il est à présumer qu'elle remonte à une date beaucoup plus éloignée, car elle jouissait déjà, comme nous le ferons voir plus loin, d'une certaine importance quand il en est question pour la première fois.
….............En 1206 le duc Ferri donna à l'abbaye de Bouxières la vaine pâture sur les bans de Champigneulles et de Frouard. ______ Avant cette date, vers la fin du XIe siècle, nous apprend un titre des archives communales ayant un rapport à une contestation d'origine de propriété entre les habitants de Frouard et ceux de Liverdun, Mathieu de Lorraine reçoit de Thiébaut son aîné, avec lequel il était brouillé, la [page 66] forteresse de Frouard (voir les propriétaires du château page - ). En 1267, le même Ferry et Gilles de Sorcy, évêque de Toul, règlent l’entre cours des habitants de Nancy, Frouard et Liverdun. Le 22 janvier 1296, Philippe-le-Bel mande aux baillis et officiers, gardes des foires de Champagne et de Brie, de laisser trafiquer les bourgeois de Frouard par tout le royaume, en marchandises permises et défendues, en payant les droits. ______ Ces mentions indiquent qu'à cette époque Frouard était déjà considéré. Affranchi en 1255.
….............En 1594, Frouard est signalé comme étant prévôté et châtellenie du baillage de Nancy. En 1751 ; baillage, maîtrise et généralité de Nancy, coutume de Lorraine. En 1790, chef lieu de canton, district de Nancy. En l'an VIII, le 26 messidor, les municipalités cantonales, sont rétablies : le canton de Frouard est aboli et cette commune est rattachée au canton-Nord de Nancy.
XI. Monuments Gallo-Romains
|
Route. _____ Après la conquête de la Gaule, César s'occupa d'y tracer des voies nombreuses. Elles se divisaient en 2 catégories : les voies militaires et les voies communes. Des premières, il en est fait mention dans les annales que nous a [page 67] laissés Jules César ainsi que ses successeurs. Quant aux dernières, l'existence ne nous en a été révélée qu'après les patientes recherches des antiquaires. La route nationale actuelle n°57, de Metz à Besançon et qui traverse le faubourg de Frouard dans toute sa longueur, faisait partie de ce réseau de seconde catégorie. Elle allait de Metz à Bâle : elle entrait dans la Première Belgique près des sources de la Moselle, passait aux environs de Remiremont , d'Arches, d'Épinal, de Châtel, entrait dans notre département, et après avoir suivi sur un certain parcours et à quelque distance la rive gauche de la Meurthe, elle venait rejoindre à Scarponne la grande voie militaire de Trèves à Metz.
….............Cette voie était coupée par la Moselle sur laquelle il n'y avait pas de pont et que l'on passait à l'aide d'un bac. On a un peu changé sa direction sur une longueur de quelques centaines de mètres lors de la construction du pont en pierre bâti à environ 40 ou 50 mètres en amont du gué.
_____ Tombes, poterie et autres objets _____
….............L'ancien cimetière était, comme tout les cimetières des villages, en général, autour de l'église ; mais depuis près de 10 ans on en a établi un autre, plus vaste, en dehors de la localité, sur le côté du chemin de Liverdun, à l'endroit appelé « aux d'Emboulins » presque au pied de [page 68] la colline du Vieux-Château. En creusant la terre, dans une grande partie du cimetière, la bêche du fossoyeur rencontre journellement des tombes qui datent d'une époque très reculée. Elles se composent d'un lit de pierre posées à plat pour le fond, et de pierres plates mises de champ pour les côtés ; parfois les pierres des côtés n'ont aucune forme : ce sont des moellons alignés tout simplement ; les sépultures sont habituellement à 50 centimètres de profondeur. Dans chaque tombe il y a une urne cinéraire en terre grise qui renferme soit des grains de collier en verroterie ou en ambre, des boucles d'oreilles. On recueille dans quelques-unes soit des boucles de ceinturon, des débris de brides de chevaux, des fibules ; quelquefois il y a aux côtés des lances ou des couteaux. Dans certaine urnes on a trouvé des cendres mêlées de terre : le musée de l'école en possède une. Ou il y a eu un cimetière à cet endroit, ou l'on est en présence d'un lieu de sépulture des cadavres de ceux qui ont laissé leur vie dans un combat aux environs, peut-être sur le penchant de la colline. _____ On a aussi trouvé, sans que nous puissions préciser l'endroit, une sorte de couronne plate en cuivre à laquelle sont suspendues à la partie supérieure deux autres couronnes plus petites, mais semblables et pouvant, en se balançant, frapper entre elles et contre la grande. Le tout était destiné à faire du bruit [page 69] et devait se suspendre aux harnais d'un cheval. Cette sonnaille, non pas d'un genre nouveau, mais bien antique, est au Musée lorrain.
XII. Monuments du Moyen-âge de la Renaissance et des temps modernes
|
______ Eglise. ______
….............L'église de Frouard date du XVIe siècle. Bien que l’extérieur, qui cependant a déjà été restauré plusieurs fois, fait deviner qu'elle remonte à une date assez reculée. Elle a été bâtie en 1534. On ne connaît aucun titre authentique de sa fondation ; cette date de 1534 a toujours été inscrite à la partie supérieure de la voûte, vers le milieu de la nef, sur une pierre ronde à laquelle aboutissent des arcs en ogive. Elle est dédiée à St Jean-Baptiste qui est représenté auprès des fonds baptismaux, baptisant le Christ. Elle est assez vaste. La nef comporte environ de 20 à 22 mètres de longueur sur 14 à 15 de largeur, y compris les bas-côtés. Le chœur a à peu près, de l'entrée à l'abside 10 mètres, sur une largeur, en entrant, de 6 mètres.
____ Voûte. ____ La voûte est portée par des piliers. Les deux premiers au fond de la nef, vers le chœur, sont plus gros que les autres parce qu'autrefois ils portaient la tour avant la construction [page 70] de celle qui existe. Ces piliers sont réunis par des arcs aigus. De même la voûte appartient au style ogival du XVIe siècle ; partout, du reste, dans tous les sens, on aperçoit que des arcs aigus, que le style ogival, parfois imité. Les fermes ne sont pas apparentes à l'intérieur.
____ Fenêtres. ____ Les fenêtres des bas-côtés sont encore ce qu'elles étaient jadis. Elles se composent d'abord d'une ouverture carrée, surmontée d'un arc aigu et partagée en deux par une colonne de pierre ou meneau. La partie comprise dans l'arc supérieur, c'est-à-dire dans le cintre de la baie, offre un réseau d'ogives percées à jour, supportant une couronne en pierre. A la partie supérieure de la nef, dans le mur élevé au-dessus des bas-côtés et des piliers se trouvent de chaque côté deux fenêtres, aussi larges que les précédentes, mais moins hautes. La première vers le chœur ne ressemble pas complètement à celles que nous venons de décrire. Au lieu d'une couronne supportée part les ogives du cintre de la baie, il y a comme deux cœurs renversés et accolés vers leur pointe. Cette partie se rapprocherait en quelque sorte du style tertiaire ou flamboyant du XVIe siècle. Ces fenêtres sont toutes munies d'un grillage pour mettre les vitraux à l'abri des accidents. Les grillages des fenêtres du chœur et de l'avant chœur paraissent très anciens ; il est permis de croire que ce sont les premiers qui y ont été posés. [page 71]
….............Les vitraux des fenêtres de la nef sont modernes, nous ne savons pas s'il en existe encore d'anciens, car ils ont été tous récemment mis en peinture. Ceux du chœur et du transept sont de fraîche date : ils proviennent de dons faits en 1887 par quelques habitants de la paroisse.
….............Le maître-autel est riche par sa décoration : il est surmonté de pyramides ogivales lancéolées, portant bien le caractère du XVIe siècle, mais ne datant cependant que de 1841.
____Portes. ____ La première porte d'entrée de l'église, celle qui s'ouvre sous le porche, est cintrée. Les jambages de la porte qui se composent de pierres de taille tenues dans le mur de la tour, supportent un chapiteau composé d'un talon renversé, d'un bandeau et d'un cavet à filet supérieur. Le cintre de la porte comprend cinq voussoirs figurant archivolte : en son milieu il porte une sorte de clé de voûte imitée, formée de moulures. Les deux vantaux de la porte proviennent de l'ancienne. Aucun décor, aucune trace se sculpture ; dans chacun d'eux, vers le bas, est scellée une tête de lion en cuivre tenant dans sa gueule un anneau du même métal. Ces portes commencent à céder sous le long usage qu'elles ont déjà fait.
______ Porche. ______ Le porche, pierre que l'on trouve en ouvrant les portes ci-dessus est carré ; il a 3m30 de côté ; son [page 72] plafond est horizontal. Les pavés ont été remplacés en partie par des neufs lors de sa construction ; les autres proviennent des démolitions de l'ancien pavé sous la tour primitive et sont bien bien plus usés. De chaque côté de la porte de la nef, une plaque en marbre est scellée dans le mur ; sur l'une d'elles est indiquée la date de construction de la tour (1832) sous quel ministère pastoral (curé Georges) et sous quelle administration (Courtois, maire et son Conseil M.M...). L'autre porte la date de la pose de la première pierre ; 24 septembre 1832, le nom du maire, de l'adjoint, de l'architecte départemental (Châtelain), des entrepreneurs (Bernard et Leroux). Dessous chacune d'elles sont les bénitiers. Ils ont la forme d'une coquille en cuivre très évasée, et sont tenus dans le mur par des filets de cuivre entrecroisés, formant une croix composée de dessins géométriques à jour. Nous ignorons s'ils sont anciens.
….............La porte d'entrée de la nef est toute simple : sa partie supérieure est en arc légèrement surbaissé.
….............Dans l'église il n'y a aucune statue antique. Les stalles qui sont à l'abside paraissent anciennes ; elles sont tout à fait massives.
______ Tombe. ______ Dans l'allée du bas-côté de gauche, auprès de l'escalier de la chaire à prêcher, il y a une pierre tumulaire qui a environ 2 mètres de [page 73]longueur, avec inscription. Nous n'avons pu relever que les caractères qui ont été épargnés par l'usure : D.O.M. Sous cette tombe repose le corps de feu le Sr ? ….. Carpentier, prêtre demeurant à Vigneules …... ? curé est mort le 25 ….. 1745 âgé de 35 ans (ou 39) …... ? il a demandé à être inhumé …..... ? le Sr Nicolas son père …... ? le 3 juillet ….. ? âgé de ….. ? ….... Le reste est indéchiffrable.
______ Fonts baptismaux. ______ Les fonts baptismaux, placés dans un coin de la nef, à gauche, en entrant, ont été achetés en 1822. On y voit, taillé dans la pierre, le baptême de Jésus-Christ par St Jean-Baptiste ; la pierre est scellée dans le mur. Elle est surmontée de décors, en pierre également, appartenant au style gothique, mais imité. De chaque côté de ce tableau est une statue surmontée d'amortissements en forme de pyramides ogivales. Le pavé paraît ancien : un morceau de fer qui est resté dans l'un deux porte à supposer que ce n'est pas là son premier usage. Le bassin des fonts baptismaux appartient à une date assez proche de nous ; il est en pierre , posé sur une sorte de colonne formant piédestal de 50 centimètres de hauteur. Ils ont été achetés au moyen d'une subvention accordée par le ministère. Le tout est entouré d'une grille en fer. Nous terminerons cette description en disant que le tableau représentant le baptême est très bien fait.
….............L'extérieur de l'église lui donne un aspect [page 74] antique, lourd, disgracieux. La toiture en tuiles, l'extrémité des charpentes qui se fait voir à certains endroits, le crépi tombé par place, laissant paraître une vieille maçonnerie, l'extérieur des fenêtres des bas-côtés et de celles qui sont placées à la partie supérieure de chaque côte de la nef, au dessus du toit qui couvre les nefs latérales ; les grilles qui protègent celles du transept et celles du chœur ; les contreforts nombreux qui entourent l'église pour en soutenir les murs, tout cela contribue à exciter la curiosité de l'amateur des vieilles constructions.
….............En entrant, on a un tableau bien différent. Sans doute, un connaisseur, au premier coup d’œil, reconnaîtra l'époque de la fondation de ce sanctuaire, par les piliers, les ogives, les fenêtres ; mais celui qui ignore ces détails d'architecture se laissera aller immédiatement et tout entier à la contemplation de la décoration qui orne toutes les parties. En 1887, en effet, à l'aide de quêtes, de dons particuliers et d'offrandes généreuses faite par M. Trouillet, le prêtre desservant la paroisse a fait remettre en peinture tout l'intérieur. Grâce au talent et ua bon goût de l'artiste M. Pierron à Nancy, cette vieille église ressemble maintenant à une magnifique petite cathédrale. Nous en sortons en jetant un coup d’œil sur le bel orgue acquis en 1835 et placé dans la tribune [page 75] construite en 1832.
….............Nous avons trouvé dans un ouvrage de M. Lepage que Mme des Porcelets de Malhianne, dame du Château, avait fondé une chapelle et que cette chapelle avait été transférée à l'autel St Claude dans l'église paroissiale. Les actes de l’État Civil nous apprennent d'autre part que plusieurs membres de la famille des seigneurs de Puidebar, Bannerot et d'Herbéviller ont été inhumés dans cette chapelle dont nous n'avons vu aucune trace, non plus que de celle de Ste Catherine qui, à ce qu'il paraît, aurait été fondée en 1508 par Vautrin Houin et sa femme Catherine de Frouard et transférée dans l'église. - Les autels qui existent sont ceux de St-Nicolas, de la Vierge et de la Dame de Pitié.
____ Clocher. ___ La première tour a été élevée en même temps que l'église. Elle a subi une transformation complète en sorte que nous ne pouvons rien dire de l'ancienne. Des devis estimatifs, des projets de construction déposés dans les archives, nous mettent au courant des réparations ou modifications qu'on y a faites depuis la fin du siècle dernier.
….............En l'an VII, dans un devis, il est question de recrépir le côté Ouest de la tour et son contrefort de gauche. La même année il est dit que certaines parties « du pavé du temple » en carreaux de terre seront remplacé par des neufs posés en plein mortier de chaux [page 76] et sable ; que les vitraux manquants seront de même remplacés par d'autres en verre commun ; que les couvertures au-dessous de la nef et du chœur seront remaniées et qu'on y fournira les tuiles creuses nécessaires – il est fait mention de la flèche – par conséquent nous pouvons croire qu'il y a toujours eu une flèche à la tour.
….............En l'an VIII, même devis légèrement modifié.
….............Un rapport du Conducteur des Ponts-&-Chaussées en l'an IX nous indique que l'église, au moment où l'on y fait les réparations ci-dessus était dans un état piteux ; qu'au fur-et-à-mesure que l'on remettait à neuf ce qui était le plus délabré, on trouvait encore de nouvelles dégradations et il conclut à la nécessité d'y remédier : recrépir les trois croisées du beffroi, reconstruire à neuf la chambre de l'horloge et pratiquer à cet endroit une croisée pour remplacer le créneau ; ces ouvrages ont été exécutés en l'an X.
….............Cette année même, l'horloge communale, très ancienne, ne valant plus rien, fut remplacée par une neuve en cuivre, dont le fournisseur était un nommé Coquet, horloger à Nancy, qui, d'après le rapport d'expertise, se signala par la grande perfection qu'il avait apportée dans la construction de cette horloge et obtint même une gratification de l'administration communale. [page 77]
….............En l'an XII un autre devis porte un projet de reconstruction de la tour, de fonte de deux cloches et d'établissement d'un confessionnal.
….............En 1829, un rapport du Conducteur des Ponts-et-Chaussées porte que pour « les besoins du culte, il conviendrait d'agrandir l'église en avant du portail et de reconstruire dans cette position une nouvelle tour pour remplacer l'ancienne en mauvais état, d'aspect disgracieux, qui serait démolie, ainsi que la flèche, à la hauteur des murs de la chapelle vis-à-vis ». Un plan qui accompagné ce rapport nous donne l'idée du projet qui ne fut pas mis à exécution.
….............En 1832, nouveau projet, bien différent du précédent. Il fut exécuté, et l'aspect actuel de l'église, ainsi qu'un plan nous indiquent de quelle manière il a été conçu. La tour, au lieu de se trouver sur l'emplacement de l'ancienne, a été construite en avant de la nef. __ L'ancienne tour a été démolie « jusqu'à la hauteur des murs de la chapelle correspondantes ». (Transept) ; la couverture et les bois de démolition qui en provenaient ont été employés à reconstruire une toiture à deux pans, formant pignon, sur la partie restante de la tour.
….............La nouvelle tour en pierre comme l'ancienne, a une hauteur de 17m40 du niveau du seuil jusqu'à l'attique. Le reste a environ 8 mètres de haut, ce qui ferait à peu près 25 mètres d’élévation pour le clocher. Cette tour n'a rien d'agréable, [page 78] elle paraît lourde. Le dôme qui la surmonte est couvert en zinc et présente quatre pans. Le comble de la tour se compose d'un cylindre, taillé en pans, dont le rayon est à 50 centimètres de l'axe vertical de la ligne de cintre ; d'un clocheton qui porte une boule creuse de 50 centimètres de diamètre. Au-dessus de la boule est la croix ancienne qui se dressait déjà sur la vieille tour. Elle est formée de tiges simples en fer ; les bras portent un croissant à leur extrémité ; les angles droits que font les bras sont partagés en deux par des petites tiges de fer.
____ Cloches . ____ D'après les mêmes pièces, il nous a été à peu près possible de faire l'historique des cloches, au nombre de 3 maintenant. Anciennement il n'y en avait qu'une seule qui aurait été fondue en 1715. En l' IX elle fut descendue d'urgence pour remplacer les liens qui la tenaient au mouton. En l'an XII on demande de refondre cette cloche et d'en acquérir une seconde : cette demande demeure sans suite. En 1807 la cloche unique étant fendue et ne produisant plus aucun son, la demande de l'XII est réitérée. Ce fut seulement en 1810, le 26 juillet que ces cloches qui venaient d'être fondues furent baptisées par Michel Gachet, curé desservant la paroisse, sous l'administration de Pierre Nicolas Lucot, maire. [page 79]
….............En 1829 ces deux cloches furent refondues de manière à en avoir une troisième. Ce sont elles qui existent encore : la petite est dans le dôme , à la base de la flèche ; les autres sont plus bas, dans la tour, à la hauteur des grandes fenêtres. Elles ne sont pas bien grosses et ne sont pas en bon état. Les anses de chaque cloche sont engagées dans un mouton dont les axes reposent sur des coussinets ordinaires ; c'est à une sorte de bras en bois fixé dans le mouton que la corde est liée.
…............................................Voici leur inscription :
Grosse : Deum laudo renascentes annuntio adulto convoco defunctos -
L'an 1829, j'ai été bénie par Mr. Pierre Nicolas Georges, prêtre desservant la paroisse de Frouard, sous l'invocation de la Ste Trinité ; la protection de St. Jn Bte patron de cette paroisse ; pour parrain Joseph Parisot, propriétaire et maire de la Commune de Frouard, et pour marraine Magdeleine Georgel, son épouse ____ 823 kilogs -
Moyenne : (même texte latin et français) …... pour parrain Hyacinthe Rolin, propriétaire et adjoint au maire de la commune de Frouard et pour marraine la dame Marguerite Parfait, son épouse ____ 591 kilogs ½,
Petite : (même texte latin et français) …... pour parrain Charles Christophe Courtois, ancien maire, membre du conseil municipal, meunier, propriétaire des moulins de Frouard ; pour marraine Peuchrin, son épouse. ____ 440 kilogs - [page 80]
_________________________
Ermitage et couvent
….............Nous avons dit que sur le bord du ruisseau St Jean (page 23) il y avait autrefois auprès de la route un ermitage qui a donné son nom au ruisseau et à la vallée dans laquelle il est situé. Aucun renseignement bien précieux ne nous a été fourni à cet égard. Il paraîtrait qu'il a été supprimé en 1787 ? parce que les ermites détroussaient les voyageurs sur la grande route et commettaient aussi d'autres crimes. Autrefois on voyait sur son emplacement des traces de ruines qui sont complètement effacées.
….............Dans la rue du Fort-Joly et la partie au bas de la place nationale il y a un quartier de maisons très vieilles et construites bizarrement, elles sont désignées sous le nom de Couvent. Là en effet, existait un couvent dont les locaux ont été convertis en maisons d'habitation.
….............L'aspect extérieur, par devant, ne dénote pas beaucoup la présence d'un monastère. La porte principale seule, dans certaines maisons, rappelle une porte de petite chapelle dont le dessus est un cintre : il ne devrait pas y avoir beaucoup de fenêtres de ce côtés, et celles qui pouvaient exister devaient être très petites ; elles ont été remplacées par des fenêtres modernes ; celles qui subsistent encore sont cintrées et peu larges. La façade a été blanchie ; en un mot les restaurations successives qu'ont subies ces antiques maisons cachent un peu leur origine. Mais par derrière, à une certaine distance, on devine, au premier coup d’œil, que l'on est en présence de maisons qui ont été un couvent, ou un cloître ou autre établissement de même nature. Le derrière est bien plus élevé que le devant par suite de la pente rapide du terrain à cet endroit ; les murailles, toutes noires, sont percées vers le haut de petites fenêtres, les unes à l'ouverture cintrée, les autres carrées, à l'ouverture en bois au lieu d'être en pierre de taille, sont parfois coupées en deux par un meneau en bois aussi, et servant de support à la partie supérieure. D'autres fenêtres, au bas, sont bien plus larges que celles d'aujourd'hui, mais bien moins hautes ; le dessus, en pierre, est en arc surbaissé. Nous n'avons pu relever aucune date à l'extérieur.
….............En entrant dans ces habitations on se sent transporté au temps des moines, de la féodalité, dans un milieu qui respire la solitude, la retraite. Corridors dans tous les sens, pavés, larges, resserrés un peu à la place des portes qui sont en arcade et dont l'architecture a quelque ressemblance et même beaucoup d'analogie avec le style roman ; la voûte des corridors est en maçonnerie de petites briques rouges. Notons aussi qu'ils sont plongés dans une demi-obscurité qui produit une singulière sensation sur celui qui y pénètre pour la 1° fois.
….............Les pièces des logements sont basses, mais ordinairement vastes et presque carrées ; elles renferment d'habitude une cheminée dont le manteau est très bas et très large avec pierres taillées dans le genre du style roman. La partie supérieure est plafonnée, mais le plafond tombe ; quelquefois au lieu d'un plafond, on voit le plancher de l'étage supérieur posé sur des poutres taillées irrégulièrement. Les planchers, très vieux, composés de larges planches dont les nœuds seuls ont résisté à l'usure pendant que les autres parties se sont amincies peu à peu, ploient sous le poids des personnes ou se rompent dans leurs parties les plus vermoulues.
….............Les écuries sont basses, obscures ; à droite, à gauche, en haut, on aperçoit des grosses poutres qui soutiennent, les unes le toit, les autres le solives sur lesquelles reposent les planchers. Sur l'une de ces poutres qui forme la partie supérieure d'une porte, nous avons relevé la date 1776. Cette date est probablement celle de la reconstruction de l'écurie où la porte donne accès, mais non celle de la construction qui doit, d'après les apparences, remonter à plusieurs siècles.
….............La principale de ces maisons est placée en-dessous de la place nationale. On entre d'abord dans une grande cour par une porte très large à deux battants en bois qui tombent de vétusté et qui ne servent plus à rien ; le dessus, formé par un petit mur horizontal est surmonté d'une grille à gros barreaux pointus. Au fond de la cour étaient les bâtiments de ferme qu'habite encore un cultivateur ; de chaque côté, les corps-de-logis, ceux de gauche d'un aspect moins sombre, plus grandiose, devaient servir de logement aux supérieurs du couvent : escaliers en pierre, corridors avec planchers, plafonnés ; toits formant pignon, couverts de tuiles rouges et arrondis. Sur le côté s'élève une tour carrée, haute, surmonté d'un toit pyramidal à quatre pans ; d'où l'on peut dominer toute la vallée de la Moselle.
….............Enfin, ce qui est digne aussi de curiosité, c'est la partie qui portait le nom de Fort-Joly et qui a donné ce nom à la rue. Les pièces du rez-de-chaussée ressemblent à celles du premier … de décrire. Quant à celles du premier étage, il n'y a pas lieu d'en parler ; ce premier étage qui n'existait pas, était remplacé au contraire par une sorte de sous-sol donnant sur les jardins et auquel on arrivait par des galeries voûtées à pentes rapides, avec ou sans escalier, très basses, et obscures, faite de murailles épaisses et humides. Les chambres des ce sous-sol sont plus étroites que celles dont nous avons parlé, mais une disposition semblable. _______ Aucune archive communale, aucun document n'a pu nous renseigner sur ce point. Les habitants prétendent que ce Fort-Joly était une prison ; son aspect, sa disposition portent à le croire ainsi [page 84] que les fenêtres qui ont ou qui ont eu des barreaux et qui sont à une certaine hauteur au-dessus du sol. Mais il y a lieu de supposer aussi que c'était un pénitencier où l'on enfermait pour un certain temps ceux de la communauté qui enfreignaient les statuts de l'ordre.
….............Dans une maison nous avons remarqué l'existence de vieilles balustrades à divers étages, qui servaient et servent encore de garde-fous pour aller d'une partie de la maison à l'autre, car ces parties ne sont pas réunies, elle sont reliées par des espèces de planchers suspendues.
___ Croix. ___ En 1883, une croix qui était sur la place, entourée de gros tilleuls très vieux, a été enlevée puis déposée dans la cour du Musée Lorrain. Elle avait 8 mètres de haut ; le socle reposait sur des marches qui ont été employées pour border des trottoirs, la pierre qui composait sa colonne était jaunâtre ; d'un côté de la croix est le christ crucifié ; de l'autre côté on voit un guerrier à cheval tenant une lance ou une épée à la main : ceux qui prétendent que cette croix a été érigée par René II disent que le guerrier figuré sur la croix est l 'image de ce duc. Elle paraît remonter à une date plus reculée ; elle appartiendrait au XIIIe ou au commencement du XIVe siècle.
| C'est en enlevant cette croix que l'on a trouvé les armoiries ci-contre. [page 85] |  |
_____ Châteaux. _____
….............La commune possède deux anciens châteaux : l'un dit le « Vieux-Château » , l'autre appelé « Château-d'En-Bas » (Nous ne reviendrons pas sur ce dernier dont nous avons raconté ce que nous en connaissons). (Voir ferme, page 11).
___ Vieux-Château . ___ Nous avons déjà trouvé l'occasion de dire quelques mots du Vieux-Château, (voir pages 4 - 11 - 44 - 64 - 75)
Nous allons achever de parler de son emplacement. Bâti au sommet de la colline escarpée qui domine Frouard et toute la vallée de la Moselle et une partie de la Meurthe, non loin du confluent de ces deux rivières, ce château devait être une place importante au moyen-âge, car il était difficile de l'atteindre. On n'y parvenait que par un chemin très rapide et creux qui venait de Frouard, montait la rue dite du Vieux-Château, où l'on voit encore de bien vieille masures, suivait le sentier que l'on voit faisant suite à cette rue, mais qui n'était pas alors un sentier, et aboutissait à la porte qui devait être entre les deux vieilles tours en ruines, exposée au Nord ou au Nord-Nord-Ouest. De larges fossés et profonds rendaient l'accès de la forteresse, sinon impossible, du moins dangereux et difficile du côté de l'Est, et les bois du côté du midi et de l'Ouest, séparés seulement du château par un fossé, rendaient toute attaque impossible sur ce point. Ce dernier fossé est en partie comblé par l'établissement de chemins construits pour l'exploitation des terrains mis en culture depuis [page 86] que les bois des Rays ont été essartés. Le chemin du château n'est plus fréquenté par les voitures ; on en a fait un autre qui arrive au sommet de la colline en la contournant.
….............En quelle année a-t-il été fondé ? Nous avons à plusieurs endroits qu'il avait été construit par Ferri II. Des auteurs plus dignes de foi, M. Lepage et le savant historien Digot, se rapportent à dire qu'il date de Ferri III qui le fit élever sur un fonds appartenant au prieuré de Lay-St-Christophe dans le but de tenir en Bride celui de l'Avant-Garde (Pompey) et celui de Condé (Custines) 1271. Mais il faut remarquer ceci : Frédéric III, selon Digot, n'aurait pas été le premier à construire un château sur cette place, puisque, dit-il « ce duc réédifia la forteresse qui menaçait ruines ». L'éminent historien est d'accord avec la date des événements, car il est impossible d'admettre que l'époque de la pose de la première pierre remonte à Ferri III, quand on nous raconte qu'en 1132, bien avant ce duc, sous le gouvernement de Simon I, les armées de l'archevêque de Metz tentèrent de s'emparer du château de Frouard.
_____ Propriétaires du château. _____
Un ancien titre des archives de la commune de Frouard, concernant l'origine d'une propriété que se disputaient les habitants de Frouard et ceux de Liverdun, nous raconte [page 87] que le château a eu pour second seigneur Mathieu qui l'acquit dans cette circonstance. Ce Mathieu était brouillé avec Thiébaut, son aîné (qui devait devenir Thiébaut II). Renaud de Bontilier Senlis, évêque de Toul sur la fin du XIIe siècle, régla le différend : Thiébaut céda à son frère, outre la ville de Neufchâteau, les forteresses de Châtenois et de Frouard. ___ Il appartient aux ducs de Lorraine et nous ignorons si ces ducs le cédèrent à quelques vassaux.
….............En 1530, nous dit le même document, le seigneur de Frouard était un nommé Nicolas Valette ou Valet qui avait une fille, Agnès de Frouard qui se maria avec messire Claude de Fernay, dont nous trouvons pour la première fois le nom en 1891 : il devint seigneur de Frouard. ___ En 1612, nous trouvons un nommé de Valhey, seigneur de Frouard : mais la possession du château par ce dernier est contestée ; un titre de 1726 affirme que de Valhey possédait bien, outre les domaines qu'il avait sur Liverdun, le château en question ; ce qui suit paraîtrait le prouver. ___ Plusieurs titres, datant du milieu du XVIe siècle et de 1609 citent André des Porcelets de Malhianne, baron du St Empire, seigneur de Valhey, Ville-au-Val, Ste Marie, du château de Frouard, Conseiller de son Altesse, commandeur de la ville de Marsal, frère de Jean des Porcelets, évêque et compte de Toul, prince du St Empire. ___ En 1680, dans des actes de l'Etat civil, on parle d'un certain Louis Hilaire Mary, admodiateur de la terre de Frouard appartenant au marquis de [page 88] Gerbéviller : nous ignorons depuis quand il la possédait. ___ Vers la fin de la même année, dans d'autres actes, le même admodiateur est porté comme étant celui de « Monsieur de Puydebar ». Il faut croire qu'en 1680 le château a dû changer de propriétaire. Dès cette époque le nom de Jean de Roquefeville de Puydebar, capitaine des bardes de Mgr le maréchal de Créqui, seigneur de Frouard, revient fréquemment dans ces actes, à propos des déclarations à l'Etat civil faites par les individus qui étaient attachés au service du château ou des terres qui en dépendaient. ___ Le 5 mars 1703, avons-nous trouvé dans le dictionnaire des communes de la Meurthe, par l'éminent archiviste M. Lepage, Antoinette Thérèse d'Herbéviller, veuve de Jean de Roquefeville de Puydebar, fille de feu messire Jean François de Roqueville, seigneur de Frouard, Puydebar, Herbéviller, et de Antoinette Thérèse de Bannerot, dame d'Herbéviller, se marie avec mesire Philippe Duhan, comte de Martigny, seigneur de Colmey, Chambellan de Son Altesse Royale, fils de Gabriel Duhan (mêmes titres) et de dame Philiberte de Rivers ; présent : messire Ferdinand, marquis de Lunati-Visconti, Chambellan de Son Altesse [page 89] Royale, capitaine au régiment des gardes du roi.
….............A partir de ce mariage, nous voyons souvent figurer les descendants du seigneur Puydebar, de Frouard, etc, avec la famille de Lunati-Visconti. En 1708, le marquis de Lunati-Visconti est parrain dans un baptême avec demoiselle Claude Henriette de Bannerot d'Herbéviller. La même année, nous trouvons comme marraine dans un baptême dame Jeanne Thérèse de Puydebar de Roquefeville, marquise de Lunati-Visconti. Il y a donc eu mariage entre les deux familles.
….............En 1734 un acte de l'Etat civil fait mention d'un prince d'Estherhazy. Nous savons d'autre part qu'en 1735, Paul Anthoine d'Estherhazy et de Galantha, prince du St Empire romain, fait ses foi et hommage à cause d'Anne Louise de Lunati-Visconti, sa femme, pour raison du marquisat de Frouard et de la terre et seigneurie de Clévant. (Voir ce qui est dit de la Ferme et du Château d'En-Bas, page 11.). Les Lunati-Visconti tenaient ce marquisat des mains du duc Léopold qui le leur avait donné dans les premières années du XVIIIe siècle.
….............En 1772, Louis Charles, comte de Chabo, lieutenant général des armée du roi, seigneur du Grand-Liers, de la terre et seigneurie du ban la Dame séante à Frouard, des terres et seigneurie du dit Frouard, fait ses [page 90] reprises pour ces terres du roi de France.
En 1781, Alexandre Louis Lattier et de Bayane, fait ses foi et hommage pour la terre et seigneurie du Ban la Dame, consistante en haute, moyenne et basse justice, en deux châteaux (le Vieux-Château et le Château d'En-Bas), maisons, pourpris, jardins, parc, basse-cour, droit de bergerie, de chasse, de pêche dans la rivière de Meurthe qu'il possède patrimonialement comme héritier du comte de Chabo.
….............Donc à la fin du siècle dernier, le Vieux-Château, le Château d'En-Bas et le parc, où est situé maintenant le fort, appartenaient au marquis Alexandre Louis de Lattier de Bayane et à Adrienne Angélique, Joséphine Elisabeth De la Porte, marquise de Lattier, épouse, puis veuve douairière du marquis sus nommé, en leur vivant au château de Maxéville, puis à Paris, décédés depuis longtemps. ( D'après le titre d'acquisition que nous a présenté le propriétaire actuel. Ce qui suit a été puisé à la même source ou provient de ce que nous a raconté ce propriétaire ).
….............Le marquis et la marquise de Lattier-Bayane ont laissé pour seule héritière Mdme Catherine Joséphine Didière Aminthe de Lattier-Bayane, fille unique, propriétaire à Paris, veuve du comte Amédée de Rochefort d'Ally. [page 91]
….............La comtesse de Rochefort est décédée à Paris le 3 décembre 1868, sans aucun héritier, laissant pour légataire universel le comte Juste de Faÿ de la Tour Maubourg mineur. Ce jeune homme est venu visiter ses propriétés avec son père, à Frouard. On raconte que ce fils avait bien recommandé à son père de ne pas vendre ces domaines, qu'il y tenait beaucoup et que, devenu majeur, il aurait un soin jaloux de veiller à leur conservation. Ces restes ajoutait-il, rappelleraient que ses ancêtres, ont rempli un rôle féodal ; il aurait de la peine à apprendre qu'ils sont passés à une autre famille et surtout entre les mains d'une famille étrangère à la noblesse. Mais ce jeune comte eu une fin prématurée.
….............En 1870, il était sous-lieutenant dans la garde-mobile ; il fut tué en novembre au combat de Bellegarde (Loiret), laissant pour seuls héritiers M. le marquis César Florimond de Faÿ de la Tour-Maubourg, ancien député, et Mdme Eugénie Eve Adolphine Mortier de Trévise, marquise de la Tour-Maubourg, domiciliés à Paris, ses père et mère, chacun pour un quart ; et Mlle Anne Marie Caroline de Faÿ de la Tour-Maubourg, sa sœur, fille mineure, pour la seconde moitié.
….............Or M. et Mdme de Faÿ de la Tour-Maubourg, agissant personnellement au nom de leur fille à laquelle ils doivent rendre compte à sa majorité, [page 92] prennent pour mandataires, M. M. Lazard Cain Bénel et Goudchaux-Schil, propriétaires à Nancy, qui vendent
(1°) au sieur Renaud, ancien instituteur, en retraite à Frouard, le Vieux-Château dont l'emplacement occupe 1 hectare 92 ares, ainsi que quelques pièces de terrains
(2°) au comte O'Gormann, propriétaire à Nancy, la ferme du Château-d'En-Bas et ses dépendances,
(3°) au marquis de Panges, le parc Lattier. Celui-ci cède, après expropriation, le dit parc à l'administration militaire pour l'établissement du fort.
____________ Ruines . _________ Ce château a été démoli en 1633, par les ordres de Louis XIII. Maintenant il n'en reste plus que les ruines : vieilles murailles dont le pied est caché par les débris des parties supérieures ou par le sapins qu'y a plantés le propriétaire actuel, ou encore par les plantes grimpantes ; deux vieilles tours, dont une surtout menace de tomber et ne tient plus que grâce au lierre qui l'entoure. On parvient difficilement au sommet de cette dernière ; il faut chercher appui dans les intervalles laissés par les pierres qui se détachent, tandis que l'on arrive facilement au sommet de l'autre qui a été rasée au niveau du sol du château ; du haut de chacune d'elles on embrasse tout le pays environnant. [page 93] Les murailles étaient construites solidement : les côtés sont en maçonnerie régulière et ont dû être montés progressivement au fur et à mesure que l'on remplissait leur intérieur de pierres jetées pêle-mêle et de mortier. On voit encore la place marquée de certaines pièces, entre autres un vaste carré entouré de murs qui sont restés debout jusqu'à une hauteur de 50 centimètres, et qui, dit-on, entouraient le salon du Châtelain.
….............Vers le milieu de l'emplacement on remarque une espèce de crevasse dans le sol ; à cet endroit le souterrain s'est affaissé en laissant apercevoir comme la voûte d'une cave , mais on n'a pas tenté jusqu'alors de pénétrer dans ce souterrain, chose qui, pour être faite, exigerait un déblai en même temps que l’établissement de supports pour éviter des éboulements. ___ A quelques mètres plus loin est une maisonnette construite en pierre, par le propriétaire, M. Renaud ; elle abrite une citerne assez profonde qui a toujours été remplie d'eau jusqu'à ces derniers temps, mais qui est à sec à cette heure par suite des recherches de minerai que l'on fait en dessous des bois, sur le parcours du trajet que suivait l'eau qui se rendait à cette citerne ___ Sur l'emplacement du château on a trouvé une ancienne serrure, mais encore en bon état, qui a été donnée au Musée lorrain.
Avant d'être possédé par son propriétaire actuel, le château était demeuré tel depuis sa démolition ; des broussailles [page 94] avaient crû ; ce propriétaire les a remplacées par le bois qu 'on y voit à présent. Des murailles de l'intérieur, le propriétaire retire des pierres qu'il vend pour des constructions ; c'est jusqu'aujourd'hui, le seul profit qu'il a obtenu de son acquisition.
______ Souvenirs se rattachant au Vieux-Château. ______ Plus d'une fois ce château a été convoité par les ennemis des ducs de Lorraine qui en ont été les possesseurs.
….............En 1132, Simon I était en guerre avec le comte de Bar, l'évêque de Metz et l'archevêque de Trèves. Il traversa la Lorraine allemande, gagna les frontières méridionales de l'archevêché de Trèves et se mit à les ravager. Pendant ce temps l'archevêque réunissait une armée considérable dont il confia le commandement à son neveu, Geoffroy, sire de Faulquemont, jeune homme de 18 ans, mais guerrier plein de bravoure et d'habileté. Il conçut un projet hardi qui avait pour résultat de délivrer les terres de son oncle : ce fut de porter la guerre au cœur même de la Lorraine, ce qui obligea Simon à changer son plan de campagne, car il avait eu intérêt à porter la guerre au Nord pour protéger ses états septentrionaux qui s'étendaient jusque vers Trèves. [page 95]
….............L'armée de l'archevêque, traversant le pays messin, où elle ne rencontrait que des amis, remonta la vallée de la Moselle et vint mettre le siège devant les château de Frouard qui était de ce côté, le boulevard de la Lorraine et s'élevait sur la colline fort abrupte dont nous avons parlé, près du confluent, en face du château de l'Avant-Garde et de celui de Condé (Custines), appartenant, le premier au comte de Bar, le second à l'évêque de Metz. C'était au moyen-âge une des plus importantes forteresses de notre pays, et Simon qui ne tarda pas à apprendre le danger qu'elle courait, laissa des guerriers dans les principaux châteaux de la frontière et s'avança vers celui de Frouard pour le secourir.
….............Le capitaine Richard qui y commandait et craignait de ne pouvoir résister à un assaut, donna un signal dont on était convenu à l'avance. Aussitôt les garnisons de tous les châteaux voisins en sortirent et rejoignirent le duc Simon qui campait avec son armée près de l'abbaye de Bouxières, à une lieue de Frouard. Simon traversa la rivière qui le séparait de l'armée de l'archevêque et vint lui offrir le combat pendant que le capitaine Richard faisait une sortie. Le duc était accompagné du comte de Salm qui était un bel homme, très brave, et très savant dans son métier de guerre et qui s'était déjà distingué. Les troupes de Simon furent entièrement défaites ; le comte de Salm, son fidèle allié, fut blessé de deux coups de lance [page 96] qui le percèrent de part et d'autre et le firent mourir ; le duc lui même reçut une grosse blessure au poignet qui lui vint d'un coup de hachette. L'armée lorraine se dispersa complètement ; les garnisons des forteresses se hâtèrent d'y rentrer, et Simon, lui-même, se réfugia dans son château de Nancy. L'ennemi l'y poursuivit, espérant par un coup de main s'emparer de la forteresse et du souverain. Mais il échoua, car l'empereur d'Allemagne vint au secours du duc et fit lever le siège à l'ennemi. Simon I put sortir de son château, rallier ses troupes dispersées, les réunir à l'armée impériale, et, à son tour, poursuivre Faulquemont, le battre à deux reprises, pénétrer sur les terres de l'archevêché et y commettre de grands ravages.
____ Combat en 1308. ____ En 1308 une guerre vint à éclater entre Thiébault II et l'évêque de Metz. Renaud de Bar, pour le motif suivant. Le pape Clément V désirant contribuer aux succès des chevaliers de St Jean de Jérusalem qui avaient entrepris la conquête de l'île de Rhodes, fit lever des décimes dans toute la Chrétienté ; et comme il avait eu l'occasion de connaître le duc de Lorraine à Lyon, il le chargea de procéder à cette opération délicate dans son duché ainsi que dans les petites seigneuries voisines. L'évêque de Metz fut offensé de voir un laïc chargé de lever des décimes sur les biens ecclésiastiques ; Thiébaut fut trop entreprenant et trop vif ; il outrepassa les instructions du pape et refusa d'écouter les remontrances et les observations du prélat. Malgré la résistance de Renaud, il exigea le décime des églises appartenant au temporal de l'évêché ; l'animosité ne tarda pas à s'en mêler et l'évêque s'imaginant peut-être avec raison, que le duc voulait le molester, lui déclara la guerre et appela à son secours Edouard I, comte de Bar, son neveu et Nicolas, comte de Salm.
….............Pendant que les Lorrains prenaient le château de Wermerange qu'ils détruisirent, Renaud s'empara de Lunéville et l'abandonna au pillage. Tournant ensuite ses armes d'un autre côté, il fit le siège du château de Frouard, vers la fin du mois d'octobre 1308. Le duc, qui ne voulait pas laisser tomber entre les mains de ses ennemis une place aussi importante, marcha contre eux ; il venait de recevoir du renfort du sire de Blâmont et le jeudi 7 novembre il arriva près de Frouard. Les assiégeants prévenus de son approche, s'étaient rangés en bataille dans la plaine qui s'étend jusqu'à la Gueule d'Enfer et dans un vallon faisant suite à cette plaine. Thiébaut, dont les troupes étaient bien inférieures en nombre, regretta de s'être avancé avec tant de précipitation ; mais ayant eu le temps de se reconnaître, il eut recours à une manœuvre qui lui réussit. Gagnant la crête de la colline qui s'élevait sur sa gauche, il obligea l'ennemi à changer son ordre de bataille et s'assura l'avantage du terrain. Au moment où le comte de Bar avec son armée et celle de l'évêque gravissait la hauteur pour gagner les Lorrains, Thiébaut fit mettre pied à terre à sa cavalerie et commanda à ses soldats de faire rouler sur les assaillants plusieurs quartiers de roches et quantité de grosses pierres accumulées sur le bord du plateau. Les Messins et les Barisiens, surpris par cette avalanche, reculèrent en désordre ; beaucoup furent écrasés ou blessés par le choc des pierres. Les lorrains, descendant de la colline, achevèrent la déroute ; 200 au moins étaient restés sur place ; les autres s'enfuirent et quelques-uns se noyèrent en passant la Moselle et la Meurthe. Les comptes de Bar et de Salm furent fait prisonniers. L'évêque, consterné de cette défaite, proposa un accord qui ne fut pas accepté immédiatement. Thiébaut étant mort, ce fut Ferry IV, son successeur qui ratifia le traité en 1314 ; il rendit la liberté aux prisonniers.
_____ Nouvelle guerre : 1352, _____ Raoul, duc de Lorraine, ne laissait en 1346 qu'un fils qui avait six mois. Ce fut la veuve, Marie de Blois, qui eut la régence. Elle tint tête à tous ceux qui l’inquiétèrent et même elle fut tellement ambitieux que par ses guerres elle attira des malheurs sur son duché. Les Etats furent obligés [page 99] d'intervenir pour engager Marie de Blois à traiter, ce qu'elle fit en 1351.
….............La paix ne fut pas de longue durée. Ne perdant pas de vue les projets qu'elle avait formés contre ses ennemis, elle attaqua de nouveau Adhémar de Monteil, évêque de Metz, en assiégeant Metz qu'elle considérait comme une bonne proie. La ville, bien défendue, l'obligea, malgré les troupes qu'elle avait ramassées à droite et à gauche, de renoncer à son projet. Elle se contenta de brûler quelques villages des alentours.
….............Les Lorrains reprirent tranquillement leur chemin sans avoir la précaution de laisser quelque troupe pour observer leurs adversaires. Les bourgeois de Metz qui brûlaient du désir de se venger, trois jours après le départ des Lorrains, entrèrent en campagne, dévastèrent les villages qui étaient sur leur route et vinrent camper devant le château de Frouard. Marie de Blois qui ne s'attendait pas à ces représailles, n'avait laissé qu'une garnison insignifiante dans la forteresse. Les Messins n'osèrent l'attaquer, mais s'emparèrent du bourg qui était très important, y firent plusieurs prisonniers, s'avancèrent jusqu'auprès de Nancy et s'en retournèrent chez eux.
_____ Hôtel-de-Ville. _____
….............[page 100] Frouard ne possède pas d'hôtel-de-Ville ancien. L'ancienne mairie a été achetée en 1807 avec le presbytère qui est voisin ; elle est en dessous de la place nationale. Elle ne renferme rien de remarquable sous aucun rapport ; en 1873 les locaux scolaires étant devenus insuffisants on y a installé une classe pour les garçons (voir page 57.). Cette mairie appartient maintenant à un épicier. On a construit en 1888 le nouvel hôtel-de-Ville qui n'a rien de remarquable. Le groupe scolaire en fait partie : à droite l 'école de garçons, à gauche celle de filles ; entre les deux au rez-de-chaussée, au-dessous des locaux de la mairie, il y a une classe de garçons encore et l'école maternelle.
........... ..._____ Moulin. _____ |
_____ Superstitions et croyances. _____
….............Plusieurs individus de Frouard, dans le courant du XVIe siècle furent exécutés comme sorciers ; ce furent : Antoinette, veuve d'André Malgouverne et Katin, demme de frère Jean, ermite de St Jean. En 1587, le nommé Frnaçois Rouyer, aussi ermite de St Jean, fut banni sous l'accusation du même crime. En 1487, deux lépreux, Jean et Obry, avaient été brûlés à la justice de Frouard.
….............Pendant longtemps des légendes superstitieuses circulèrent à Frouard au sujet de l'expulsion des ermites de St Jean et la destruction de leur ermitage. [page 101] On n'en parle plus maintenant.
….............De nos jours quelques superstitions existent dans cette population arrivée de tant de pays, mais elles sont peu nombreuses. Une a surtout percé le jour par suite des démonstrations qu'ont faites ceux qui en étaient obsédés. Il y a deux ans environ, un ouvrier fut trouvé pendu le matin à un arbre. Une grande foule faisant partie des localités de Frouard et de Pompey se rendit autour du suicidé, attendant impatiemment le moment où le Parquet se retrirerait. Attirée en partie par la curiosité, cette populace, les femmes en particulier, venait pour se partager, se disputer des morceaux de la corde qui avait servi à la strangulation de cet individu, croyant fermement qu'un bout de cette corde suffit pour préserver de tous maux et accidents celui qui en est porteur et lui attirer au contraire la chance, la réussite, dans tout ce qu'il entreprend.
….............Quelques personnes, hommes et femmes, mais femmes surtout, ont encore confiance dans les chiromanciens, charlatans, tireuses de cartes, diseurs de bonne aventure, somnanbules, qui viennent quelquefois s'installer aux fêtes de la localité ou courir de ménage en ménage pour prédire le bonheur et le malheur qui attendent chacun des membres de la famille. Ceux qui captent encore le plus la bonne foi du peuple, ce sont les vendeurs de drogues. Quant aux guérisseurs par le secret, [page 102] ils ont encore beaucoup de fervents. Assez de femmes et quelques hommes à Frouard s'attribuent le pouvoir de guérir les maux, les dérangements de certaines parties du corps : foulures, entorses, luxations, panaris, tumeurs, abcès, maux de dents, doivent également disparaître devant les signes et les paroles secrètes de ces médecins qui réfutent la science des vrais disciples d'Hippocrate. Bien des fois nous avons entendu quelque bonne commère, les bras de chemise retroussés, le balai en main, dire à quelqu'un qui s'apprêtait à aller voir le médecin pour le consulter : « Allez donc plutôt voir la mère X.... ou le père Z.... ; ils y connaissent mieux que vos médecins qui ne font que s'étudier sur votre corps et ne pensent qu'à partager, avec le pharmacien, le bénéfice que vous allez lui faire gagner en achetant des drogues qui coûtent tant ! »
….............Certaines bonnes vieilles grand-mères racontent encore à leurs petits enfants des faits fabuleux qui remplissent ces jeunes cœurs d'épouvante, des récits de revenants et autres bavardages aussi stupides. Toutes ces croyances perdent de jour en jour de leur vigueur par suite de la diffusion de l'instruction dans les dernières classes de la société et des progrès que l'on obtient dans l'enseignement des sciences. [page 103]
_____ Légendes et dictons. _____
….............Une légende circule parmi les habitants de la localité : la majeur partie sait que cette légende est une fable, mais on aime à la raconter aux enfants pour les amuser. Il se trouve non loin du Vieux Château, presque en entrant dans le bois communal qui croît sur le versant Est du « fond de Hardillon » tout sur le bord du sentier qui conduit dans ce bois, un trou assez profond, large (probablement une ancienne carrière de pierres,) appelé « Trou des Pommes ». Or, on raconte qu'autrefois des pommiers croissaient sur le bord de cette excavation et que la dame du Château, désirant des pommes, s'était approchée d'un arbre, mais trop près du trou, si bien qu'elle roula au fond ; son corps ne fut jamais retrouvé. Depuis cette époque on l'entendrait à certaines heures de la nuit et même du jour, pousser des soupirs et réclamer des pommes.
….............Ce récit légendaire a dû être inventé pour écarter de cet endroit la jeunesse qui, par imprudence, pourrait trop s'approcher du bord et se blesser en tombant.
Quelques-uns disent qu'on voit sortir de ce trou une vapeur blanche : chose que nous n'avons jamais remarquée, mais qui, si elle est, peut s'expliquer. La mine de Frouard arrivant presque aux environs, il peut se faire qu'une sorte de corridor souterrain, irrégulier et étroit, formé par les interstices des roches, aille des galeries de la mine au trou et livre passage au gaz que [page 104] l'on voit s'échapper parfois blanchâtre des puits d'aération de la mine. ___ Cette légende, toujours la même au fond, est raconté un peu différemment par quelques individues ; elle ne fait en cela que partager le sort de bien des légendes.
________Dictons. ____ Les dictons propres au pays, ceux qui viennent de la vraie population de Frouard, montrent au grand jour l'insouciance de ses habitants. « Faire le tour de la roue » ce qui signifie couler doucement sa vie, aussi tranquillement que possible ; naître, s'amuser dans l'enfance, travailler un peu à l'âge venu, mais sans jamais se priver des jouissances, du plaisir quand ils se présentent ; détourner un peu pour les vieux jours « conserver une poire pour sa soif », et puis mourir. « Après nous, le bout » ou « Au bout du fossé, la culbute » ça qui vaut autant que les fameuses paroles de Louis XV : « après nous le déluge » ___ « tout ira bien, tant que la bonne machine ira seule ». « Courront comme le vent, tombons comme la grêle », c'est-à-dire, laissons-nous conduire par les choses, par le temps, c'est remettre son existence entre les mains du hasard ; c'est ne pas prendre la peine de prévoir ce qui arrivera, pour conjurer les malheurs que l'on pourrait écarter, en un mot, c'est une sorte de fatalisme oriental. « Prendre le temps de vivre » d'après le sens que lui donnent les habitants, c'est ne pas trop se presser ; quand même une chose aurait besoin d'être faite à l'heure, la remettre à plus tard pour [page 105] ne pas se priver d'un plaisir, les plus souvent vain, qui nous attend, ou du repos que l'on pourrait prendre. « Vivre », selon ces gens, c'est prendre tout le bonheur qui se présente quel qu'il soit, quitte de se réserver de peines pour plus tard.
….............Ces raisonnements ont leur sanction dans le peu de souci que prennent les individus de s'assurer une poire pour la soif et un petit avenir pour leurs enfants. Ils ne connaissent pas les sociétés de prévoyance, ou du moins ils sont loin de sacrifier en peu pour jouir de leurs bienfaits en cas échéant. On comprend qu'avec un salaire peu élevé et une famille de quatre ou cinq enfants ou même plus, un ouvrier ne peut pas mettre beaucoup d'argent à la caisse d'épargne ; mais il a été un temps, il y a quelques années, où l'ouvrier gagnait beaucoup plus, plus qu'il ne lui fallait pour vivre : le surplus était versé à la caisse …. de l'estaminet. Aussi les cafetiers, les aubergistes disent-ils ? « C'était le bon temps ! » Si ce bon temps pour eux n'existe plus, c'est que l'ouvrier ne peut pas dépenser ce qu'il ne gagne pas (quelques malheureux le font cependant ; de là des dettes!) Le vrais bon temps, mais ce qui doit s'appeler le bon temps pour l'ouvrier, viendra quand, en gagnant un meilleur salaire, il aura acquis en même temps des habitudes de tempérance, d'ordre et de prévoyance.
_____ Événements antérieurs au XIXe siècle._____
….............Nous ne reviendrons pas sur le événements que [page 106] nous avons signalés comme intéressant directement le Vieux-Château. Ce sont à peu près les seuls qui se sont passés à Frouard. Il y a encore eu plusieurs combats entre Frouard et Champigneulles, postérieurement à ceux que nous avons cités, mais ils sont très importants.
….............Un détachement de Bourguignons, à l'époque où Charles-le-Téméraire sillonnait notre pays avec ses armées pour s'emparer de Nancy, furent surpris à Frouard et massacré sur place. Non loin de l'endroit où était l'ermitage St Jean, il y a un lieu dit « à la Ravage fosses des Bourguignons » qui rappelle le théâtre de ce massacre.
_____ Individus possédant quelques antiquités. _____
….............Aucune personne de la localité ne possède ce que l'on appelle une collection d'objets d'art, ni une bibliothèque historique, ni des archives importantes, et aucune ne se livre à des recherches d'histoire ou d'archéologie. On pourrait citer M. Petitjean, instituteur retraité qui possèdent quelques antiquités : sabres, pièces de monnaie, grains de collier, urnes cinéraires qu'il a recueillies des mains du fossoyeur. M. Renaud, instituteur retraité aussi, qui possède quelques antiquités, pierres principalement, recueillies dans le Vieux-Château dont il est propriétaire, et quelques titres concernant ce château. M. Michel, horticulteur, [page 107] propriétaire de la Grande-Auberge, a aussi quelques titres d'acquisition assez anciens qui peuvent être considérés comme titre historiques ; nous avons dit aussi qu'il avait trouvé dans sa maison une vieille statue de la Vierge (voir Grande-Auberge, page - 13 -). M. le comte O'Gormann, domicilié à Nancy, doit avoir des titres comme acquéreur du Château d'En-Bas. M. le vicomte de Coëtlosquet, domicilié également à Nancy, propriétaire d'un chalet et de terrains situés entre Frouard et Liverdun, possède beaucoup d'antiquités recueillies dans les environs et qu'il achète parfois cher à ceux qui les trouvent.
_____ Archives de la Mairie. _____
….............Les documents renfermés à la mairie et qui font partie des archives communales remontent, les plus anciens, au milieu du XVe siècle. Les uns ont rapport à une contestation, qui durait depuis longtemps et ne devait pas se terminer encore, entre les habitants de Frouard et ceux de Liverdun, au sujet de la délimitation d'un bois. D'autres du milieu du XVIe siècle concernant un procès entre les habitants de Frouard et le nommé Nicolas Varlet, maître des monnaies de Nancy, à propos du droit de bergerie et de troupeau : les habitants de Frouard perdirent, malgré les bonnes raisons qu'ils invoquèrent en s'appuyant sur la loi de Beaumont qui les avait affranchis [page 108] en 1255. D'autres concernent aussi des affaires de procédure en matière de pâture entre les habitant de Frouard et André des Porcelets de Malhianne, etc déjà nommé (page 87.).
….............Les premiers registres de l'Etat civil date de 1658. C'était le curé Sébastien qui administrait la paroisse de Frouard en cette année ; ol constate qu'à son arrivée il n'a trouvé ni registres de baptêmes, ni registre de mariages, ni registre de décès et que dorénavant, pour obvier à cet inconvénient, il va ouvrir des registres pour recevoir ces trois actes. Ces premiers actes de l'Etat civil sont écrits sur de petits cahiers de 12 centimètres environ sur 6 ou 7 de largeur ; les successeurs de ce prêtre les ont tenus d'une façon plus ou moins régulière.
--o--o--o--o--
Partie industrielle
|
_____ Mine de fer. _____
….............Il y a longtemps que l'on sait que les terrains oolithiques du ban de Frouard renferment du minerai de fer ; une note consignée dans les comptes du Receveur général de Lorraine pour 1547-1548, fait mention, sans aucun détail, d'une mine de fer existant sur le ban de la localité.
….............Jusque vers le milieu du XIXe siècle il n'est plus question de recherches de minerai sur ce territoire. En 1856, le nommé Harmand, maître de forges à Nancy, est autorisé, sur sa demande, par le ministère de l'agriculture à opérer dans les bois communaux de Frouard, des fouilles qui ont pour objet la reconnaissance d'un gisement de fer hydroxidé-oolithique. La même année une autorisation semblable permettait au sieur Salins, maître de forges à Abainville (Meuse) de faire des recherches dans la forêt de la Voiletriche, dans les bois communaux de Frouard et Liverdun. En 1865, abornement des mines de la Voiletriche et des concessions faites sur le territoire de Frouard.
….............Les mines de la Voiletriche ne sont plus exploitées [page 110] depuis plusieurs années par suite du chômage des forges de Liverdun. La seule existant maintenat sur le territoire de Frouard est celle qui est dans la section du « Haut-des-Plantes » et qui s'étend sous les bois qui couvrent le plateau. La galerie principale a une longueur considérable ; elle va jusque sous les Raÿs. La mine est riche en minerai, mais elle n'occupe que 7 ouvriers au plus et qui n'y travaillent pas encore constamment. Le minerai est amené de l'intérieur des galeries par des wagonnets que conduisent des hommes. Des camions conduisent ce minerai à la fonderie, éloignée d'environ deux kilomètres. Cette mine ne suffirait pas à elle seule pour alimenter les hauts-fourneaux : celle de Bouxières-aux-Dames supplée à son insuffisance.
_____ Fonderie. _____
….............La fonderie de Frouard a été établie en 1864. La société qui la dirige est la société de Montataire.
….............Elle est établie presque en face de la gare, à l'extrémité du canal qui joint la Moselle au canal de la Marne-au-Rhin, sur la rive gauche de la Meurthe. Elle comprend 3 hauts-fourneaux dont 2 seulement sont allumés et occupent environ une centaine d'ouvriers. [page 111]
….............Elle s'alimente de minerai dans deux endroits, comme nous venons de le dire ; mais elle n'a pas autant d'importance que celle de Pompey. Il y a environ deux ans, elle a été un certain temps, par suite du manque d'écoulement de sa fonte, qu'elle n'occupait qu'une quarantaine d'ouvriers.
_____ Chaudronnerie. _____
….............La Chaudronnerie a été fondée en 1871. Elle n'occupe pas de bâtiments bien spacieux, mais en revanche elle a à proximité deux voies pour écouler ses produits et lui amener les matières premières nécessaires pour l'alimenter.
….............Elle est en face de la gare , devant l'usine il y a le port dont nous avons parlé (page 27.).
….............Elle appartient à M. M. Munier fils, qui la dirigent. 150 ouvriers environ y sont occupés. Pendant un certain temps elle en occupait beaucoup moins, mais maintenant elle acquiert une renommée qui lui attire journellement de nouvelles et nombreuses commandes.
….............A présent elle travail beaucoup pour le montage de la Tour Eiffel.
….............Le Ministère de la Marine et des Colonies lui donne aussi de l'occupation. Beaucoup de grandes [page 112] industries : fonderies, brasseries, usines à gaz, etc, s'adressent à elle pour établir leurs machines et surtout leurs chaudières ou des tuyaux en tôle ; les compagnies de chemin de fer, le service des ponts-et-chaussées ont des ponts en fer qui sont en partie sortis des mains de ses ouvriers. Elle paraît être en bonne voie de prospérité.
_____ Tuilerie. _____
….............La tuilerie est très ancienne. Elle a dû être créée à peu près vers la même époque que le moulin. On y remarque encore la maçonnerie remontant à une ancienne date, car si elle a été perfectionnée par places, certaines parties de cette tuilerie sont encore telles et ont résisté aux injures du temps. Elle ne jouit pas d'une bien grande importance.
_____ Galocherie. _____
….............Deux nouvelles industries viennent de naître à Frouard : une galocherie et une brasserie.
….............La galocherie est entrée en fonction au commencement de mai ; elle est établie dans les locaux d'une industrie qui vient de disparaître : la Boulonnerie. [page 113]
….............Elle a amené quelques nouveaux habitants ; beaucoup de jeunes ouvriers y sont employés, ainsi que quelques jeunes filles.
_____ Brasserie. _____
….............La brasserie qui ne fonctionne pas encore est située en dehors de la commune, près du canal de la Marnes-au-Rhin, non loin de la gare dont elle est séparée par ce dernier, et sur le chemin qui conduit à la fonderie.
_____________________
_____________________
_____ Anciennes industries . _____
_____
_____ Papeterie._____
….............Il y a longtemps, une papeterie fondée en 1422 et même avant, aux environs du moulin, était en activité à Frouard. Elle fut d'abord en pleine prospérité sous la direction d'un nommé Antoine Vacot et les princes en tiraient le papier nécessaire pour leur compte particulier, pour le secrétariat du palais ducal ou pour la Chambre des Comptes. Elle subit les mêmes avaries que les moulins aux époques des inondations ; en 1507, il fallut la réparer à neuf et son exploitation fut suspendu pendant un an. Jusqu'en 1540 [page 114] les registres font mention des dépenses pour chaque année pour cette usine. Elle fut détruite vers cette époque, car les registres jusqu'en 1567 renferment toujours cette note : « La papellerie de Frouard est arruynée dès longtemps. »
_____ Fabrique d'armes . _____
….............Les comptes du Trésorier général de Lorraine pour les années 1596 et 1597 révèlent l'existence dans cette commune d'une quatrième branche d'industrie dont on n'a pu recueillir que les quelques notes suivantes : « Payer à Claude Régnier, forgeur de mousquets et canonnier demeurant à Frouard, la somme de 100 frcs pour façon et fourniture de 4 canons de forges qu'il a délivrés en l'arsenal de Nancy. » __ Au même « 57 Frcs à lui ordonnés à raison de certaine quantité de fort longues arquebuses de chasse qu'il a charge et commandement de faire parachever pour le service de Son Altesse. »
__ « Encore à lui 55 Frcs pour 2 canons, longs de 8 pieds chacun, que, du commandement de Son Altesse il a forgé, délivré en l'arsenal de Nancy.
….............Enfin en 1873 une verrerie s'était installée dans les locaux qu'a occupés la Boulonnerie et qu'occupe maintenant la Galocherie. Ainsi, dans une quinzaine d'années, trois industries se sont succédé à cette place.
Un plan de la commune de Frouard accompagnait cette monographie mais il ne figure plus dans le cahier.
--------------------
Document conservé à la Bibliothèque Municipale Stanislas de Nancy
Cote
www.reseau-colibris.fr
www.kiosque-lorrain.fr
..

