





- Mamie, tu devrais écrire tout ce que tu nous racontes.
- Mes pauvres enfants, je ne suis pas un écrivain !
- C'est une chose de raconter un épisode de sa vie, mais c'en est une autre de relier tous ces souvenirs tristes ou amusants qui se bousculent parfois dans ma tête.
Ma mémoire qui ne fut jamais brillante emmêle souvent les faits et les dates dans un kaléidoscope qui me donne le vertige.
- Ça ne fait rien, mamie, écris pour qu'on se souvienne plus tard.
- C'est vrai que j'aimerais parfois écrire ce qui me passe dans la tête, pour que vous compreniez tout ce qui, en soixante ans, a fait basculer ma génération, d'un monde que je croyais paisible, dans cet univers chaotique et parfois terrifiant ! Je vais essayer pour vous de renouer quelques fils qui, peut-être, reformeront la trame de mon passé.
Je suis née en 1925, l'année du charleston, l'une de ces fameuses années folles de l'après-guerre.
La France pansait ses plaies, essayait d'oublier les horreurs de l'hécatombe. Mais les plus pauvres n'en étaient pas encore remis.
Mes jeunes années ont été bercées par les récits de guerre de mes parents et grands- parents.
Maman était née en 1903, près de Varennes en Argonne, de sinistre mémoire, dans cette région mise à feu et à sang, où tant de villages furent anéantis, où des milliers de poilus ont trouvé une mort atroce.
Un jour, je la trouvai en larmes, lisant un numéro du "Petit Écho de la Mode". Un poète oublié de nos jours, Charles Vildrac, s'était reposé un soir, après la bataille, dans une maison de Montblainville qui aurait pu être celle de grand-mère, et se souvenait en ces strophes
Maison, maison de Montblainville, Maison, maison de Montblainville, |
Et maman pleurait en disant à ma grand-mère : "c'était peut-être chez nous". Car ils avaient dû fuir, en laissant derrière eux, maison, bétail, souvenirs, tout ce qui était leur vie.
Ils ont marché ainsi jusqu'à Saint-Dizier, en Haute-Marne, où ils sont restés jusqu'en 1916. Maman était très fière d'y avoir passé son certificat d'études, avec mention bien et savait encore la récitation patriotique qui lui avait valu les félicitations du jury. Un récit de guerre comme il y en avait tant. Pour nous, les "boches" étaient de vrais ogres qui coupaient les mains des enfants et brûlaient les maisons. Les images d’après-guerre les représentaient ainsi à nos yeux terrifiés.
Ma grand-mère maternelle, née en 1871, en rajoutait avec les souvenirs de ses parents déjà sinistrés de l'autre guerre.
 |
Pauvre grand-mère, sa vie n'avait été qu'une suite de malheurs. Pourtant elle ne se plaignait jamais, mais étant très dure pour elle-même, elle l'était aussi pour les autres, ne supportant ni la paresse, ni les jérémiades. Malgré cela, on la respectait et on l'aimait pour son courage. Elle s'appelait Gabrielle, pour nous, c'était mémère Byelle. Dans sa jeunesse, elle était tombé d'un grenier à foin, sa colonne vertébrale s'étant tassée, son corps s'était déformé, rapetissé. |
Elle portait encore la "hâlette" pour aller au jardin, comme les bonnes vieilles lorraines que Jean Scherbeck a si bien immortalisées, et de grands tabliers qu'elle confectionnait elle-même et qu'elle appelait ses "bannettes". Elle parlait toujours le patois meusien avec ses enfants. Une chose qui m'étonnait beaucoup, c'est que le tutoiement envers les parents était inconvenant en patois. Quand maman et ma tante parlaient en patois à leur mère, elles lui disaient vous, alors qu'en bon français, elles la tutoyaient.
Par contre, le plus jeune frère de maman resté célibataire et qu'on appelait familièrement le "Petiot" la vouvoyait toujours, ainsi que mon oncle Jules.
Mon grand-père Gustave était un homme grand et sec. Dans sa jeunesse, il était surnommé le "Ratapoil", parce que le dimanche, il faisait office de coiffeur pour gagner quelques sous.
A l'encontre de sa femme, il manquait de volonté et se laissait entraîner à boire plus que de raison. Quand il touchait sa quinzaine, il s'arrêtait au café, à la sortie de l'usine chez le père Dambach. Que de fois je l'ai vu, rentrer ivre, chantant à tue-tête :
Ma Gabrielle -el-le.
Elle est si belle-el-le.
Mais sa Gabrielle ne se laissait pas attendrir, et le retour devenait orageux. Alors, souvent, se redressant debout sur sa jambe gauche, il pliait le genou droit et, essayant d'y poser son coude, il bégayait :
Tout homme n'est point ivre toutefois qu'il peut dire, boit barbe blanche, boit barbe bleue, boit barbe grise. Inutile de dire que cela s'achevait dans un méli-mélo de bois be-be-be bois ba-ba-ba-, et l'équilibre bien compromis s'il n'y avait eu quelques bras secourables pour le maintenir.
Il faut dire qu'à cette époque, la vie était très dure pour l'ouvrier. Il faisait les trois huit : une semaine quatre heures à midi, une semaine midi huit heures puis de nuit, huit heures quatre heures du matin.
Pas de congés payés. Retraite à soixante-cinq ans. Mon grand-père Gustave est mort à soixante-quatre ans d'une congestion cérébrale, ayant travaillé jusqu'au bout.
Je n'avais que huit ans et j’étais bouleversée de voir le docteur lui poser des sangsues derrière les oreilles pour lui sucer le sang. Mais je restais quand même près de lui car il m'appelait souvent.
 |
J'étais la plus jeune de ses cinq petits-enfants, et la seule fille. Il m'adorait et je lui rendais bien son affection. Sa mort a été un grand choc pour moi. |
Ainsi la rencontre de mes parents est due à ces deux guerres qui, à quarante ans d'intervalle, a fait émigrer deux familles pour les mêmes raisons.
Les guerres ont ainsi des issues imprévisibles qui modifient la trame des familles.
En 1914, la famille de maman s'est désintégrée. Une partie a émigré dans le Gard, où elle a fait souche. D'autres sont en Normandie, quelques uns sont revenus au pays. De tous ces cousins germains qui se connaissaient, s'aimaient, entretenaient des relations amicales, ne restent que des arrières petits cousins qui ne se connaissent plus. |
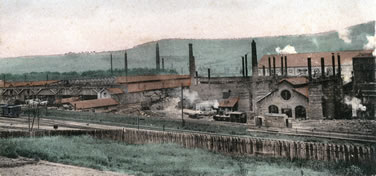 |
Tous étaient nés à Pompey ; puis la famille s'était déplacée à Dieulouard quelques années plus tard. Mon père évoquait souvent sa jeunesse à Dieulouard, où il était enfant de chœur. Ils habitaient face à l'église dans une maison qui appartenait à une vieille demoiselle, Mlle Rêche. Elle tenait l'harmonium aux offices et apprenait des chants et des saynètes aux enfants. Ma tante Renée, née en 1906 se souvient encore d'avoir chanté à cinq ans :
Bébé quand tu te marieras
Ton pouce encore tu suceras
Un jour son père, prenant le train pour Nancy l'emmena avec lui. Elle venait d'avoir six ans depuis quelques jours et il pensait profiter encore pour elle de la gratuité du voyage. Le contrôleur venant à passer, demanda l'âge de la gamine. Mon grand-père répondit qu'elle allait avoir six ans, alors se redressant fièrement, elle s'écria :
- Mais non, je les ai déjà !
Et le grand-père tout piteux de son mensonge dût payer sa place. Pour le contrôleur intransigeant, pas question de passe-droit, même pour quelques jours. Service ! Service !
Quand éclata la guerre de 1914, la famille avait réintégré Pompey, suivant les déplacements du père pour son travail. Mais en 1917, mobilisé, il fut affecté à Decazeville, où il vécut seul quelques mois. Lorsqu'il put trouver un logement décent, ma grand-mère alla le rejoindre avec ses quatre enfants. Partis de Nancy le dimanche matin, ils arrivèrent à Decazeville le jeudi, exténués par ce voyage. On était bien loin du T.G.V. à cette époque.
Ma tante Marguerite se souvenait très bien que sa mère, ayant eu vent d'une liaison pendant ces quelques mois de solitude, avait administré à sa rivale une solide raclée dont elle se souviendrait longtemps.
Le voyage n'avait pas dégoutté ma grand-mère. Au retour, elle fit, avec ses quatre gosses un "petit détour" par Paris, pour rendre visite à sa tante Marie, sœur de mon bisaïeul. Victor Baudran.
Ils ne revinrent donc qu'en 1919, à la fin de la guerre, et s’installèrent dans les cités de l'usine près de la gare. Dans ces mêmes cités où habitaient mes grands-parents maternels, depuis leur retour de Saint-Dizier |
 |
et la grand-mère grommelait :
- Tiens voilà Saint Roch qui siffle son chien.
A 19 ans, ils en avaient assez de s'attendre et se sont arrangés pour forcer la main des parents. C'est ainsi que maman parlait pudiquement de ses amours dont mon frère fut le premier fruit, trois mois après leur mariage.
Elle a eu le bonheur de fêter ses noces d’or en 1973, quelques mois avant d'être emportée par un cancer à 70 ans. Elle était toujours restée l'avocat des amours précoces, mes fils en savent quelque chose.
Voici donc Georges et Georgette, même âge, même poids, même taille, appelés familièrement le Jo et la Zette par leurs amis, qui partent habiter Frouard, la ville voisine. Ils vécurent leur lune de miel dans une pièce unique au fond d'un couloir, chez une vieille demoiselle, Mlle Joséphine, vénérablement restée dans la mémoire des vieux frouardais de la rue du Fort Joli, dite rue des canards.
Cette mégère ne voulait entendre aucun bruit, et mon frère jouait dans un grand placard pour ne pas la gêner.
C'est dans cette pièce que je suis née un soir d'octobre 1925 particulièrement froid. Il avait neigé et Madame Masson la sage femme, venue à pied de Pompey, était transie et paraît-il de bien mauvaise humeur.
Je n'avais que quelques mois quand mes parents sont venus loger à Pompey, dans cette cité numéro 110, au pied des hauts fourneaux où ils sont restés quarante ans.
Ainsi, Robert et moi nous avions nos grands-parents tout près de nous, les uns à gauches, les autres à droite ; c'est peut-être ce fait qui m’a laissé au cœur un amour très profond de la famille, un besoin de relation entre tous ses membres. L'unité familiale, le réconfort moral qu'elle peut procurer ont toujours été pour nous tous plus importants que tout l'argent du monde. C’est la vraie richesse, celle du cœur. Si tous les enfants du monde connaissaient ce bonheur, leur vie en serait transformée.
Je revois encore mon grand-père paternel, pépère Antoine. Je n’avais que quatre ans quand il est mort mais je me souviens très bien de lui. Il avait des moustaches à la Brassens.
Il aimait ressemeler les chaussures sur une forme en fonte et tout en travaillant, il chantait. Je me rappelle un petit bout de chanson :
Je n'suis qu'un pauvre ou-vé-re-rier
Qui ne demande qu'à travailler
L’ou-vé-re-rier devait me sembler bizarre, puisque ce seul passage m’est resté en mémoire. Il avait une belle voix de basse, et dans les réunions de famille ou d'amis on demandait toujours une chanson à l'Antoine.
Nous étions presque voisins, et chaque fois que je l’entendais chanter, j’accourais près de lui.
Ces cités bordent encore la route nationale qui relie Nancy à Metz. Elles ont bénéficié de bien des améliorations depuis mes jeunes années.
On entrait alors de plein pied dans la cuisine carrelée, la pièce à vivre de toute la famille, tout à la fois salle à manger, chambre à coucher, cabinet de toilette, salle de jeux et d'étude, séchoir à linge, et j’en passe...
Éclairée d'une seule fenêtre, elle mesurait environ 5 m sur 4. Au fond, une alcôve clôturée de grands rideaux rayés abritait le lit de mes parents.
L'évier, c'était la "pierre à eau", un carré gris de cinquante centimètre percé d’un trou surmonté d’une glace, car il n’y avait pas d’autre endroit pour faire sa toilette.
Tous les mercredis et samedis, on remplissait d'eau une grande bassine de fer, dans laquelle on nous lavait.
Ces soirées toilette étaient un rituel. Nous courions pour rentrer de l'école sachant que le bain nous attendait. Maman nous lavait de la tête au pied, puis bien frottés et réchauffés, on avait droit au grand bol de chocolat avec des tartines ou du gâteau. Maman chantait en nous lavant. Elle chantait beaucoup, elle avait tout un répertoire de chansons, parfois tristes comme "l'hirondelle du faubourg" ou les "roses blanches" de Berthe Silva ; toute une kyrielle de chansons de guerre, et bien sûr, des chansons d'amour "Je connais une blonde", "La petite Lili", "La femme aux bijoux", "Sous les ponts de Paris". J'ai tout son répertoire et je les sais encore.
Sur la grosse cuisinière en fonte trônait souvent une lessiveuse que maman transportait ensuite sur une brouette jusqu'au lavoir voisin. Ce lavoir, où l'hiver, il fallait casser la glace pour pouvoir rincer le linge, les doigts bleuis de froid. Comment peut-on parler maintenant de lessive à faire ? Et le linge lavé, il fallait bien le sécher ! Mais où donc ? Dans la cuisine, au-dessus de nos têtes, bien-sûr, car le grenier n'étant pas mansardé, il était impossible d'y mettre quoi que ce soit, une poussière noire comme de la suie s’infiltrait entre les tuiles et le balai menait une lutte incessante et inefficace contre cet envahissement.
En été, on étendait le linge dans un petit jardin situé en contrebas des cités. Quand le vent venait de l'ouest il fallait recommencer le rinçage, à cause de la poussière noire de l'usine.
Chaque ménage avait son petit lopin de terre qui descendait en pente douce jusqu'à la ligne de chemin de fer et l'usine.
Dans cette horizon peu bucolique, on parvenait à cultiver quelques légumes et même quelques fleurs qui semaient leurs touches de couleur ici et là sur fond de haut fourneaux. J'en ai passé de bonnes heures dans ce jardin, avec mémère Byelle qui adorait jardiner. Mais revenons à la maison. Face à la porte d'entrée, un escalier menait à l'unique chambre que je partageais avec mon frère. Nous y avions chacun notre lit, réchauffé en hiver par une brique chaude. Nous montions le soir avec une veilleuse, une petite rondelle de liège munie d'une mèche flottant sur un verre d'eau. Maman montait un peu plus tard pour border notre lit et souffler la veilleuse. Parfois elle s'asseyait près de nous et chantait des berceuses :
À côté de ta mère, fait ton petit dodo
Sans savoir que ton père s'en est allé sur l'eau
La vague est en colère et murmure tout bas
À côté de ta mère fait dodo mon petit gars
Ou encore :
Je connais un bon petit vieux qui vient le soir jeter du sable
Dans tous les pauvres petits yeux des enfants qui sortent de table
Le vieux dans son sac faisait crack, crack, crack...
Entrez entrez bon petit vieux, dit la maman, mon fils sommeille
Je vois des larmes dans les yeux du pauvre qui souffre et qui veille
Le vieux dans son sac faisait crac, crac, crac...
Quand il gelait, les fenêtres étaient fleuries le matin de belles arabesques glacées et nous soufflions dessus pour y gratter de petits trous.
Mais le froid nous incitait bien vite à descendre nous réchauffer près de la grande cuisinière bien rouge. Nos vêtements pliés le soir à proximité du foyer gardaient une douce tiédeur. Ça sentait bon le café et le pain grillé.
L'éclairage de la cuisine consistait en une suspension munie d'un manchon à gaz, qu'un employé venait changer périodiquement. Maman brodait des dessus de lampe pour faire plus joli.
Une lampe à pétrole, posée sur la cheminée, subvenait en cas de besoin. Par exemple pour descendre à la cave, à laquelle on accédait par un escalier de pierre aux marches inégales et cabossées, sur lesquelles j'ai failli me tuer à l'âge de trois ans, en voulant suivre mon père pour voir les "tits lapins". Mais oui ! Bien que ce soit défendu, nous élevions quelques lapins dans la cave ; ce qui permettait d'améliorer l'ordinaire à peu de frais, en utilisant épluchures, croûtes de pain et quelques paniers d'herbe. Nous n'étions, bien sûr, pas les seuls, chacun essayant de se débrouiller pour joindre les deux bouts.
Mes parents achetaient peu de chauffage, seulement quelques sacs de briquettes pour tenir le feu la nuit. Tous les matins, quand papa travaillait de midi à huit heures, ils allaient gratter sur le crassier de l'usine les morceaux de coke encore bons à brûler, les escarbilles.
Quand c'était la semaine de quatre heures à midi, mon père aidait des bûcherons qui faisaient des coupes. Et nous avions ainsi, grâce à leur travail, de quoi nous chauffer. C'était des courageux, mes braves parents !
Nous n'avions pas l'eau sur l'évier. La fontaine la plus proche était à cinquante mètres, de l'autre côté de la route, et nous faisions souvent la corvée d'eau, mon frère et moi. Parfois, la fontaine faisait des caprices et s'arrêtait de couler. Il fallait alors aller jusqu'à la gare, qui se trouve en contrebas, face à l'usine, environ 200 mètres à parcourir, puis un grand escalier flanqué d'une rambarde en bois. Ce n'était pas une mince affaire que de remonter avec le seau plein d'eau et l'on faisait plus d'une halte. J'y pense encore souvent quand j’entends l’eau couler ici et là dans la maison. Les W-C, la douche, l'évier, la buanderie, la machine à laver et je n'ose m'imaginer combien de corvées cela représentait il y a cinquante ans. Mais on l'utilisait alors avec parcimonie. L'eau de la toilette quotidienne servait à laver le carrelage et à rincer les cabinets.
Les cabinets ! Quel poème ! Chez nous on disait les cabinets, pour les plus mal embouchés, c'était les chiottes ! Et je reconnais que ce nom leur convenait mieux. Imaginez un appentis en brique, long de quatre mètres, profond de un mètre cinquante, accolé au mur latéral de la citée. Cet appentis était partagé en quatre cabinets à la turque, deux marches, un trou, c’est tout. Un cabinet pour deux familles, c'est dire qu'il fallait souvent attendre son tour. Et le pire, c’était la corvée des tinettes. Il fallait bien avoir un seau hygiénique qui trônait à la cave et qu’il fallait vider chaque matin, avec un broc d’eau javellisée pour le rinçage ; la pire des corvées. Et ces cabinets ont survécu jusque dans les années soixante. En 48. jeune mariée, j’ai vécu encore deux ans dans les cités avec cette corvée journalière.
Tous ces détails un peu sordides pourraient donner à penser que j’étais malheureuse. Pas du tout ! J’aimais les cités, c’était mon horizon et nous étions toute une équipe de gosses heureux. Nous inventions des tas de jeux et surtout, nous avions la forêt toute proche. En cinq minutes, nous passions de l’univers tristounet de l'usine, à celui de Tarzan et des singes grimpeurs. Que d'escalades, de courses, de glissades nous avons pu faire dans ces bois. Au printemps, nous rivalisions à qui ferait le plus gros bouquet d'anémones, de pervenches, de coucous, et de jacinthes bleues. En été, c'était la cueillette des mûres, puis des noisettes.
En hiver, c'était les longues glissades sur une planche, pas besoin de traîneau ou de luge pour jouir de la neige. Et les batailles de boulettes, les bonshommes de neige, ça, c'est toujours le bonheur des gosses, un plaisir gratuit, sain, dispensé par la nature pour la joie de tous. Maintenant, je regarde cette neige avec un peu de nostalgie, en gardant ma sciatique à l’abri du thermolactyl et en chantonnant la chanson de Botrel :
Les douleurs sont des folles
Et qui les écoute est encore plus fou
Aux beaux jours, nous organisions des défilés costumés ; soit au mardi gras, où pour des parodies de noces. Je nous revois, Dédé, Jeannot, Jojo, Robert, Odette, Suzon, Colette et bien d'autres. Ayant dévalisé les nippes, rubans, dentelles, tout ce qui pouvait servir à nous déguiser. Nous parcourions tout le quartier en chantant à tue-tête.
 |
Chanter ! Ça fait tilt dans ma tête et dans mon cœur. Chanter, cela faisait déjà partie de ma vie grâce à maman, mais le grand plaisir, le régal attendu, c'était le passage des chanteurs de rue. C’était le plus souvent un accordéoniste accompagné d’un chanteur ou d’une chanteuse qui vendait les succès du jour. |
Les faits divers les plus marquants étaient mis en chanson. Depuis l'exploit de Nungesser et Coly dans "l’oiseau blanc", jusqu'au crime de Violette Nozières et la catastrophe de Lagny dont je me souviens certains passages qui m'horrifiaient :
Quand tout à coup le grand monstre d'acier
Vint semer l'épouvante Semant
bientôt sous lui les voies mourantes
Aux plaintes des blessésNoël ô triste Noël, quel destin cruel
Pour les pauvres mères
Les cloches sonneront demain
Le triste tocsin, des pleurs, des misères
À tout jamais séparés des êtres aimés
C'est bien trop terrible
Car là-bas la mort est passée
C'est horrible
J'ai préféré un peu plus tard le "Parlez-moi d’amour" de Lucienne Boyer, et surtout les premiers succès de Tino Rossi, en particulier "Marilou", parce que dans nos cités, vivait une famille Loup dont la fille s'appelait Marie. On l'avait surnommée la Loupette.
Pour moi, Marilou, c'était elle, et je m'émerveillais qu'on ait pu lui dédier une chanson. En évoquant dernièrement de vieux souvenirs avec ma cousine Jeannette, j'ai eu la surprise d'apprendre qu'elle n'avait jamais vu ces chanteurs parce qu'elle habitait plus loin, en dehors de la route nationale.
J'étais donc doublement privilégiée, profitant de tout ce qui passait. J’habitais juste en face d’une petite place, rendez-vous de toutes les attractions. Je me souviens encore de certaines scènes qui m'ont fait pleurer ou trembler de peur. D'autres fois, c'était des gens de la balle, des petits cirques itinérants, quelques acrobates, un clown, des singes, quelques chevaux. Quelle joie de les voir s'installer ! Un autre monde nous ouvrait ses portes. On les imaginait venant de pays lointains, inconnus. On tournait toute la journée autour de leur campement pour les apercevoir. Leur départ, laissant la petite place vide et nue emportait un peu de rêve, nous laissant tristes et désemparés. |
 |
Je me souviens à propos de ces gitans d'une petite aventure arrivée à un gamin. Fils d'un contremaître voisin, sa maman aimait le voir toujours propre et bien vêtu. Un jour, il s'était aventuré un peu loin de chez lui et s'était égaré. Il avait dû se livrer à des jeux un peu violents avec des amis de rencontre, ses vêtements étaient sales et déchirés et une brave dame, le voyant désemparé, l'a pris par la main et ramené chez les gitans, pensant que c'était l'un de leurs enfants. Ébahissement de sa maman en le retrouvant assis sur les marches de la roulotte.
Nous retrouvions bien vite nos jeux coutumiers. Le plus simple de ces jeux étant de nous asseoir sur les troncs restés après l'abattage des arbres qui autrefois bordaient la route, et nous comptions les voitures qui passaient, tout en jouant au yoyo.
Plus tard, on nous fit des trottoirs sur lesquels on dessinait des jeux de marelles, ou bien la corde à sauter nous entraînait dans une "vinaigrette" éperdue jusqu'à ce qu'un faux pas coupe l'élan victorieux des plus rapides.
J'allais souvent jouer chez des voisins dont les enfants étaient plus âgés que moi et s'amusaient de mes bêtises.
Un jour le voisin partant au travail, me vit assise sur son escalier, un doigt dans le nez, et me dit :
- Alors, tu nettoies les écuries parce que la cavalerie va passer ?
Je le regardai éberluée, et quand il revint en fin d'après-midi, j'étais toujours assise sur l'escalier, guettant la cavalerie.
Ou bien il me disait :
- Tu sais, chez nous, derrière les armoires, c'est tapissé de billets de "manque".
Et moi je disais à maman :
- Tu sais, les Baudot, y sont riches. Y a plein de billets derrière leurs armoires.
Quand il pleuvait, notre cuisine devenait salle de jeu. Dans mes toutes jeunes années, maman m'installait sous la table pour ne pas me trouver constamment dans ses jambes. Mon jouet préféré, c'était une boite de boutons que je triais par couleur et que je disposais en figures diverses. Je n'avais que 3 ou 4 ans, mais je m'en souviens très bien ; il m’en est resté un goût pour les jolis boutons.
J'aimais aussi beaucoup dessiner à plat ventre sur ma couverture, à l'abri de la table, j'inventais des paysages de rêve. Parfois, j'en avais assez de cette immobilité et je tirais les pieds de mon frère, qui dessinait lui aussi, assis devant la table. Et c'était la bagarre, comme dans toute fratrie normalement constituée et qui se terminait parfois par une fessée magistrale, car j'étais très coléreuse et plus vindicative que mon frère. Ou bien j'étais menacée du martinet, destiné surtout à faire peur et qui n' a servi qu'une seule fois, un seul petit coup avait suffi à zébrer ma peau et maman était plus malade que moi.
L'hiver commençait pour nous par la fête de Saint-Nicolas. Le soir du 6 décembre, nous mettions deux plats sur la table et nos chaussons dessous, avec un peu de paille pour la bourrique. On entendait dans le quartier le son d'une clochette, nos parents entrouvraient la porte pour que nous apercevions le saint à barbe blanche avec sa mitre et sa crosse, faisant vers nous un geste de bénédiction. Il était suivi d'un vilain père Fouettard tout noir, une trique à la main, chargé d'une hotte et proférant des menace envers les enfants méchants. Cramponnée à la jambe de papa, je tremblais de peur en pensant à mes dernières colères et je promettais de ne plus recommencer.
Le lendemain matin, nous trouvions dans nos plats des oranges, des mandarines, des dattes, quelques chocolats et un beau Saint-Nicolas de pain d'épices. Dans nos chaussons, un jouet ou un vêtement.
Je me souviens de ma première poupée. Elle était en carton peint, toute simple, mais pour moi c'était la plus belle des poupées. Je l'appelais Nicolas.
Pauvre Nicolas, que sa vie fut courte ! Quelques jours plus tard, je jouais chez une petite amie plus chanceuse qui avait une poupée de porcelaine. Elle lui donnait un bain et, bien sûr, pourquoi ne l'aurais-je pas imitée ? Sitôt dit sitôt fait, ma Nicolas rejoignit dans la bassine sa jolie congénère. Quel désastre ! Quand je ressortis de l'eau cette masse informe et dégoutante, je courus en larmes dans les bras de maman qui eut beaucoup de mal à me consoler, et surtout à m'expliquer pourquoi, seule, ma poupée n'avait pas survécu à ce traitement. Quelle injustice ! Il est vrai que la poupée de porcelaine avait perdu ses couleurs roses, mais tout de même pour moi c'était l’apprentissage de la différence des classes. Je n'ai plus voulu de poupée en carton mais j'ai dû attendre quelques années avant de tenir dans mes bras une poupée de porcelaine, qui, elle aussi, a son histoire.
A l’âge de huit ans, le docteur ayant décelé une scoliose m'envoya en stage à l'hôpital. Il était question de m'opérer, et quand maman m'a emmenée à Nancy pour entrer au pavillon Virginie Mauvais, j'avais très peur et maman retenait ses larmes.
Nous avons d'abord fait quelques emplettes en ville, et tout à coup, je suis tombée en arrêt devant une vitrine où une poupée de porcelaine me tendait les bras. Je suis honteuse d'avouer que j’ai fait du chantage, hé oui ! J’irais à l’hôpital, mais avec la poupée.
Ma pauvre mère est entrée dans le magasin, mais la poupée était trop chère. Me voyant pleurer, la vendeuse a fait un gros rabais sur la poupée, parce qu’elle avait quelques tâches sur les joues dues à son séjour en vitrine.
C’était encore un peu cher pour maman mais elle était si heureuse de me l'offrir.
Je me vois encore entrer dans le grand dortoir avec ma fille serrée sur mon cœur. J’ai promis à maman de ne plus pleurer et j’ai tenu parole. Je crois même que cette histoire m’a servi de leçon, car au fond de moi, je n'étais pas fière de ma victoire. Je n'ai plus jamais fait de chantage à la pitié.
Finalement, après bien des examens et des discussions, je n'ai pas subi d'opération (mais il a fallu faire une greffe trente ans plus tard, les techniques étant plus avancées).
Le bon vieux professeur Froelich m’aimait bien parce que j’étais pleine de bonne volonté. J’aurais fait n'importe quoi pour guérir. Un jour, j'ai passé un examen dans un amphithéâtre. J'étais entourée d'internes et le professeur leur expliquait sur mon dos la gravité de la scoliose en suivant la colonne vertébrale de son doigt. Moi, je cramponnais des deux mains ma petite culotte bateau et je serais les lèvres d'un air fâché. Alors, il s’est mis à rire, m'a pris le menton et m'a dit, en me regardant bien dans les yeux :
- Écoutes-moi bien, ma petite. On ne peut pas t'opérer, c'est trop risqué. Si tu ne fais pas ce que je te dis, tu seras bossue à vingt ans. Mais si tu as de la volonté, tu auras une chance d'éviter cela.
C'est alors qu'a commencé pour des années une école de discipline. Gymnastique sur barres, élongations, suspension par le cou pour tendre la colonne vertébrale. J'allais à la salle d'appareillage de l’hôpital tous les deux jours. Puis mes parents ont loué l'appareil pour que je fasse les exercices chaque jour à la maison. C'était un système de cordes et de poulies avec des poignées. Une mentonnière de cuir où je posais ma tête et en tirant sur les poignées, j'étais suspendue par le cou. Je serrais les dents et je tenais le plus longtemps possible jusqu'à devenir violette, parce que je ne voulais pas devenir bossue. Plus tard, ayant des ennuis avec mes gencives, j'ai appris que ces ennuis pouvaient provenir de cette compression des mâchoires. Et je le paie encore !
Un autre supplice fut celui du corset. Comme un moule, avec des baleines d'acier au dos et aux côtés, des béquillons sous les bras réglés par des lanières de cuir qui se croisaient au dos et se fixaient sur les côtés, plus ou moins loin en grandissant, car je l'ai porté quelques années. Il était recouvert de peau à l'intérieur. Quand on le posait sur une chaise, c’était comme un sarcophage.
Quand je me suis mariée, j'en avais encore la marque sous les bras. J'ai vraiment souffert avec cet engin. J'avais beau mettre du talc, j'étais souvent écorchée. Surtout, je ne voulais pas que cela se voit trop et je me comportais comme les autres autant que possible. Mais certains mouvements me causaient de la gêne et souvent des ecchymoses. Mais grâce à cela, je n'étais pas bossue à vingt ans. J'ai même pu faire de la gymnastique et de la danse sans trop de problèmes. L'échéance n'était que reportée, mais, à cette époque, je n'en savais rien. Je me croyais quitte pour toujours de toutes ces misères. J'aimais le sport, la marche, la danse rythmique.
Toutes ces digressions sont dues à la triste fin de ma pauvre Nicolas. Paix, non pas à ces cendres, mais à sa bouillie de carton.
Si la Saint-Nicolas était pour nous la fête des friandises et des jouets, même modestes, Noël n'était pas alors la débauche de lumière et de tapage que l'on connaît de nos jours. C'était seulement la crèche, faite d'une simple petite cabane bricolée par mon père, un petit Jésus, une vierge et Saint-Joseph, auxquels sont venus s'ajouter au fil des ans quelques bergers avec leurs moutons, puis un ange et les rois mages. Pas de sapin, nous n'avions pas assez de place.
Le soir de Noël, nous faisions la veillée tout en grillant des marrons. Grand-mère Byelle faisait des gaufres en chantant : "Minuit, chrétiens". Elle nous apprenait aussi : "Les anges dans nos campagnes", "Il est né le divin enfant". Maman faisait des gâteaux roulés en bûches, dont on se régalait au retour de la messe de minuit, avec un bon chocolat.
La joie de Noël ! Elle était simple, chaleureuse et fervente. Quand je vois maintenant notre crèche (ce sont toujours les mêmes personnages gardés précieusement) disposée au pied d’un grand sapin chargé de boules et de guirlandes, entourée de cadeaux joliment enrubannés, je ne retrouve plus autour d'elle cette ferveur un peu naïve que je regrette. Et je me dis que c'est peut-être un peu de notre faute, à nous les parents. Il y a eu quelque part un dérapage. Quand mes enfants étaient petits, je chantais avec eux des airs de Noël en préparant la crèche. On mettait aussi des disques d'ambiance, mais petit à petit, cette coutume a disparu, comme tant d'autres.
Chanter un cantique devant la crèche ! Ça ne se fait plus. Alors je rêve un peu, je sens l'odeur des gaufres et des marrons grillés, j'entends grand-mère chanter "Minuit chrétiens” et je chante dans ma tête.
Heureusement, il nous reste la réunion de famille, le bonheur d'être ensemble. Les cadeaux sont des gages d'affection et souvent des colis surprise qui donnent une ambiance bien agréable. Mais toujours, je pense aux Noëls passés, aux places restées vides de ceux qui nous ont quittés et dont on ressent plus douloureusement l'absence en ces jours de fête.

|
J’avais des parents formidables, d'une générosité sans limite. Dans les cités, chez la "Georgette", c’était la maison du bon Dieu. Nous vivions pratiquement porte ouverte, cette porte étant providentiellement face à l'arrêt d'autobus. Quand il faisait froid ou qu’il pleuvait, il n'était pas rare que plusieurs personnes viennent s'abriter. Les gens des pays voisins qui venaient en bicyclette pour prendre le bus de Nancy nous laissaient leur vélo à garder jusqu'à leur retour. Quand il neigeait, maman les rentrait dans la cuisine, promue garage à l'occasion.
|
- Qu'est-ce que tu veux, avec ces quatre gosses, elle a encore plus de mal que nous.
J'ai toujours regretté l’ambiance des cités. Il y régnait une entraide mutuelle, une convivialité fraternelle. Nos plus proches voisins étaient des personnes âgées. Souvent, les soirs d'hiver, mon père frappait au mur pour qu'ils nous rejoignent. Ils aimaient jouer aux petits chevaux. La pauvre vieille ne voyait plus bien clair, alors elle avait adopté les chevaux violets sur lesquels on avait collé une collerette blanche pour mieux les repérer. Elle les appelait ses "légionnaires".
Derrière chez nous, habitaient la Marie et le Polyte. Leur alcôve et celle de mes parents n’était séparée que d'un mur et plus tard quand maman a été malade et que mon père travaillait la nuit elle frappait au mur en cas de malaise. La Marie arrivait pour rester avec elle pendant que je courrais chercher le docteur. (Quand je relis ces lignes, en 1994, j’ai de la peine pour cette pauvre Marie qui végète à l’hôpital, les deux jambes coupées. Son Polyte est à la maison de retraite en face et pleure chaque fois qu'il me voit).
Les soirs d'été c'était le couarail. On se réunissait entre deux cités, chacun apportant sa chaise. Le grand Mimile racontait des histoires à se tordre de rire. C'est là que se commentaient les événements du jour. Je me souviens encore des remous soulevés par les premiers cheveux courts. Il fallait être courageuse pour être au goût du jour et ne pas craindre le qu'en dira-t-on ! Les plus coquettes bravaient crânement les coutumes, en l’occurrence les chignons bien plantés sur les têtes récalcitrantes.
Et les discussions politiques ! Dans les années 1930 au temps de Blum, député de gauche et La Roque de droite, président des "croix de feu", nous avions une vieille demoiselle, la Mélie, qui gérait une succursale de la "Ruche Ouvrière". Elle ne cachait pas son penchant pour la droite, et appelait son chien Blum. Pour la contrer, une voisine avait surnommé le sien La Roque. Le plus drôle, c’est que les deux roquets se détestaient, il fallait les empêcher de se battre, et c’était un concert d'aboiements, aussi virulents que ceux de la chambre des députés. |
 |
Les marchands ambulants contribuaient beaucoup à mettre de l'ambiance ; tel ce jeune marchand de Frouard qui présentait ses fruits et légumes sur une charrette tirée par un petit âne. On l'appelait familièrement le petit "La Bourrique" et il ne s’en formalisait pas. Il était concurrencé par le père Moyau, un ancien du village, qui passait aussi avec une carriole bien achalandée en criant :
- Venez les ménagères, voyez mes pommes de terre, mes carottes et mes choux verts, ils sont beaux et sont pas chers.
Le vendredi, c'était la marchande de poisson, poussant sa charrette en criant :
- Harengs frais.
Quand le rémouleur faisait sa tournée, le bruit de sa crécelle le précédait et les gosses tiraient le tablier de leur mère pour qu'elles trouvent couteaux ou ciseaux à repasser.
Il y avait le Kaïffa, un épicier qui donnait des timbres-ristournes, avec lesquels on s'offrait ensuite de la vaisselle ou du linge. Nos succursales de la "Ruche" étaient dotées du même système, ce qui permettait aux Filles de se constituer un trousseau bien apprécié.
Le marchand de bière, limonade, soda, de Champigneulles passait chaque semaine nous livrer à domicile. Plusieurs bouchers passaient à tour de rôle et nous courrions derrière leur voiture pour avoir des rondelles de saucisson. Celui de la boucherie chevaline était surnommé le "Gros Bleu", sans doute à cause de son nez volumineux et de son teint violacé.
Sur la petite place, s'installaient chaque quinzaine des déballages qui étaient un peu le prémisse des "Tout à cent francs" actuels. Souvent aussi des marchands de tissus, car certaines mères de famille confectionnaient elles-mêmes leurs vêtements et ceux des enfants. L'école ménagère de l’usine leur avait appris à se débrouiller en ce domaine comme dans beaucoup d'autres pour faire quelques économies.
J'allais oublier quelques figures locales qui contribuaient largement à l’animation de la ville.
D’abord l'appariteur : après un roulement sonore de son tambour pour attirer du monde autour de lui, il criait :
- Avis à la population, le maire informe les habitants...
Suivaient plusieurs avis ponctués chacun d’un roulement. Après son passage, des groupes restaient souvent sur place pour discuter des dernières nouvelles.
L'autre personnage était une femme qu'on appelait la porteuse de mauvaises nouvelles. Jusque dans les années cinquante, à chaque décès, elle frappait à toutes les portes, en criant :
- Y a du monde ?
Puis elle enchaînait :
- On enterre monsieur ou madame Untel, tel jour à tel heure.
Il n'était pas rare qu'elle ajoute quelques commentaires sur les défunts. C'était une grande femme aux yeux noirs très enfoncés, un nez en bec d’aigle et une voix caverneuse. Elle me faisait peur déjà par son physique rébarbatif et plus encore par sa fonction. Elle fut remplacée plus tard par une de ses voisines qui ne détestait pas un petit verre pour se requinquer et les mauvaises langues prétendaient qu'elle avait peine à regagner son logis. J’ai gardé d’elle un souvenir particulier. En 1946, le jour même des obsèques de mon beau père, alors que toute la famille entourait ma belle-mère en larmes, elle ouvrit la porte en criant :
- Y a du monde ?
Et s'apercevant de sa bévue, elle recula en bégayant :
Au revoir messieurs dames, amusez-vous bien.
Consternation de la famille !
Après sa disparition, il n'y a pas eu de relève pour cet emploi et personne n'a regretté cette coutume.
La lecture nous était offerte à domicile par un couple bien sympathique, monsieur et madame Masson. Je n'oserai pas dire la culture ; c'était des romans populaires vendus par fascicules : "Les deux orphelines", "Le juif errant", "Les mystères de Paris".
Nous les gosses, on lisait les "Pieds Nickelés", "Bibi Fricotin”, "L’espiègle Lili", "Lisette" ou "Fillettes". Ils vendaient aussi des disques. Mon oncle célibataire, le "Petiot", avait un phonographe à pavillon. Nous allions parfois le soir chez la grand-mère pour l’écouter. On fredonnait "Ramona" avec Saint-Granier, "J'ai deux amours" avec Joséphine Baker, "J'ai ma combine" avec Georges Milton dit Bouboule, "Prosper" ou "Ma pomme", avec Maurice Chevalier. Les sketchs de Back et Laverne nous ont fait rire aux larmes.
Quelques années plus tard l'oncle acheta un poste de T.S.F., le premier dans les cités. Les soirées T.S.F. remplacèrent les soirées disques. Mon frère hérita du phonographe et commença une collection des premiers succès de Tino.
 |
Souvent les dimanches, l'oncle et la tante de Frouard venaient à la maison. Les hommes allaient quelquefois au café voisin taper la belote, tandis que les femme bavardaient en brodant ou en tricotant. Mais elles aimaient aussi les cartes et préféraient que les hommes restent pour jouer avec elles. Même la grand-mère était une enragée de la belote et les parties se terminaient tard le soir. C’est peut-être ce qui m’a rendu allergique aux cartes. J'ai trop entendu : |
Mes parents allaient quelques fois au cinéma Casino, le plus proche de chez nous. Il existe encore, reconverti en dépôt du matériel communal, il y en avait deux à Frouard, l'Excelsior et le Ciné Mary, tous deux disparus. C'était encore le cinéma muet, souvent Charlie Chaplin, parfois des films à épisode, il fallait attendre une semaine pour avoir la suite.
Maman m'a raconté qu'un jour ils étaient allés voir "Michel Strogoff", avec mon frère âgé de quatre ans. Je n'avais qu'un an et ma grand-mère me gardait à la maison. Quand mes parents sont rentrés, je dormais dans mon berceau. Maman se mit à raconter le film à grand-mère, quand tout-à-coup, elle poussa un cri et s’élança vers Robert qui, un tisonnier rougi à la main, s'avançait vers moi dans l’intention évidente de le poser sur mes yeux comme il l’avait vu faire au cinéma. J’en ai des frissons en pensant à quel supplice j'ai échappé. Comme Michel Strogoff, j'ai eu droit à mon miracle !
Quelques années plus tard, j’ai pu accompagner mes parents. C’était les débuts du cinéma parlant. Je me rappelle très bien les "Laurel et Hardy" ; "Sous les toits de Paris", avec Albert Préjean et de sa chanson ; Henri Garat dans "Trois de la Cannebière" , (Avoir un bon copain). Plus tard encore, les premiers films de Tino Rossi : "Loin des guitares". Devenue assez grande pour aller au patronage, j’allais au ciné paroissial. C'était encore les films muets dont l'abbé Ragage lisait les commentaires à haute voix.
Dans cette salle, les scouts présentaient parfois des pièces de théâtre, dont je possède maintenant quelques photos, car dans ces spectacles figurait un garçon inconnu pour moi à cette époque et qui était mon futur mari.
Les jeunes filles du patronage montaient aussi sur les planches, mais pas le même jour. On ne mélangeait pas encore les torchons et les serviettes.
Je les enviais sans savoir qu’un jour je ferais partie de ces artistes improvisées, parfois maladroites et gauches, mais toujours enthousiastes. Plus tard, je fus l’orpheline de la "Chambre mauve", puis la "Marie des gosses", et très souvent, chanteuse d’intermède.
Le printemps était inauguré à Pâques par la fête foraine du faubourg qui se tenait sur un terrain vague devenu l'actuel parking du Casino. Tandis qu’à l’automne la fête de Sainte Epvre, patron de la paroisse, sonnait le glas des vacances sur la place de l'église. C’était vraiment la fête du village. À présent, manèges, jeux et loteries, se tiennent au centre.
Mais la fête que je préférais, c’était le lundi de la Pentecôte à la ferme du Haras. |
 |
Là, sur un immense pré, et sous l’ombre accueillante à l’orée du bois, des tables et des bancs nous offraient un repos très apprécié : des balançoires, des roues tournantes pour les enfants, des jeux de quilles, même une piste de danse pour les grands, étaient pris d’assaut après le repas. On jouait aussi à la cachette dans les bois, avec les parents et les amis.
Le grand air, le soleil, le plaisir de déjeuner sous les arbres, de courir dans l'herbe, c’était un défoulement complet, la joie de vivre dans l'amitié et la liberté.
Nous y montions aussi quelquefois en famille les dimanches d’été ; ce n’était plus la grande fête, mais toujours le plaisir de se retrouver en pleine nature. On voyait les lapins courir partout en liberté, les poules, les canards. On allait voir la grosse truie et sa famille de petits gorets.
On rentrait le soir fourbus, mais heureux, une gerbe de marguerites et de coquelicots dans les bras. Cette coutume de la Pentecôte a disparu avec la guerre et c'est bien dommage.
Quand mon grand-père Antoine est mort en 1929, ma grand-mère Marie demanda et obtint la gérance d’une succursale de la ruche. Elle avait encore sa mère avec elle, mon arrière-grand-mère Pauline Baudran, et mon oncle Jean qui n’avait que 7 ans. Elle tenait à la fois l'épicerie et un café adjacent, à Malelloy. Quand la grand-mère Pauline mourut, en 1934, ne pouvant plus tenir seule les deux commerces, elle déménagea à Millery pour gérer une autre succursale.
Nous y allions quelquefois le dimanche en famille, en faisant 7 kilomètres à pied pour le départ et nous prenions le train pour le retour.
J'y passais aussi quelques jours de vacances avec ma cousine Jeannette. Quelquefois, nous partions dans la carriole de la mère Bodez, la laitière. D'autres fois, dans la camionnette de la ruche qui assurait le ravitaillement des succursales, et nous aidions avec plaisir pour la livraison des marchandises, à chaque arrêt. Dans l'épicerie, nous étions heureuses d'aider la grand-mère en pesant la marchandise livrée en vrac. On préparait des cornets de sucre en poudre, de sel, de lentilles, de pois cassés, en faisant très attention de peser juste. On remplissait les litres de vin à la cave. Bref, on ménageait les jambes de grand-mère tout en jouant à la marchande. Quelques années plus tard, elle changea de nouveau de succursale et partit à Faulx.
Cette nouvelle gérance était toute proche de la maison du député Louis Marin. Au premier étage de cette maison, la porte-fenêtre était souvent ouverte sur un grand balcon et l'on pouvait admirer une très grande cage pleine d'oiseaux. J'aurais bien aimé les voir de plus près, mais je n'ai jamais osé sonner à cette porte.
Mon jeune oncle, en grandissant, donnait bien du mal à grand-mère Marie. Il aurait eu besoin de la poigne paternelle.
Elle fut obligée de le mettre en pension chez les religieuses de Pont-à-Mousson. Je lui ai rendu visite une fois avec ma grand-mère et j’avais le cœur serré de le laisser dans cette grande maison austère. Ma grand-mère pleurait en m'expliquant qu'elle devait le faire, parce qu’en travaillant, elle ne pouvait pas le surveiller et empêcher ses mauvaises fréquentations.
Après sa scolarité, il entra aux bureaux de l'usine et apprit la comptabilité.
La grand-mère resta à Faulx jusqu'en 1942, puis revint définitivement à Pompey. Elle loua un logement au quartier Jeuyeté, près du lavoir, dans une maison aujourd'hui disparue. Quelques années plus tard, ma tante Marguerite, sœur aînée de papa, vint demeurer avec elle.
Ma scolarité avait très mal débuté. Quand j'eus mes quatre ans, maman me présenta à la garderie de l'usine, située contre l'ancienne salle des fêtes, aujourd'hui centre socioculturel. |
 |
Un jour elle se fâcha parce que je me trompais en apprenant à écrire. Je faisait mes A la queue en l'air et mes O la queue en bas. Quand elle a levé la main sur moi, je me suis dressée et j'ai crié :
- Vasse de con !
Je ne sais pas où j'avais pu entendre cette injure, car mes parents n'étaient pas grossiers, mais c'était à la mesure de ma colère. Je ne pouvais pas trouver plus percutant. Elle m'empoigna et me fit sortir, traverser la cour et descendre quelques marches d'un réduit qui était la cave à charbon. Puis, me laissant là en larmes, elle partit en fermant la porte. Imaginez ma terreur, dans le noir, je voyais un rai de lumière sous la porte et des souris qui passaient devant. Je hurlais mais personne ne m'entendait.
A onze heures, quand maman vint me chercher, la directrice l'attendait de pied ferme.
- Madame, votre Fille est à la houillère, c'est une effrontée, elle m'a appelé V de C.
La houillère ? V de C ? Maman ne comprenait pas. Alors, elles sont venues me chercher; un petit tas tout sale, noyé de larmes, noir de charbon, hoquetant :
- Vasse de con, vasse de con.
Des mots que j'ai répété pendant 9 jours de délire. J'avais une broncho-pneumonie dont j'ai failli mourir. La bonne sœur Henriette venait me soigner tous les jours et récoltait les mêmes insultes. Elle me l'a raconté bien souvent plus tard en riant à ce souvenir qui me faisait rougir de confusion.
A la suite de ce mini drame, le bon docteur Zivré se fâcha tout rouge et fit déplacer la directrice au grand plaisir des enfants et au soulagement des parents.
Mais je n'ai pas pu retourner à la garderie. La vue de l'école me terrifiait. J'ai appris mes lettres à la maison et je suis entrée à l'école communale pour mes 6 ans.
J'avais gardé la peur au ventre, refermée comme une huître, j'osais à peine lever les yeux vers la maîtresse, madame Bourdon, qui était très exigeante.
L'année suivante, ce fut tout le contraire. Madame Liégeois était une mère poule, qui nous lisait beaucoup d'histoires, et ne faisait pas beaucoup travailler.
Ce n'est qu'à 9 ans, avec madame Picot, que j'ai enfin commencé à travailler sérieusement. Elle aussi était très sévère. Elle tapait sur le bout des doigts avec une règle. Mais elle a perdu cette habitude le jour où la petite Madeleine s'est évanouie. Quelle angoisse ! La maîtresse ne savait plus que faire pour la ranimer. Je l'entends encore :
- Madeleine, ma petite Madeleine, réponds-moi.
Ce jour-là c’est elle qui a pris une leçon de prudence.
Quant à moi j’avais vaincu ma peur et je voulais être première de la classe. Je l'ai gagnée cette place et ce fut le démarrage de meilleures années scolaires ; avec des institutrices comme mademoiselle Taris, sévère mais juste, puis mademoiselle Lalevée qui avait aussi la main leste.
Cette vielle demoiselle devait avoir un foie fragile. Elle arrivait parfois, le teint jaune, les yeux cernés et surtout, indice de mauvaise humeur, son chignon était mal fait ; un bout de sa tresse en sortait et pendait sur son cou comme une ficelle. Ces jours-là, on évitait de la contrarier, sinon elle nous coinçait le bout de l'oreille entre deux doigts et nous tirait ainsi jusqu'au tableau pour nous harceler de questions.
 |
Elle était directrice de l'école de filles. Son beau-frère, Jules Lotte, directeur de l'école de garçons, avec sa femme comme adjointe. Ils étaient de cette race d'enseignants laïcs d'entre les deux guerres, très compétents, très sévères, exigeant et obtenant une stricte discipline aussi bien des instituteurs que des élèves. |
Tous les lundis, la maîtresse passait dans nos rangs et inspectait les chaussettes, chemises et culottes pour s'assurer de leur propreté. Les cheveux surtout, étaient surveillés et si quelques poux ou lentes étaient décelés, toute la classe écrivait un billet pour les parents qui étaient sommés de nous laver la tête avec la fameuse lotion Marie-Rose. Souvenir piquant et nauséabond !
La journée commençait par une leçon de morale ou d'instruction civique. L'écriture, l'orthographe et le soin étaient très importants.
Le plus pénible de mes premiers souvenirs d'école, c'est celui de mes avatars avec la plume et l'encre. Les écoliers actuels ne connaissent pas cette hantise du porte-plume qui marque un cal douloureux au doigt ; de la difficulté de bien marquer les pleins et tes déliés ; de la plume qui, sournoisement, pêche au fond de l'encrier une poussière tombée là par hasard et qui va s’étaler en vilaine tache ronde sur le devoir si laborieusement calligraphié, et enfin de la gomme qui, supposée enlever cette tâche, va creuser délicatement un trou, symbolisant le beau zéro en soin qui sanctionnera votre maladresse. Béni soit l'inventeur du stylo à bille qui a délivré de cette angoisse des générations d'écoliers.
Mes cours préférés étaient les cours de chant, bien sûr. On y apprenait le solfège, et en fin d'année scolaire, on répétait des chœurs pour la remise des prix qui avait lieu à la salle des fêtes.
C'était souvent des chants patriotiques, tel "L'hymne aux morts de la guerre", de Victor Hugo, qui fut chanté à quatre voix filles et garçons réunis pour la circonstance. Et l'on chantait à pleins poumons :
Gloire, gloire, gloire à notre France éternelle
Gloire, gloire, gloire à ceux qui sont morts pour elle
Aux martyrs, aux vaillants, aux forts.À ceux qu 'enflamma leur exemple
Qui veulent place clans le temple
Et qui mourront comme ils sont morts.
On ne savait pas alors que ces dernières phrases ne tarderaient pas à se réaliser, quelques années plus tard.
Je crois que c'est là que débuta mon amour pour le chant choral. J’avais une amie, Jeanne, que j'aimais beaucoup. Elle chantait en alto, moi en soprano, et sur le chemin de l'école nous chantions à deux voix. Elle venait du pensionnat d'Oriocourt, où elle avait appris beaucoup de chants mixtes et elle me les apprenait. La Saint-Hubert, le Cor, le Chant du forgeron et bien d'autres, consignés dans un carnet orné de dessins que je garde précieusement.
Mais n'anticipons pas. J'aurai tout loisir de parler du chant choral plus tard, pendant mon adolescence.
Je replonge dans mes souvenirs d'enfance, pour en ressortir aux environs de dix ans avec un épisode qui a beaucoup marqué cette période.
Je rêvais de voyages, de pays inconnus, mais surtout je désirais voir la mer. Les seuls voyages que j'avais fait, c'était à Montblainville. le pays natal de maman.
Aujourd'hui, on en est à deux heures de voiture. Mais dans les années 30, on prenait le train à sept heures du matin, un omnibus dont il fallait changer à Conflant-Jamy. Le second nous déposait à Verdun vers 10 heures, et nous avions un car pour Varennes-en Argonne, à 14 heures seulement. Là, il nous restait quatre kilomètres à faire à pied, sur une petite route en lacets qui ne compte pas moins de 18 tournants. Au dernier, on apercevait tout-à-coup la pointe du clocher émergeant des arbres et cela nous donnait du courage pour entamer la dernière côte.
La première fois, ça me semblait être le bout du monde. Dans le train, j'inscrivais le nom de toutes les gares pour raconter le voyage à mon retour.
Je fais une parenthèse pour parler un peu de Montblainville, le Blainville de la mémère, pour moi c'était son Blainville à elle ; un petit village d'une centaine d'habitants reconstruit après la guerre de 1914.
Quelques grosses fermes, encore rentables à cette époque (il n'y en a plus qu’une aujourd'hui) et des petits cultivateurs, vivant de leurs élevages et de leurs produits. Les hommes trouvaient encore à s'employer aux environs soit bûcherons, cheminots, gardiens de cimetière militaire (nombreux aux environs de Verdun et de Varennes). Maintenant, c'est un pays qui se meurt, les jeunes sont partis chercher du travail ailleurs. Tous les alentours sont des lieux de pèlerinage pour les anciens combattants. Douaumont, Verdun, La Voie Sacrée, La Tranchée des Baïonnettes, La Tranchée de la Soif, la Butte de Vauquoix et tant d'autres lieux sinistres.
Dans la forêt tout près de Montblainville, j'ai vu l'abri du Kronprinz. À Varennes-en- Argonne, à côté du musée de la guerre, des souvenirs plus anciens font rêver. A l'emplacement de l'auberge où fut arrêté Louis XVI et sa famille se dresse un monument commémoratif.
La sœur de ma grand-mère tenait un café au centre de Montblainville. Quelques-uns des neveux étaient revenus au pays après la guerre. L'un d'eux, le Nénesse, habitait une grande maison qu'on appelait encore le château, parce que Charlemagne y aurait séjourné en 771. C’est ce qui est indiqué sur une vieille carte postale représentant le château avant 1914. Mais on n'en a reconstruit qu'une aile tout-à-fait banale qu'on ne peut plus qualifier de château. C'était notre lieu de séjour à chacune de nos visites, environ une fois l’an. |
 |
Je ne peux résister au plaisir de vous en compter une dans toute sa verdeur. Une histoire vraie, disait-elle.
Donc, un certain 11 novembre, c’était la Saint-Martin, patron du village. Voilà que le sacristain, voulant nettoyer la statue du saint et la mettre au milieu du chœur, la fit basculer malencontreusement. Catastrophe ! voilà Saint-Martin en morceaux. Que faire ? Arrive le vieux curé qui lui dit sévèrement :
- Tu as cassé Saint-Martin, tu vas le remplacer. Mets ma cape et mon chapeau, monte sur le socle et ne bouge plus.
Sitôt dit, sitôt fait. La messe commence. Le pauvre homme trouvait le temps bien long, d'autant plus long, qu'une irrésistible envie le prit soudain et il ne put se retenir bien longtemps. Et les fidèle ébahis, virent un ruisseau descendre et s'écouler sous ses pieds. Ils se mirent à crier :
- Miracle, miracle, not'saint qui pisse.
Et lui de répondre piteusement, dans son patois :
- Y a ni miroqui, ni miroquâ, si vous n'me descendîmes, j'y chirâs.
Excusez le naturel du langage tel que Zénomie le racontait.
Il y avait encore bien d'autres histoires, mais sitôt la crème dégustée, je courais jouer dehors avec les petits cousins.
La cousine Zénomie hébergeait sa sœur Alice, une pauvre vieille fille demeurée, qui me faisait très peur. Des petits yeux chassieux et enfoncés, un nez en bec d'aigle, une bouche presque sans lèvres, étroite et serrée, qui grommelait toujours à l'approche des gens. Elle s'occupait des bêtes et avait toujours un bâton à la main, qu'elle levait parfois sur nous. Quand le boucher venait chercher un veau pour l'abattoir, elle courait derrière lui avec son bâton. Il fallait la retenir et même l’enfermer. La pauvre vieille a d'ailleurs fini ses jours dans un asile.
Chez Aline et Aimé Gérodel, on nous préparait chaque fois des girolles, dont je raffolais, et qui foisonnent dans les forêts d’Argonne.
Il y avait aussi la grosse tante Génie qui me disait en patois :
- Veûte de la pôye ?
Ce qui signifiait : veux-tu de la poule ?
Sa fille Cécile et son gendre Alexandre habitaient dans ce temps-là une maison voisine. C’était Cécile qui tuait les lapins et Alexandre bougonnait :
- Elle tuerait un homme comme elle tue les bêtes.
Car lui ne s'occupait que de sa truie (elle s'appelait Jacqueline), pas du petit élevage, et surtout il ne tuait jamais. J’ai connu chez eux plus tard une oie énorme qui est morte de vieillesse. Il l'aimait et lui parlait comme à un enfant. J'ai eu bien plus tard des aventures chez eux avec mon fils Michel et un certain petit canard.
Il reste Emile et Denise Didelon. d’autres neveux de grand-mère. Bref, tous voulaient nous recevoir et rivalisaient pour nous offrir le meilleur repas. Ah ! Les bons civets de lapin d'Aline, les bonnes poules au riz de tante Génie, les galettes et les pâtés de Cécile, et les liqueurs patiemment concoctées chez tous.
Heureusement, on ne restait que quelques jours, le temps de les voir tous. Grand-mère Byelle les aimait bien et ils lui rendaient cette affection, peut-être en souvenir de leur enfance avant 1914.
Donc, ces petites incursions dans la Meuse m’avaient satisfaite au début, mais en grandissant, je rêvais d’autre chose.
Un jour, rentrant de l'école avec mon amie Lulu, celle-ci me raconta ses dernières vacances en Normandie. Elle avait vu la mer ! Des bateaux ! Elle s'était baignée !! La veinarde ! Je n'en crus pas mes oreilles quand elle m'apprit que ce séjour ne coûtait pas cher. II fallait s'inscrire à l’usine.
Toute excitée, je suis rentrée à la maison pour raconter tout à mes parents et les prier de me faire inscrire. Maman qui était une vraie mère poule leva les bras au ciel :
- Mais tu n'y penses pas, partir si loin et avec qui ? Jamais de la vie !
Et comme j'insistais en pleurant, pour clore la discussion, elle ajouta :
- Si tu y tiens tellement débrouille toi donc toute seule pour te faire inscrire.
Elle ne pensait pas, la pauvre, que j'allais la prendre au mot.
Le jeudi suivant, ayant demandé des renseignements à Lulu, je suis partie à l'usine en prenant la passerelle des ouvriers (aujourd'hui disparue) qui enjambait la ligne de chemin de fer à la sortie nord.
Pourtant l'usine me faisait peur. Je n'étais allée qu'une fois avec maman porter un repas à papa, et j'avais été épouvantée par ce grand four où mon père, qui était fondeur au laminoir à cette époque, des grosses lunettes bleues sur les yeux, enfilait un long ringard dans le four incandescent. Le feu et la chaleur m’avaient effrayé et je m'étais jurée de ne plus y retourner. Pourtant, ce jeudi, j'étais devant l'infirmerie et j’y entrais pour parler au docteur Zivré. J'avais une frousse bleue et mon cœur cognait bien fort.
 |
Le docteur, qui me connaissait bien, fut tout étonné de me voir et me dit : |
Il m'a prise par la main en me disant :
- Tu sais, j’aime bien les gens courageux. Je vais t'aider pour les papiers, et tu reviendras me voir pour les vaccins avant ton départ.
Et sans plus de façon, il me conduisit au bureau où il fit remplir ma demande.
Quelle fut la stupéfaction de maman, quand j'exhibai ce papier ! Elle n'arrivait pas à y croire :
- Tu es allée toute seule à l'usine, alors que tu en avais si peur ?
- Oui, parce que je veux voir la mer.
- Mais tu aurais pu te faire écraser ! Mais qu'est-ce que j'ai fait au Bon Dieu pour avoir un numéro pareil ? (Ça, c’était le cri du cœur de maman à chacune de mes incartades). Je suis sûre que pas un gosse des cités n'aurait osé le faire. Qu'est-ce que le docteur a dû penser !
- Il était content, il a ri très fort et il m'a embrassé, même que sa barbe piquait.
Alors là, les bras lui tombaient. J’étais fière de mon exploit. J’ai compris ce jour-là que si j'avais des problèmes dans la vie. il faudrait toujours essayer de m'en sortir seule, quoiqu'il en coûte. Mais dans ce cas précis, c'était peut-être un peu prématuré et ma pauvre mère en a pleuré, moi aussi d’ailleurs, car je ne voulais pas lui faire de la peine. Enfin, mon rêve devenait réalité. On m'achetait mon premier maillot de bain, on marquait mon linge. Maman m'a fait une petite robe dans un coupon à bon marché. Le trousseau n'était pas abondant, mais c’était bien le moindre de mes soucis. J’essayais de faire des économies pour avoir un peu d'argent de poche au départ. Je glanais les piécettes de un sou (cinq centimes), et deux sous, pour les changer en pièces de un franc en bronze. La pièce de cinq franc en argent était un rêve et celle de vingt francs (la tune), un mirage. Ces pièces ont disparu pendant la guerre pour fabriquer des obus et furent remplacées par des billets.
Le jour du départ, une voiture de l'usine s’arrêta devant la cité. J'y retrouvais Lulu et deux filles de Frouard Renée et Jeanine. Maman et grand-mère Byelle pleuraient. Je faisais la brave, mais j'avais le cœur serré. C’était la première fois que je quittais la famille.
Le chauffeur nous conduisit jusqu'à Metz d'où partait notre train. Nous étions bien une cinquantaine venues de diverses usines lorraines. Je ne me souviens plus très bien du voyage mais de l'arrivée, oui !
Je croyais voir la mer aussitôt, mais de la petite gare, on nous mena à la pension, une grande maison de brique rose située sur le vieux port, un bras de mer où étaient amarrés quelques bateaux de pêche. |
 |
Il pleuvait ! Le ciel était bas, traversé de gros nuages noirs poussés par le vent. Nous marchions en troupeau serré, la tête dans les épaules, les yeux au sol pour éviter les flaques d'eau.
J'étais déçue : j’attendais une mer bleue comme sur les cartes postales et un beau soleil qui m'aurait permis d'étrenner le maillot neuf.
Mais je ressens encore l'émotion qui m'a saisie en arrivant au bout du quai. D'abord cette senteur inconnue, de marée et d'iode qui emplissait nos poumons peu habitués à cette prodigalité d'air frais. Et ces vagues immenses qui arrivaient en rouleaux, dans un bruit étourdissant et retombaient en millions de gouttelettes jusque sur la digue. C'était fantastique, grandiose. Je ne ronchonnais plus, j'étais fascinée et déjà j’aimais la mer. Nous étions accueillies par une vraie tempête et nous avons dû rentrer bien vite après ce premier contact.
D'ailleurs, pendant tout ce mois de juin, nous avons eu hélas plus de pluie que de soleil et je ne risquais pas de rentrer bronzée. Mais j'ai pu quand même prendre mes premiers bains de mer, faire de belles promenades sur les falaises environnantes, admirer le Casino et la plage vus d'en haut.
Et puis nous avons fait des sorties extraordinaires. Dieppe et son vieux château que nous avons visité, ainsi que le fameux paquebot "Normandie", le ruban bleu vedette de l’année. Quelle merveille pour une gamine qui n’avait jamais mis le pied même dans une barque. Dire que des heureux pouvaient faire de longs voyages dans ce luxueux décor ! J’imaginais un monde de riches oisifs, dansant dans le grand salon, nageant dans la piscine bleue, paressant dans les chaises longues disposées sur le pont et je rêvais.
Une autre découverte, bien différente, mais qui m’a aussi profondément marquée, ce fut Lisieux, la maison de Thérèse Martin où l’on nous a raconté sa vie en projetant des images, le carmel, son corps embaumé. J’ai gardé à la petit Sainte Thérèse une sorte d’affection comme à quelqu'un que j’aurais bien connu.
On construisait à ce moment la basilique, car il y avait peu de temps que Sainte-Thérèse avait été canonisée. Cette basilique je ne l’ai jamais vue terminée. Peut-être qu'un jour...
Parallèlement à ma vie scolaire, s'était poursuivie mon éducation religieuse. Je dis bien poursuivie, car ma mère et ma grand-mère qui étaient très croyantes m'avaient inculqué l'essentiel de la religion catholique. Nous allions à la messe tous les dimanches. Je crois bien que nous étions les seuls pratiquants dans les cités, mais presque tous les enfants allaient au catéchisme et faisaient leur première communion.
L'année précédant cette cérémonie était assez pénible car il fallait assister trois fois par semaine à la messe de six heures et demie suivie du catéchisme jusqu'à l'heure de l'école. L’église était à plus de deux kilomètres et l'hiver 1937 fut rigoureux.
Nous avions encore le bon vieux curé Pérignon. qui a laissé son nom à une rue du village. Tous les gens de ma génération se souviennent sans doute de son éternel sermon sur la justice de Dieu. Il nous représentait le Seigneur se servant d'une balance ; d'un côté nos bonnes actions, de l'autre nos fautes. A nous de faire pencher la balance du bon côté. C'était une vue assez simpliste mais à ce moment, nous nous en satisfaisions.
Nous étions bien encadrées surtout par les religieuses. Dès l'âge de 7 ans j'allais au patronage, les jeudis pour apprendre à coudre, les dimanches étaient réservés aux jeux ou aux promenades selon le temps. Nous pratiquions aussi la gymnastique, les danses rythmiques et folkloriques, les mouvements d'ensemble. Notre phalange comportait plus d'une centaine de membres, des poussins jusqu'aux plus grandes et nous faisions parties du rayon sportif féminin. |
 |
Petite sœur il faut sourire
Partout, toujours et sans répit
Sur notre visage on doit lire
Notre joie d'être à Jésus ChristRefrain :
Pour l'âme vaillante pure et conquérante
Le cri de victoire et le chant de le gloire
Bravant la tristesse comme la mollesse
C'est net et c'est court, le sourire toujours
Les plus pieuses se réunissaient le dimanche matin avant la grand-messe, pour la croisade eucharistique. Là, on approfondissait sa foi, on apprenait à faire des sacrifices, à mieux prier. Notre devise était : prie, communie, sacrifie-toi, sois apôtre. Honnêtement, je dois dire que parfois, je m'y suis ennuyée et je me suis même retrouvée dehors pour fou-rire injustifié. Mais plus honnêtement encore, quoique je n'aime pas parler de ces choses, je suis sûre que cette discipline m’a appris très tôt à penser aux autres, à les aider, à garder le sourire quand tout va mal. C'est devenu gênant, presque tabou de parler foi et religion, mais si j'ai décidé de tout dire dans ce témoignage, je ne dois rien laisser dans l’ombre, quoiqu’il en coûte, même si quelques grands esprits se moquent de ma sincérité. C'est l'égoïsme et le manque d’amour qui tuent la société actuelle. On n’apprend plus assez aux enfants à s'oublier pour les autres, on n'ose pas. Ça fait trop sermon et c'est ce que je suis en train de faire, alors je m'arrête là.
 |
Ma première communion fut fervente, mais triste. D’abord, nous devions étrenner une église remise à neuf. Hélas les travaux n’étant pas terminés, elle eut lieu à la chapelle du faubourg, trop petite pour faire une procession. Il pleuvait et nos robes blanches étaient souillées de boue. Mon frère étant malade nous n’avions pas fait d'invitations ; d'ailleurs, pécuniairement, c'était impossible. On se remettait péniblement des grèves de 1936. Robe et voile m’avaient été prêtés par une cousine, le missel et le chapelet blanc étaient de mon frère, rien de personnel. |
 |
Je renonce à Satan, le pervers et l'immonde
Au péché qui meurtrit en flattant
Aux maximes du monde.
Je m'attache, par choix de raison et de cœur
A Jésus mon sauveurrefrain
Haine à Satan, haine à ses pompes vaines
Haine au péché, œuvre d'iniquité.
Jésus nous tient dans ses aimables chaînes
Il a nos cœurs, c'est pour l'éternité.
Une bonne partie d'entre nous a tenu ses promesses, surtout chez les filles très suivies par les religieuses.
Que de souvenirs amassés pendant toutes ces années. J'aimais bien les bonnes sœurs, les chères sœurs comme on les appelait couramment.
Sœur Henriette et sœur Louis, dont tous les anciens se souviennent encore avec un petit pincement de cœur. C'était elles qui avaient la charge des plus jeunes au patronage. Je leur dois mes premiers points, mes premières piqûres aux doigts, et mes premiers mouchoirs "faits main", en attendant un peu plus tard le trousseau complet. Tout en cousant, elles nous apprenaient des chansons que je sais encore et que je chantais à mes enfants et à mes petits enfants pour les endormir : "Quand j'étais toute petite", "La légende de Saint-Nicolas", "Trois anges sont venus ce soir" et bien d'autres. Je les ai encore chantées avec sœur Henriette pendant ses derniers jours, elle était heureuse que je m'en souvienne. Nous en avons égrené des souvenirs de toutes ses années où jour après jour, elle avait parcouru les rues de la ville pour faire des piqûres et soigner les malades. Elle connaissait presque toutes les familles. Les enfant couraient vers elle pour embrasser la croix de son grand chapelet. Elle était venue très souvent chez nous pour mon frère et elle m’en parlait toujours. Là, je ne peux plus reculer. Il me faut aborder une peine bien enracinée au fond de moi.
Je crains de l'aborder, car plus j'écris, plus les souvenirs affluent, certains très précis et ils me font mal à pleurer. C'est pour cela qu'inconsciemment j'ai très peu parlé de mon frère. Et pourtant, il est toujours là, bien présent, en filigrane dans toutes les scènes de mon enfance. Je le vois comme s'il était là.
Il était tout l'opposé de moi. Mes parents disaient qu'il était la fille et moi le garçon. Calme, trop calme, dans la cour de l'école, il restait souvent seul, il fuyait les courses et les bousculades, se sentant sans doute moins fort que les autres.
 |
Très intelligent, il aimait l'étude. Je lui enviais ses cahiers impeccables, toujours pleins de bonnes notes et d'appréciations flatteuses. |
Ses premières économies avaient permis l'achat d'une bicyclette. Il aimait faire des promenades à la campagne avec quelques copains. Mais un soir, il est rentré trempé de sueur. Le lendemain il était de nouveau malade. Pendant huit mois ce fut une lutte contre le mal. On le voyait dépérir de jour en jour. Tant qu'il a pu sortir, il allait dans la forêt avec maman. Il était toujours triste. Son seul plaisir c'était le phonographe. La sœur Henriette qui venait lui faire des piqûres quotidiennement lui demandait souvent de lui passer "Noël du pays" de Tino Rossi. Et elle chantait en même temps pour essayer de le faire sourire.
Ses derniers mois furent atroces. Il n'avait plus que la peau et les os. Un jour, il demanda à maman de lui donner sa montre bracelet. Quand il l'eût en main, il la passa à son poignet et la fit glisser jusqu'en haut de son bras.
Puis sans commentaires, il l'a remise à maman pour qu'elle la range. Quand sa fin approcha, le docteur prévint papa et lui recommanda de m'éloigner. Je dus partir chez ma tante à Frouard.
C'était début juillet. Les vacances étaient un bon prétexte. Mais je n'oublierai jamais ce départ. Son dernier regard ! Ses grands yeux tristes qui m'ont suivie jusqu'à la porte. Je me suis retournée une dernière fois pour lui sourire. Oh ! ce regard poignant ! Il me poursuit toujours, c'était vraiment un adieu. Il savait qu'il ne me reverrait pas.
Maman m'a raconté qu'après mon départ, il s'était mis à prier en disant :
- Sainte vierge Marie, guérissez-moi. Ce n'est pas pour moi, c'est pour maman.
Hélas, il n'y eut pas de miracle et il s'éteignit le 5 juillet 1938. Il avait 16 ans.
Maman ne s'en est jamais vraiment remise. Depuis ce jour, elle a eu souvent des malaises cardiaques. Plus d'une fois, nous avons craint le pire.
Elle avait tenu bon trop longtemps, s'efforçant de paraître gaie pour remonter le moral à mon frère. Elle qui était autrefois si souriante et courageuse, était devenue dépressive. Il a fallu des années et la naissance de mes enfants pour qu'elle reprenne goût à la vie.
De plus, nous avions traversé la période tristement mémorable de 1936. Les grèves avaient lourdement pesé, tant sur le budget que sur le moral.
Mes parents avaient reculé le plus longtemps possible devant la nécessité d'aller à la soupe populaire. Quand il fallut s'y résigner c'est mon père qui fit la corvée de gamelle. Maman pleurait en disant que ça lui rappelait la guerre et la cantine de la croix rouge. Ces années de 1934 à 1938 ne m’ont laissé que des souvenirs amers. |
 |
A cette époque, on était encore contremaître de père en fils, sans qu'il soit besoin de diplôme, et à mesure que les échelons se gravissaient, les avantages se multipliaient. N'était-ce pas injuste que des ouvriers qui gagnaient tout juste de quoi vivre devaient payer leur chauffage, alors que d'autres qui gagnaient largement leur vie n'avaient rien à débourser. Que les salaires soient différents, c'était normal, mais qu'en outre les ingénieurs aient un jardinier, un chauffeur à leur disposition et même à la disposition de leurs épouses pour leurs déplacements, c'était un peu trop.
Certaines de ces dames étaient gentilles et compréhensives, en particulier la femme du directeur, réputée pour sa bonté. J'en ai même connu une qui portait à la nuit tombée des sacs de chauffage devant la porte d'un ouvrier malade. Mais d'autres étaient fières et hautaines et considéraient les gens des cités comme des minables.
Je me souviens qu'un chef de service, habitant juste en face de notre cité, veuf et père d'un petit garçon, s'était remarié à une dame qui venait de la campagne. Elle nous voyait vivre depuis sa fenêtre. Quelques années plus tard, la situation ayant évolué et quelques barrières sociales s'étant effondrées, elle m'a avoué la panique qui l'avait prise au moment de s'installer dans ce quartier. Elle s'attendait à voir des bagarres, des gens sales, des gosses effrontés ; mais de sa fenêtre, elle avait vu des gens qui travaillaient, qui s'entraidaient, des enfants propres et polis, à part quelques exceptions comme partout ailleurs. Ce qui l'avait surtout étonnée, c'était la bonne entente qui régnait entre voisins. Même pendant les grèves, malgré quelques rares bagarres dans les rassemblements qui suscitent souvent des émeutes (encore de nos jours).
Quand passait un défilé, on entendait crier :
- A bas les calotins.
ou,
- Têtes de rivet au poteau.
Le premier cri ne nous empêchait pas d'aller à la messe, le second ne nous concernait pas. Il y avait des communistes autour de nous. Leur idéologie n'était pas la nôtre. Mais on se connaissait bien, on se respectait. Nous étions tous des ouvriers, et le combat était le même pour tous.
Les premiers congés payés ont été accueillis dans l'enthousiasme. La majorité des ouvriers n'avait pas les moyens de partir en vacances, mais quinze jours de liberté, sans horaires de travail, c'était déjà une grande victoire. On pouvait faire quelques pique- niques en semaine à la ferme du Haras, notre lieu de prédilection. Bref, la vie serait devenue un peu plus agréable sans notre angoisse devant la maladie de Robert et notre détresse après sa mort. Maman pleurait toujours, papa ne parlait plus. Un jour, je me suis mise à fredonner un chant de l'école, ma grand-mère m'a dit brutalement :
- Tu n'as pas de cœur, tu chantes alors que ton frère est mort.
J'en fus si saisie que pendant longtemps et encore à présent, j'ai perdu l'habitude de chanter à la maison. Et pourtant j'ai toujours aimé chanter. Mais je me défoulais à l'occasion de sorties avec mes amis.
A ce moment, je chantais déjà en chorale avec la sœur Adélaïde, très bonne musicienne, des cantiques pleins de ferveur qui feraient crouler de rire nos jeunes générations.
J'ai senti sur ma lèvre une douce rosée
Du ciboire entrouvert tombant jusqu'à mon cœur
Ô manne véritable, en l'arche déposée
Mon Jésus vit en moi,
Ma faim est apaisée
Et ma lèvre s'empourpre au sang du rédempteur.
0 jour d'incomparable ivresse
Extase, ineffable bonheur
Jésus cédant à sa tendresse
A daigné visiter mon cœur
J'allais à la messe à 7 heures 15 tous les dimanches, à la chapelle de l'hospice (ces notes étaient écrites en 1989, l'hôpital fut transformé entièrement en 1991. L'ancienne chapelle est remplacée par l'infirmerie).
***************
Reprise de l'écriture de ce récit en 1992, après un blocage de 3 ans dû en partie à la difficulté de raconter mes souvenirs de la guerre, mais aussi à une période difficile que je viens de traverser.
***************
En cette année 1938, j'avais passé mon certificat d'études avec succès. Les vacances furent un peu perturbées par de vagues bruits de guerre, vite oubliés après les accords de Munich. Pendant ces vacances, les sœurs nous accueillaient à l'ouvroir Saint-Louis. Elles nous apprenaient à coudre et nous préparions une grande kermesse pour la fin de l'été.
Mais les vacances de 1938 n'avaient été qu'un répit. Dès mars 1939, Hitler mettait la main sur la totalité de la Tchécoslovaquie, consommant ainsi la rupture des accords.
Le 1er septembre 1939, j'étais chez la coiffeuse pour ma première permanente. J'allais partir à Saint-Avold avec ma cousine Hélène, de six mois ma cadette, dont le père était adjudant. Ils étaient chez nous pour quelques jours, mais mon cousin fut rappelé d'urgence.
Le 3 septembre, la guerre fut déclarée. L'Allemagne avait envahi la Pologne. C'était la mobilisation générale.
Oh ! Ce hurlement lugubre du gueulard qui n'en finissait plus ! Les sirènes de Pompey et Frouard accompagnées du tintement des cloches, quelle tristesse. Toutes les femmes pleuraient.
 |
1939 avait été ma dernière année d'école primaire. J'avais passé et réussi le dernier examen de fin d'études. Comme j'aimais beaucoup la couture, j'entrais au mois d'octobre à l'ouvroir Saint-Louis. |
Une nouvelle vie commençait pour moi.
L'ouvroir enseignait à ce moment la lingerie, la broderie, le repassage. On apprenait les différentes techniques de points sur des pièces qui étaient notées. Les plus belles étaient exposées. Puis il y eut des cours de dessin et de peinture sur tissu. Pendant l'apprentissage, chacune aurait dû faire son trousseau. Mais en ce temps de guerre, pas de tissu, pas de trousseau.
On travaillait pour des gens aisés qui eux, avaient du tissu. Je me souviens des chemises de Monsieur Jullien (patron des établissements du même nom), des trousseaux pour les familles Guibal, Mater, Hasser. Les superbes draps ajourés et brodés !
Nous repassions aussi les rideaux empesés et les robes de première communion. Ça, c'était l'enfer. Nous repassions dans une grande salle de l'hospice, devant une énorme cuisinière chargée de fers. A tour de rôle, l'une de nous était chargée de remplacer les fers refroidis. J’avais cette corvée en horreur.
Tous les ans à Nancy, à la galerie Poirel, avait lieu une exposition des ouvrages exécutés à l'ouvroir avec notre nom sur chaque pièce. Un peu plus tard, avant les vacances, c'était la kermesse à Pompey avec nos travaux exposés et vendus.
C'était un amusement pour nous, nous tenant à plusieurs sur le bras et glissant sur la flanelle, de long en large, pour que ça brille d'avantage. En cours de journée, chacune devait ramasser le moindre morceau de tissu ou de fil. Rien ne traînait.
Nous avions aussi, une semaine par équipe, l'entretien de la chapelle de l'hospice. Là aussi, il fallait que ça brille, et nous y mettions toute notre ardeur, car nous l'aimions cette chapelle, aujourd'hui disparue.
Un jour, je passais la paille de fer sur le plancher de la sacristie. M'arrêtant un instant devant la fenêtre ouverte, je vis des soldats assis sur le trottoir pour une halte. M'apercevant, ils se mirent à siffler et à plaisanter. Et moi, tout en brossant, je les saluais de la main en souriant. Mais tout-à-coup, je sentis une présence derrière moi. Je me retournai. C'était la mère supérieure, sœur Maurice, les bras croisés, l'œil sévère, dans une attitude réprobatrice qui ne présageait rien de bon. Il faut l'avoir connue pour comprendre combien on se sentait, devant elle, toute petite et craintive à la moindre peccadille.
De fait, elle m'enjoignit de prendre mes affaires et de monter à l'ouvroir attendre sa visite. Je filai sans souffler mot. Une heure après, elle était dans la salle de couture et me sermonnait devant toute les filles. Quelle honte ! Avoir osé sourire et saluer les soldats. C'était une attitude d'effrontée, pas de jeune fille bien élevée comme il se devait à l'ouvroir Saint-Louis !
Or, voilà qu'au même instant, un autre régiment vint faire la pause juste devant la maison. Alors, la bonne mère, outrée, nous fit fermer les volets.
Une petite futée, Odette, demanda à aller aux toilettes. Quand elle revint à sa place, elle était un peu rouge et se faufila rapidement derrière la table. A la sortie, elle nous a raconté qu'elle était grimpée sur la cuvette des WC, pour atteindre une petite fenêtre donnant sur la rue et faire des risettes aux soldats, mais en redescendant, son chausson avait glissé dans la cuvette (nous avions toutes des chaussons à semelles de feutre à cause des planchers cirés). Repêché et tordu, elle l'avait fourré dans sa poche en espérant que la sœur ne verrait rien. Heureusement pour elle, la supérieure était repartie, nous laissant à la garde de sœur Francisca, âgée et presque sourde. Cette bonne sœur priait sans doute beaucoup intérieurement et nous faisait souvent sursauter par un amen sonore, répondant à ses méditations.
C'était aussi défendu d'aller au bal, de toute façon en 1939, il n'y en avait plus. Défense d'aller au cinéma (sauf au ciné paroissial).
J'y suis allée un dimanche à Nancy, avec une amie, pour voir les "Deux orphelines". Le lendemain matin, j'étais mise à pied. Quelqu'un m'avait vu sortir du cinéma. J'ai eu beau expliquer que c'était un bon film, très triste (j'avais beaucoup pleuré), rien n'y fit. Il a fallu que maman aille demander ma rentrée en grâce.
Défense aussi de se baigner, pas question de s'exposer en maillot de bain, quelle inconvenance !
Les religieuses, obéissant elles-mêmes a une règle intransigeante, ne pouvaient être que sévères. Elles n'avaient même pas le droit de manger en public, ce qui nous faisait bien rire à l'occasion des pique-niques quand elles ouvraient leur grand parapluie pour se mettre à l'abri des regards. |
 |
Bons musiciens, ils mirent vite sur pied une chorale à quatre voix qui acquit en quelques années une bonne réputation. Les gens des alentours venaient souvent à Pompey aux grandes fêtes pour la beauté des offices. Mais la discipline était vraiment dure avec eux et il y avait parfois des petites guerres paroissiales.
L'occasion me sera souvent donnée sans doute de rappeler tous les interdits qui ont jalonné ma jeunesse et freiné souvent des besoins de détente.
Détente dont j'aurais eu grand besoin, car chez nous la vie n'était pas gaie, assombrie encore par un conflit familial.
Tous les hommes mobilisés étaient remplacés à l'usine par des femmes. Mon oncle Georges, le Petiot, qui avait quarante ans, était affecté spécial.
Une femme, veuve avec deux enfants, habitant le quartier, vint travailler dans son chantier. Elle avait une liaison, connue de tous, avec un plombier, locataire d'un café voisin.
Aussi, quand mon oncle parla de l'épouser, ce fut un coup de massue pour ma grand-mère, j'ai déjà dit qu'elle était très sévère et ne badinait pas sur la conduite.
Un souvenir me revient encore en mémoire (ce qui donne un récit décousu, mais les souvenirs surgissent et je les note pour ne pas oublier).
Un jour, ma tante de Frouard était arrivée en larmes chez grand-mère. Son mari, beau garçon, quelque peu volage, avait reçu chez lui sa maîtresse pendant que sa femme était hospitalisée. Les bonnes langues du quartier, toujours friandes de scandales, avaient charitablement prévenue ma pauvre tante qui était accourue se réfugier près de sa mère et voulait quitter son mari.
Ma grand-mère lui enjoignit de repartir chez elle, de conserver un foyer à son fils et de corriger la mégère qui avait osé s'introduire chez elle.
Ce qui fut fait, il y eut un mémorable crêpage de chignon et l'affaire fut réglée. Du moins en apparence, car la pauvre tante avait perdu toute confiance et ne fut plus jamais la même.
Donc, ma grand-mère, toujours aussi intraitable des années plus tard, n'accepta pas le mariage de son fils et préféra lui laisser la place (les logements étant attribués aux ouvriers, elle était logée par mon oncle). Elle vint chez mes parents et partagea ma chambre.
C'était un déchirement pour elle (elle avait 68 ans) et pour l'oncle aussi, qui adorait sa mère. Mais il avait quarante ans et était amoureux. D'ailleurs, sa Lucie s'est rangée définitivement avec lui et fut une bonne épouse. Elle avait un cœur d'or.
Mes souvenirs de guerre sont vraiment confus. Je n'ai jamais eu la mémoire des dates et je regrette bien de n'avoir pas tenu un journal.
Des débuts de la guerre, mes premiers souvenirs sont les ordres de la défense passive. Calfeutrage des fenêtres, repérage des caves pouvant servir d'abris, essai de masques à gaz à la mairie. Heureusement, ils ne nous ont jamais servi. On étouffait dans ces horreurs qui sentaient le mauvais caoutchouc.
Les allemands ont envahi la Hollande, la Belgique, le Luxembourg, puis le nord de la France, précédés par leurs bombardiers. C'était le fameux plan jaune d'Hitler, bien plus haut que la ligne Maginot, derrière laquelle on se croyait à l'abri.
Le 10 mai 1940, les premières bombes allemandes, visant sans doute l'usine, sont tombées sur le quartier Jeuyeté, à 300 mètres de chez nous. Il y eut des maisons détruites et des personnes tuées, je ne sais plus combien.
Après ce premier bombardement, les quartiers proches des aciéries et de la gare étant très dangereux, nous nous sommes réfugiés chez tante Jeanne à Frouard.
Durs souvenirs ! Mais cette période eut au moins un effet salutaire pour la famille. L’oncle Georges et sa femme furent accueillis avec nous, et ce fut la réconciliation dans les larmes.
Quelques jours après, le calme semblant revenu, nous sommes venues, maman et moi, au cimetière de Pompey pour fleurir la tombe de mon frère.
Au retour, nous étions tout près du pont, lorsque la sirène retentit. Déjà les avions arrivaient. Pas le temps de courir vers un abri. Nous nous sommes couchées dans un passage entre l’ancien magasin Limon et la maison voisine. Nous avons bien cru notre dernière heure arrivée. Les avions piquaient, les bombes tombaient tout près, la terre tremblait. Et alors que j’étais déjà terrorisée, recroquevillée, un homme ivre s’est allongé contre moi en me disant :
- N’ayez pas peur ma petite, j’ai fait un pacte avec le diable, il va nous protéger.
Il croyait me rassurer et moi je criais :
- Non. non allez-vous-en, je ne veux pas.
A la fin de l’alerte quand nous sommes reparties, tremblant sur nos jambes, nous avons vu les maisons détruites de l’autre côté du pont et les hommes de la défense passive sortaient des cadavres.
Depuis plusieurs jours, la fusillade crépitait dans la forêt surplombant Pompey. De la maison de ma tante, située juste en face de notre presbytère, sur l’autre rive de la Moselle, nous avons vu les allemands descendre la côte de l’Avant-Garde", puis la rue de "La Salle" jusqu’à la rivière. Ils se cachaient contre les murs, leurs mitrailleuses au poing, puis couraient en descendant jusqu’à un autre refuge, comme dans les films de guerre, mais hélas ce n’était pas un film.
Heureusement, le village semblait désert. Les gens se terraient dans les caves. Nous assistions, impuissants et affolés à cette avance rapide. C’était le 18 juin.
Dans la nuit, les mitrailleuses ont crépité sur les deux rives. Des soldats français ont été tués près du pont. Mon oncle Emile qui était de la défense passive faisait partie de l’équipe qui les a trouvés. Il en était malade.
Terrés dans la cave, nous avions très peur, car mon père, mon oncle Georges et mon cousin Jean, étaient cachés avec nous. En principe il ne devait rester en ville que les femmes, les enfants et les vieillards.
Tout-à-coup nous avons entendu les bottes allemandes marteler le sol au-dessus de nous, puis dans la cave voisine. Ils ne nous ont pas trouvés car nous étions dans une petite cave secrète située sous la maison voisine. Nous aurions eu bien plus peur si nous avions su à quel danger nous venions d’échapper.
Car les allemands, ayant réussi à traverser la rivière sont montés par la rue du "Fort Joli" (là où nous étions), en fouillant toutes les maisons pour rechercher des civils qui auraient tiré sur eux et tué deux des leurs (en fait, on a su plus tard, que c’était des soldats français qui les avaient tués avant de fuir).
En guise de représailles, tous les hommes restant, valides ou non, furent rassemblés sur la place nationale et alignés sur trois rangs, les mitrailleuses pointées sur eux. Ils étaient environ 300. L’officier allemand a déclaré que l’aviation serait sur la ville avant midi pour l’anéantir et que les hommes seraient d’abord fusillés.
C’est alors que le curé de Frouard. l’abbé Bernecker, qui parlait allemand, est intervenu. Il a supplié l’officier de sauver la ville, mais celui-ci ne voulait rien entendre. Finalement, le curé, les bras en croix, a offert sa vie pour sauver ses paroissiens. Pendant plus de deux heures, les otages ont tremblé, puis alors que tout semblait désespéré, cet officier à fait lever les servants déjà en position de tir et décommandé l’aviation par téléphone. Le massacre était évité, cela aurait pu être un autre Oradour.
(Il était vraiment quelqu'un le père Bernecker. C'est lui qui avait créé l'harmonie des intrépides, avec monsieur Maurice Pierson pour chef. Monsieur Pierson a l’âge de mon père et il est toujours le chef des intrépides. Il faut le voir, à 90 ans, circuler bien droit sur son vélo).
Donc, nous ignorions tout cela, à l'abri dans notre petite cave. Vers 9 heures du matin, nous mettions timidement le nez à la porte pour voir ce qui ce passait. Juste à ce moment, tous les gens qui étaient rassemblés auparavant sur la place étaient poussés par les allemands et descendaient la rue du "Fort Joli" jusqu'au canal. Nous avons dû suivre. Les allemands poussaient de leur baïonnette en criant :
- Schnell, schnell.
Nous n'avions pas fini de trembler. Les femmes et les enfants étaient rassemblés sur une berge du canal, les hommes en face. Des sentinelles armées tout au long des deux rives. Maman me serrait dans ses bras et pleurait en disant :
- Qu'est-ce qu'ils vont faire, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire ?
Les hommes furent emmenés à pied, vers une destination inconnue. Nous nous sommes retrouvées nous, les femmes, chez ma tante. Mon père, mes deux oncles et mon cousin Jean avaient été emmenés. Ma tante hurlait. Jean n'avait que 17 ans. Dans son angoisse, elle disait à maman qu'il valait mieux que mon frère soit mort avant tout cela et maman pleurait encore plus fort.
Quelles journées nous avons vécues, sans nouvelles, dans l'angoisse la plus totale. Ils sont rentrés huit jours après, harassés et hébétés, se demandant ce qu'ils étaient allés faire du côté d'Epinal, d'où on les avait refoulés le 22 juin, jour de la capitulation.
Nous sommes alors rentrés chez nous à Pompey. Nous nous faisions du souci pour mon oncle Jules et ma tante Jeanne restés aux cités, ma tante handicapée, ne voulant pas partir de chez elle.
Après la capitulation, la France fut coupée en deux. Nous étions envahis par l'armée allemande, dont l'aviation pilonnait alors l'Angleterre. Londres était en feu, mais les anglais tenaient bon et rendaient la pareille aux allemands. On entendait toutes les nuits les gros bombardiers de la R.A.F. passer au-dessus de nous et le pilonnage des villes allemandes faisait trembler la terre jusqu'à nous, surtout quand c'était Sarrebruck, Stuttgart, ou Ludwigshafen.
Les soirs nous écoutions la radio anglaise (ici Londres, les français parlent aux français) mais il fallait faire très attention de crainte des représailles. Les allemands faisaient des rondes, on entendait leurs bottes marteler le trottoir et on tournait vite le bouton.
L’usine était occupée. Le directeur allemand s'appelait Schlupkotten. Les ouvriers freinaient la production, et les chefs de service se faisaient tancer par la direction. Pas assez fortement sans doute, car en septembre 42, Schlupkotten fut remplacé par Otto Jacobs, le vrai type de prussien. Il avait été chef d'aciérie, connaissait bien les ficelles du métier et piquait des colères terribles à chaque sabotage, menaçant les contremaîtres de déportation.
Un sabotage manigancé par Monsieur Lefebvre, chef de service à l'aciérie Thomas (résistant sous le nom de Lagroseille), produisit une explosion juste au moment d’une inspection de Jacobs et lui brûla une partie du visage, l'immobilisant pour plusieurs mois. Le 11 novembre 1942, le drapeau tricolore fut hissé sur la cheminée d'un haut-fourneau. Grâce à Monsieur Pierson, le directeur français, les représailles furent évitées de justesse. Mais il y eut quand même par la suite des déportations dans l'usine, ou à la suite de rafles contre les réfractaires au S.T.O. et les communistes.
L'une de ses rafles m'a particulièrement marquée. Je ne sais plus à quelle date elle se situe.
Un matin, très tôt, une camionnette bâchée s'est arrêtée devant chez nous. Une dizaine d'allemands en sont descendus fusil en main. Ils sont allés directement chez des voisins, les Guérin, militants communistes biens connus. Ils ont fait sortir le père, les deux fils présents, et la fille Christiane, une amie de mon âge. Ils les ont fait monter dans la camionnette. Monsieur Guérin a demandé de passer aux cabinets. Deux allemands sont restés, fusil au poing devant la porte ouverte. Nous étions pétrifiés, cachés derrière nos volets, nous les avons vu partir. Seule, Christiane est rentrée au bout de deux ans, malade pour la vie. Elle avait subi à Ravensbrück des opérations qui l'ont rendue stérile. Elle est morte aux environs de la quarantaine. La rue de Pompey où elle habitait après son mariage porte son nom.
Le plus pénible était de penser qu'ils étaient arrêtés sur dénonciation puisque les allemands sont allés directement à leur porte.
Pour ce qui est des juifs, nous ne savions pas à cette époque, le triste sort qui les attendait.
Il y avait bien des affiches antisémites un peu partout et l'on croisait, surtout à Nancy, des gens portant des brassards jaunes, sans comprendre la haine qui les poursuivait. Nous en connaissions quelques-uns qui venaient tous les jeudis sur le petit marché en face des cités. En particulier un couple, souvent taquiné, parce que la dame était une très grosse rousse très bavarde et le mari un tout petit maigrichon qui n'avait pas beaucoup la parole. Et puis Monsieur Georges, si gentil, on l'appelait familièrement "le petit juif", et il en riait. Quand mon frère était malade, il lui apportait une petite gâterie à chacun de ses passages et lui racontait des histoires pour le faire sourire.
Nous connaissions aussi les Lévy, un couple qui habitait non loin de chez nous. Tous ces gens ont disparu sans qu'on sache alors ce qu'ils étaient devenus. Nous n'avons appris que bien plus tard l'existence des camps de concentration.
J'étais terrifiée par les bombardements. J'entendais le ronronnement des avions avant que l'alerte sonne et je descendais vite à la cave, où la peur ne me quittait pas, car en plus, j'ai toujours été un peu claustrophobe et je me voyais ensevelie sous la maison.
Nous avions quand même une installation de protection prévue pour ce cas. Les caves des cités sont de bonnes caves voûtées. Nous avions installé deux matelas et de la literie dans un coin. Chaque cité comporte huit logements, quatre devant, quatre derrière. Chaque ménage avait pratiqué un trou de passage dans chaque mur mitoyen des caves ; on pouvait ainsi circuler tout autour de la citée et s'aider en cas d'éboulement.
II y avait eu un litige avant cet arrangement, car nous avions un voisin débrouillard et même voleur, une sorte d'Arsène Lupin, "ni gentleman, ni élégant", gouailleur comme un titi parisien. Il ne volait que les riches et surtout ceux qui faisaient du marché noir. Certains voisins, ne voulaient pas percer leur cave, craignant qu'il ne les vole, mais mon père s'est fâché en disant :
- Si on n'ouvre pas son mur, je n'ouvre pas le mien. Faites-lui confiance, il ne volera personne.
Ainsi fut fait et personne n’eut à le regretter.
Quelques jours après cette histoire des coups furent frappés à notre porte vers 21 heures. C'était ce voisin qui demanda à maman de lui prêter une lessiveuse. Ce qu’elle fit, toute étonnée. Une demie heure après, il revint avec son gamin, portant la lessiveuse pleine de vin. Il avait repéré à la gare un train de marchandises prêt pour l'Allemagne. Sur un wagon, des tonneaux de vin. A la barbe des allemands il a réussi à percer un tonneau et à remplir divers ustensiles, dont notre lessiveuse. C'est ainsi que mon père fut remercié de sa confiance.
L'hiver 41 a été très dur. Maman avait fait quelques provisions, mais en quarante, quand les prisonniers ont défilé devant chez nous, nous avons installé des tables sur les trottoirs et distribué toute la réserve : café, sucre, biscuits, chocolat. Il ne nous restait rien.
Puis ce fut le rationnement ; les cartes nous donnant droit à un morceau de pain gris, pas levé, sans goût ; la viande quasiment inexistante, le sucre remplacé par la saccharine, de la poudre d'œufs pour les omelettes. Il n'y avait plus rien dans les magasins. Tout était réquisitionné pour l'armée allemande. Quand on entendait parler d'un arrivage quelconque, on se précipitait pour faire la queue pendant des heures, pour s'entendre dire parfois :
- Trop tard, il n'y a plus rien.
J'ai vu une femme s'évanouir d'épuisement et de faim près de moi.
Nous sommes allées, maman et moi, plusieurs fois jusqu'à Nancy à pied, en partant à quatre heures du matin pour avoir peut-être un petit bout de lard au marché. J'ai pleuré de froid et de faim pendant cet hiver. La sœur Irma qui me voyait maigrir et pâlir me glissait parfois une tartine de confiture. Que c'était bon !
Notre jardin était trop petit pour y cultiver des pommes de terre et on n'en trouvait plus dans le commerce. Nous ne mangions que des rutabagas et des topinambours. Autant dire de l'eau. Mes parents qui étaient des "costauds" avant la guerre ont perdu plus de 30 kilos. J'ai des photos de mon père qui font peine à voir. Il pesait à peine 50 kilos et il était épuisé par une bronchite chronique qui ne l'a plus quitté. Quand à maman, déjà malade depuis la mort de mon frère, elle a eu un courage extraordinaire.
Les allemands ayant planté de grands champs de pommes de terre à Rozières, embauchaient pour l'arrachage. C'était en 42. Maman y est allée ; 12 kilomètres à pied matin et soir, arrachage toute la journée. Quand elle rentrait, elle tombait sur le lit, épuisée. Elle était payée en pommes de terre et au bout d'un mois de cette galère, nous avions grâce à elle une provision de tubercules pour l'hiver à venir. Mais ma pauvre mère était épuisée, à bout de force. Je me souviens qu'un soir elle est rentrée en larmes. Elle avait caché quelques pommes de terre dans son sac, mais une fouille a eu lieu à la sortie du champ, surveillée par un allemand à cheval, revolver en main pour effrayer ces malheureuses. Nous ne voulions pas qu'elle y retourne, mais elle n'a pas voulu arrêter quelques jours avant la distribution.
Je sais qu'elle se sacrifiait surtout pour moi. J'étais en pleine adolescence, je faisais du sport, du basket et j'en sortais affamée. Nous avions en tant que "J3" une petite ration de biscuits vitaminés que je détestais, mais je les grignotais pour tromper la faim. Le docteur Zivré m'a prescrit des piqûres pour me remonter.
C'est aussi en 1942, qu'eût lieu le mariage de mon cousin Jean Dapremont avec Marcelle Alix. J'avais pour cavalier le frère de la mariée, Louis dit Loulou. Je nous revois encore autour de la table bien garnie car ma tante élevait des poules et des lapins. A la fin du repas chacun poussait sa chanson. L'oncle Emile avait une belle voix et chantait "Dolorosa", et des chansons un peu coquines comme "La Petite fruitière", "Le Chauffeur". Sa sœur, Madame Rambour nous faisait pleurer avec "L'oiseau qui vient de France". Mon père se défendait bien avec "L'océan" et surtout "Plum Plum Tralala" qu'on reprenait tous en chœur. Maman se taillait toujours un petit succès avec son répertoire et je n'étais pas en reste. Il y avait encore la grand-mère Dapremont, mère de l'oncle Emile.
Les Rambour habitaient Pompey et je connaissais bien Lucienne, leur fille (actuellement Madame Barthés) qui fréquentait aussi le patronage. Elle avait 5 ou 6 ans de plus que moi et son fiancé était prisonnier.
Nous avons dormi ensemble ce soir-là, mais très tard car Lucienne m'a longtemps parlé de son fiancé. Elle tremblait pour lui et se demandait s'ils seraient encore longtemps séparés.
De ce mariage est né Jean (dit Jeannot), le 5 octobre 1942. Mais les nuages ont vite surgi dans le ménage. La petite maman était très jeune et inexpérimentée. Ils ont divorcé quelques années plus tard, et ma tante a élevé le petit Jean. Quand elle venait chez nous, à pied depuis Frouard, elle portait le gamin sur son dos.
Mon cousin Jean s'est remarié en 1949, avec Reine Rubis. Après la perte d'un magnifique bébé, mort quelques heures après sa naissance. Reinette a mis au monde Bernard, un beau et gentil garçon, aimé de toute la famille, qui a été fauché et tué au bord de la route par un chauffard en 1967. Il avait 18 ans. Ce fut atroce pour les pauvres parents, surtout Reinette si jeune et si gaie qui n'a plus jamais été la même. Comme maman, elle ne s'est un peu remise qu'avec les enfants de Jeannot.
C'est à cette époque, étés 42 et 43, que j'ai suivi deux sessions de gymnastique intensive à Nancy pour être monitrice d'éducation physique. Le moniteur, Jean Neumar, était un sportif accompli et très exigeant.
Nous étions logées à l'école du Montet à côté de la ligne de chemin de fer et en face de la kommandantur de l'avenue de la Garenne. Quand il y avait des bombardements, nous nous tenions la main, avec mon amie Jacqueline, et nous pensions très fort à nos parents, nous demandant à chaque secousse si Pompey était bombardé (nos parents à Pompey craignaient alors pour nous).
Tous les jours nous descendions à pied jusqu'à la pépinière pour les différents entraînements : course, saut, grimper, gym. C'était très dur. Quand il pleuvait, nous rentrions crottées et fourbues. Mais malgré la fatigue et la faim, nous étions joyeuses. Nous chantions beaucoup avec une monitrice très musicienne qui nous a appris de beaux chants à deux ou trois voix : "le Rêve passe", "la Nuit de Rameau", mais aussi des chansons gaies de marche ou de veillée. Nous nous étions faits des amies. Surtout Geneviève de Nancy et Margot du pays haut que j'ai retrouvées des années plus tard, curieusement, l'une directrice de la clinique où ma belle-fille Nadine accouchait de son premier garçon, l’autre voisine de ma cousine à Vandœuvre. On nous appelait amicalement les "Pompey" ou ironiquement les "Saint-Charles", parce que les bonnes sœurs nous obligeaient à mettre des culottes bleues avec des élastiques au-dessus du genou, alors que toutes les autres étaient en short.
Ah ! Ces culottes, on en aurait volontiers fait de la charpie. Mais nous étions bien surveillées par Aida, plus âgée que nous, qui a pris le voile quelques années plus tard. Nous suivions aussi des cours d'anatomie et de secourisme avec un docteur. Il nous fallait donner des cours d'éducation physique à des gamines, sous l'œil d'un moniteur. La fin de la session se terminait par un sévère examen. Je n'ai d'ailleurs eu qu'un diplôme d'aide monitrice car je n'avais pas 18 ans.
Depuis 1940, pendant les vacances, les sœurs et les curés faisaient patronage à l'avant- garde. là où se situe à présent le centre aéré. Il n'y avait à cette époque que la maison des gardiens flanquée de deux grands préaux côté fille et côté garçon.
Nous montions tous les jours à pied après avoir fait le ramassage des plus petits dans nos quartiers. Nous avions chacune un groupe de gamines dont nous avions la charge toute la journée. Le matin, à tour de rôle, corvée de peluches. À midi on servait le repas préparé par madame Canard (mère de 18 enfants). Ensuite, corvée de vaisselle. Et tout cela gratuitement, contentes d'être nourries à midi. Il en était de même chez les garçons, avec un abbé et quelques ados.
Les légumes venaient du jardin de l'hospice. Je ne sais pas comment les sœurs se débrouillaient. Je ne sais plus si les parents donnaient quelques francs et quelques tickets, mais c’était formidable. Nous y mettions tous notre cœur, les gosses étaient heureux, nous aussi, et les parents donc ! Quand je vois les exigences des animateurs et animatrices du temps présent ça me fait rêver.
Pendant ces années de famine, papa prenait souvent sa bicyclette et partait en campagne panier de pêche au dos, dans l'espoir de trouver quelques victuailles. Il en a fait des kilomètres, le pauvre homme, et souvent pour rien. Il emportait pourtant sa ration de cigarettes et offrait de payer pour quelques œufs, un peu de lard ou de beurre, mais il rentrait bredouille.
Un jour à Tremblecourt, il est entré dans une ferme. Les gens se mettaient à table. Il a salué, personne n'a répondu. Il a demandé à acheter quelques œufs. Pas de réponse. Et ça sentait bon la soupe au lard ! " Reçu comme un chien", disait-il les larmes aux yeux.
Un autre jour à Faulx, il voulait acheter des mirabelles. Personne n'a voulu lui en vendre. Alors, en rentrant, de rage, il a secoué un mirabellier et rempli son panier.
Je ne sais plus si c'est en 42 ou 43 que j'ai fait le deuxième grand voyage de ma vie. Les jeunes gens des années 21, 22, et 23 étaient requis pour le S.T.O. Mes cousins Gaston et Georges étaient en Allemagne. Gaston ayant eu une permission, décida de fuir dans le Gard où nous avons de la famille.
 |
Pour qu'il soit moins remarqué, nous sommes parties avec lui, ma grand-mère et moi. Pauvre mémère Byelle, elle avait 70 ans ! Quel voyage fatigant. Nous avons passé une nuit blanche à Dijon, assis sur nos valises, puis debout dans le train jusqu'à Avignon. Là, un de nos cousins nous attendait avec une camionnette découverte. Mon premier contact avec le midi dont je rêvais, fut une épreuve contre le vent, vingt kilomètres dont je sortis vaincue avec un gros rhume. |
Ils n'avaient pas tué le veau gras pour notre arrivée, ni la dinde traditionnelle, mais un mouton ! Les cousins et les voisins étaient invités. Une vraie fiesta ! Jamais je n'avais vu autant de nourriture sur une table, et pour terminer, ils m'ont fait goûter une liqueur du pays qui m'a achevée. Je me suis réveillée le lendemain dans un fauteuil près de la cheminée. Les cousins me taquinaient en me disant que la veille j'étais montée sur la table pour chanter "Cheval de bois", une chanson sketch, entendue auparavant dans un spectacle du patronage.
Nous sommes restés une semaine à Laudun. Je me sentais revivre. C'était la fête tous les jours chez l'un ou chez l'autre des voisins.
J'aurais même pu m'y marier. Mais oui ; il s'appelait Louis, le fils du fermier voisin et il voulait que je reste là-bas. Il m'avait même tendu un traquenard en m’invitant à boire un café avec sa famille, mais arrivée chez lui, j'ai constaté qu'il était seul et que ses intentions n'étaient pas très pures. Olé, olé ! Je suis vite retournée chez mes cousins et l'histoire en est restée là. Du moins pour moi, car il m'a écrit pendant quelques temps, mon mutisme a fini par le décourager.
Ensuite, nous sommes partis un peu plus loin vers Nîmes. À Cavillargues, chez les cousins boulangers, deux bons gros vivants : Léontine, une nièce à ma grand-mère et Fernand. Ah ! le bon pain blanc que j’ai mangé là. J'en avais oublié le goût. Tous les jours, pain frais, croissants, et fougasses pour déjeuner. Le rêve ! Fernand faisait encore le pain au pétrin comme autrefois, un vrai délice. Son fils Arthur avait 18 ans et travaillait avec lui. J'ai fait avec eux quelques tournées dans les villages et la garrigue pour livrer le pain. J'étais heureuse, j'aimais la Provence, son accent, ses gens si gais. J'oubliais la guerre. Nous sommes restés chez eux quinze jours. Léontine voulait me garder, je faisais le ménage, je raccommodais. Un jour elle m'a demandé "avé l’assent" :
- Veux-tu mettre des pétassougnes à la braille de Fernand.
Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait. Puis j'ai compris qu'il fallait poser des pièces au pantalon.
Le troisième neveu de ma grand-mère s'appelait Maurice Dappe. Il habitait le château de Cavillargues. Un vrai ancien château fort avec une tour, des murs épais et un grand escalier de pierre, majestueux et impressionnant. La cousine s'appelait Marthe comme moi. Leur fils Jean avait 18 ans. Ils étaient vignerons. Ils avaient un autre fils dont le père ne voulait pas parler car il était milicien. La pauvre cousine Marthe semblait minée par le chagrin.
Maurice était communiste et résistant, son voisin le curé résistant lui aussi, venait parfois au château. Ils avaient des discussions homériques, comme Pépone et Don Camillo.
Ce brave Maurice qui a hébergé bon nombre de réfugiés dans sa grande maison, était un idéaliste. Dans les années 60, ayant perdu toutes ses illusions sur le communisme tel qu'il l'envisageait, il s'est pendu dans sa grange. C'est son fils Jean qui l'a découvert un matin et qui en est resté traumatisé pour la vie (atteint d'un cancer, vingt ans plus tard, il s'est tiré une balle dans la tête).
Il y avait encore une quatrième nièce, à Saint-Chaptes, toujours dans le Gard, la cousine Léa Dappe, épouse Laygues. Nous y sommes allées passer une journée. Elle avait deux filles et un garçon. Ma grand-mère était heureuse de les revoir tous. C'était un peu de sa jeunesse en Meuse qui revivait. Mais il a bien fallu songer au retour.
Il nous fallait revenir seules, sans Gaston. Et nous avons dû, à Dijon monter dans un train bourré d'allemands. Or, à ce moment, il y avait quantité d'attentats contre les convois allemands. Ils avaient une peur bleue (et nous donc). A chaque secousse du train, ils se couchaient sous les banquettes. Nous, stoïques, ne bougions pas. Pas question de s’allonger près d'eux. Mais quel soulagement d'arriver enfin saines et sauves au bout de ce cauchemar, et de retrouver mes parents aussi inquiets sur notre sort que nous l'étions du leur.
Il me fallait réintégrer l'ouvroir. Ce dernier ayant été réquisitionné pour héberger des familles sinistrées lors des bombardements, était transféré à la maison d'Orlan proche de l'hôpital. Nous en étions bien contentes, car le cadre était plus agréable, entouré d'un magnifique parc. C’est là qu'au mois de janvier, la sœur supérieure nous informa que l'ouvroir allait devenir l'école professionnelle et ménagère Saint-Louis.
En plus de la lingerie et de la couture, nous avions des cours d'hygiène, de puériculture, de cuisine et d'économie domestique.
Et je fus sollicitée pour servir de cobaye au premier CAP arts ménagers, couture. J'avais six mois pour le préparer. Ce fut le parcours du combattant. J'étudiais partout, même à la cave pendant les alertes. Mais le plus difficile c'était la cuisine. Apprendre à cuisiner quand il n'y a rien à mettre sur la table, c'était un problème. J'ai tout de même réussi à faire de la pâte à tarte grâce à ma grand-mère. Elle avait pu se procurer un petit sac de blé, je ne sais où, elle moulinait ce blé pour en faire de la farine.
Justement à l'épreuve de cuisine, j'avais à faire un plat avec recette, une blanquette ! et un plat sans recette, une tarte aux pommes. La blanquette "ratée" ne mérita que 1 sur 10, mais la tarte réussie fut récompensée d'un 10. Ouf ! La moyenne était sauve.
Mais le souvenir le plus cocasse, c’est celui de l'épreuve de couture qui eut lieu le deuxième jour. Il faut dire que, les aiguilles de machine étant très rares, les sœurs ne nous apprenaient pas à piquer. Nous préparions le travail et c'était elles ou les monitrices qui piquaient.
Donc, au CAP, la directrice nous présenta un tablier d’écolier classique ; empiècements, plis, boutons sur le côté, manches longues et poignets boutonnés. Nous avions chacune un patron, une pièce de tissu et il fallait couper, monter et piquer ce tablier. Consternation! je ne savais pas piquer. Tout en coupant mon tablier, je versais une larme en pensant que c'était fini pour moi. Une monitrice est passée et m'a demandé ce qui n’allait pas. À l'écoute de mon problème elle me conseilla de soigner au mieux le montage et de sécher mes larmes. Ce que je fis.
Le lendemain, ô surprise. La directrice présenta mon tablier aux participantes en disant :
Voyez, celle-ci a tellement bien soigné son montage qu'elle n'a pas eu le temps de piquer. Alors que d'autres ont piqué de travers pour avoir mal faufilé.
Et j'ai eu une bonne note ! Tout le reste s'étant bien passé, je l'ai eu ce CAP. Dans la foulée, j'ai passé un concours de la meilleur maîtresse de maison, où j'ai raté la première place parce que j'avais oublié de compter le "prix du sucre dans la confiture". Tant pis, j'étais deuxième et les bonnes sœurs jubilaient pour la renommée de la nouvelle école et j'ai eu les honneurs du journal.
La voie était ouverte, et l'année suivante, ce furent quatre élèves qui passèrent le CAP avec plus de temps et de moyens pour s'y préparer.
Pendant tout ce temps, la guerre continuait, les alertes, les bombardements, les nuits sans sommeil, la faim au ventre.
On avait parrainé des prisonniers à qui on envoyait des colis, avec ce qu'on pouvait trouver. On priait beaucoup pour eux, d'ailleurs on ne faisait que cela ! J’ai oublié de décrire nos "ferventes journées".
J'allais tous les jours à la messe de 7 heures, pour faire ensuite le catéchisme aux futurs premiers communiants. Après avoir bu une tasse d'ersatz de café à la cuisine de l’hospice, je filais à l'ouvroir, où la journée commençait par la prière du matin. À midi, l'angélus ; à 15 heures, le chapelet ; à 17 heures la prière du soir.
Après le chapelet, on avait une demi-heure de lecture. Ensuite on chantait jusqu'à l'heure de la prière. Beaucoup de vieilles chansons apprises de nos mères respectives, parfois des cantiques. Et pourtant, malgré cette austérité, quand nous pouvions nous défouler, nous savions nous amuser car la moindre occasion de détente était la bienvenue.
Un jour de rébellion contre la discipline, j'avais fait une chanson sur l'air de la marseillaise (ce qui m’a valu ensuite une sévère réprimande de sœur Maurice) :
Allons enfants de l'indépendance
Chez nous le rire est invité.
Nous aurons toujours de la chance
Si nous gardons notre gaieté (bis)
Entendez-vous dans cette salle
Fuser les rires éclatants
Contre le cafard expirant
Nous publierons bientôt nos annales
la fin de la vie
Quand nous aurons bien ris
Nous pleurerons le rire perdu
Mais le cafard sera vaincu.
Je me souviens des fêtes de Saint-Nicolas, de Saint-Charles patron des religieuses, Saint-Édouard patron de l'hospice. A la Sainte-Catherine, il y avait toujours des filles de plus de 25 ans à fêter. Ah ! Les beaux chapeaux qu'on inventait alors. C’était à qui aurait la meilleure idée, la composition la plus originale. J'en ai fait des poèmes pour les catherinettes ; on leur faisait des farces pour les taquiner.
Je me souviens surtout d'une fête de Saint-Édouard. Les sœurs avaient fait des prodiges pour nous offrir un repas. Nous voulions faire une surprise à la supérieure. J’ai imaginé de singer le conseil municipal. En tout bien, tout honneur, j'étais le maire. J'avais préparé un discours pour saluer mes concitoyens et leur présenter les membres du conseil, en retournant les noms des vrais conseillers, et ajoutant quelques autres.
Donc :
le maire, monsieur Corde (Decorps)
le docteur Vrézy (Zivré)
Madame Frainedu (Dufraine)
Monsieur Coeurchaud (Choquert)
Madame Quiné (Hennequin)
Monsieur l'abbé Yodou (Douillot)
Madame Peutebête. présidente de la société protectrice des animaux. Nous avions confié ce rôle avec plaisir à celle qui avait le plus mauvais caractère. J'en oublie sans doute. Nous avions trouvé de quoi nous grimer et nous habiller, aidées par les bonnes sœurs qui s'amusaient autant que nous. Nous sommes arrivées en cortège jusqu'au repas. J'ai fait mon discours à la supérieure, non prévenue. C'est bien la seule fois où je l'ai vu rire aux larmes. Il faut dire que nous étions plutôt cocasses avec nos déguisements. Nous aurions fait de beaux modèles pour Dubout. Après ce repas, nous avons fait le tour du pays, en faisant une halte dans chacune de nos familles. Ce fut une soirée mémorable (et il n'y eut pas d'alerte). Ces petites fêtes nous aidaient à supporter tous les désagréments qui nous accablaient.
J'étais en pleine croissance. Je n'entrais plus dans mes vêtements. La plupart des femmes confectionnaient des manteaux dans des couvertures de soldats qu'elles teignaient. C'était affreux. Alors, j'ai décousu un pardessus bleu de mon frère, conservé jusque-là par maman, et je me suis fait un manteau. Pour l'agrémenter, ma grand-mère avait tanné une peau de lapin dans laquelle j'avais coupé un col.
On détricotait tous ce que l'on trouvait et on mélangeait ces restes de laine pour en faire des pulls bariolés, pas très élégants. Quand on trouvait de la laine, ou du coton avec nos points textiles, c'était de la mauvaise qualité. Ma grand-mère m'avait tricoté une veste en coton. Après lavage, elle descendait jusqu'aux genoux. Redétricotée, on en a fait des chaussettes.
On se coiffait d'un turban avec une écharpe. Quant aux chaussures, c'était le tam-tam des semelles de bois, que chantait Maurice Chevalier.
Il m'est resté de ce temps-là un respect des vêtements peut-être poussé à l'extrême. Je garde très longtemps mes affaires. J'ai horreur du gaspillage des vêtements comme de la nourriture.
En 1941, Madame Schlecht, une couturière de l'avenue Gambetta était venue nous donner des cours de moulage, c'est-à-dire couper directement un patron sur un mannequin. J'aimais beaucoup cela. En 43. cette dame qui avait apprécié mon travail, demanda à sœur Maurice de me laisser travailler chez elle les matins, pour perfectionner ma couture.
Elle avait une fille, Suzanne, née en 1914. une très belle fille qui promenait souvent son chien rue Gambetta. Elle était fiancée à un aviateur qui fut tué tout au début de la guerre. Elle voulait le venger en faisant de l'espionnage. Mais elle fut arrêtée et incarcérée à Ravensbrück dont elle ne revint pas.
Sa pauvre mère a été très longtemps sans aucune nouvelle ; j'étais chez elle quand elle a appris sa mort en 1943. C'était atroce de l'entendre hurler : "ma Suzette, qu'est-ce qu'ils ont fait à ma Suzette". Elle a été longtemps malade, je travaillais souvent seule. Je crois que c'est son jardin et ses fleurs qui l'on sauvé du désespoir. Elle adorait jardiner. Elle me parlait souvent de sa fille, me lisait des lettres d'elle. J'ai toujours une broche qu'elle m'a donné en souvenir.
Je m'étais attachée à elle parce qu’elle était très intelligente et m’apprenait beaucoup de choses. On écoutait les informations et elle les commentait. Elle m'a appris à aimer le théâtre classique. Tout en travaillant, on écoutait des pièces de Racine ou de Corneille et j'aimais ça.
En parlant théâtre, je me souviens d'une anecdote qui nous a bien fait rire. Elle avait un cousin qui ressemblait à l’acteur Charles Vanel. Chaque fois qu’il venait elle me disait :
- Tiens, voilà Charles Vanel.
Un jour, il est arrivé alors qu’elle était au jardin. Je l’ai appelée en lui criant :
- Madame Schlecht, Monsieur Vanel est là.
Lui était tout étonné et elle, bien amusée. En réalité, il s'appelait monsieur Dehart, mais je l'ignorais.
Mais quand on entendait les bottes des allemands et leur "Hali Halo" dans la rue, on ne riait plus.
Les années passaient, longues et difficiles. On ne savait pas très bien ce qui se passait, trompés par la radio française. Tout ce que l’on sait à présent avec le recul, sur Vichy, puis sur la résistance, le maquis, on l'ignorait alors.
De 1940 à 42, après avoir été anéantis par la capitulation, on a cru au maréchal Pétain. C’est facile de jeter la pierre maintenant, mais à qui pouvait-on faire confiance ? J’ai chanté comme des milliers de jeunes : "Maréchal nous voilà, devant toi le sauveur de la France". J’ai chanté de tout mon cœur et au début, j'y croyais. Laval est venu à Pompey et a serré les mains de bien des gens qui le renieraient aujourd'hui. Mais nul ne pouvait prévoir la suite des événements.
Les allemands qui occupaient Pompey de 1940 à 42, n’étaient pas des SS. C’était des bavarois. Ils essayaient souvent de lier conversation avec les français. Nous avions une voisine qui parlait allemand. Comment l’ont-ils su ? Je l’ignore, mais un jour cette voisine est venue chez nous avec deux allemands. Ils étaient sur le point de partir en permission et désiraient apporter à leurs femmes et leurs filles des bijoux et des capuchons en soie huilée. Ils me demandaient de les acheter pour eux à Nancy. J'étais bien ennuyée, parce que, alors que je détestais les allemands en bloc, je trouvais ceux-là bien sympathiques. Ils avaient l’âge de mon père et ne désiraient qu’une chose, rentrer chez eux. Ils nous ont expliqué (à leurs risques et périls) qu'ils n’aimaient pas Hitler et craignaient les SS, capables de tuer leur propre famille par fanatisme. J’ai compris qu’ils étaient sincères et j’ai fait leurs emplettes.
Quand ils sont revenus d'Allemagne, ils m'ont rapporté un petit cadeau de leur fille pour me remercier, en m'invitant ainsi que mes parents à venir les voir après la guerre. Ils n’ont pas tardé à être rappelés ailleurs et n’en sont sans doute pas revenus. Je me souviens que le plus âgé (pour moi, à ce moment, la quarantaine c’était beaucoup) s'appelait Heinrich Günther et habitait Kaiserslautern, qui a été bientôt anéantie par les bombardements.
Ce n'est qu'en 43 que nous avons entendu parler de groupes de résistance dans les environs. Un soir de cet hiver, nous avons entendu un bruit de choc sur la route. Entrouvrant prudemment la porte, nous avons vu une femme renversée près de son vélo. Une moto était arrêtée, deux hommes en sont descendus et nous ont demandé de rentrer cette femme chez nous. Il fallait faire vite, à cause du couvre-feu et des patrouilles allemandes. Ces hommes étaient des résistants en mission et ne voulaient pas être vus. La femme n'avait pas perdu connaissance, mais elle était blessée à la jambe et au bras. J'ai couru en me cachant souvent jusqu'au village chez le docteur Zivré qui est revenu avec moi en voiture. Après avoir examiné cette femme, il nous l’a laissée pour la nuit. Le lendemain matin, il l’a fait transporter à l’hôpital. Je suis allée la voir chaque jour pendant une semaine. Je lui avais prêté des livres auxquels je tenais beaucoup parce qu’on y parlait de ce qui c'était passé dans le pays de maman en 1914. C’était plusieurs fascicules rangés dans une serviette en cuir de mon frère. Et bien, cette femme est repartie avec les livres et le sac de cuir et je ne l'ai jamais revue.
Puis ce fut l'année 44, difficile à relater tant les souvenirs se chevauchent dans ma tête. Cependant, à l’heure où j’écris ces lignes (septembre 94) on commémore partout l'anniversaire de la libération. Je revois dans les journaux les dates des différents événements et cela m'aide un peu à mettre de l'ordre dans mes souvenirs.
Pendant l'hiver 43-44, on savait vaguement, par radio Londres, très difficile à capter chez nous, que les allemands avaient subi de lourdes pertes en Russie, que les alliés tenaient l'Afrique du Nord, puis débarquaient en Italie.
Le 6 juin 44, ce fut le débarquement en Normandie. Nous ne savions toujours pas grand-chose, sauf qu'il y avait des groupes assez importants de résistance un peu partout.
Un jour de juillet, en sortant de l'ouvroir, nous fûmes, mon amie et moi les témoins épouvantés d'une bataille d'avions. Nous nous sommes couchées dans le caniveau. C'était terrifiant ! Un avion anglais fut touché, et est allé tomber à Millery. Cinq canadiens ont été tués. Un avion qui tombe, c'est comme un immense hurlement, long et déchirant, qui vrille les oreilles et se termine par une forte explosion.
Le 25 août, nous avons appris par radio Londres la libération de Paris et nous nous demandions avec angoisse quand et comment elle se passerait en Lorraine. |
 |
Un soir, des soldats allemands s'étaient assis et discutaient sur le soupirail de la cave. Nous étions anxieux, n'osant bouger et craignant que les enfants fassent du bruit, car on savait que les allemands terrifiés par les attentats qui se multipliaient, et se sachant perdus, auraient pu jeter une grenade dans la cave. Tant de bruits circulaient, vrais ou faux.
On disait que des collabos se cachaient sous des habits de prêtres ou de bonnes sœurs pour dépister d'éventuels résistants. On trouvait parfois des tracs disant : "Taisez-vous, des oreilles ennemies vous écoutent". C'était le règne de la peur et de la méfiance. |
 |
Le 5 septembre, ils fusillaient Roland Georges, devant sa maison. Sur dénonciation, ils avaient fouillé celle-ci et trouvé une arme sous son matelas. Je le connaissais, car il était venu quelques mois auparavant faire des travaux de menuiserie dans nos cités.
 |
Ce même jour, Charles Bernard, fut fusillé près du Casino. Un peu plus tard, le 12 septembre, ce furent Roger Laurent, fils de cafetiers de la rue de Metz, et Charles Aigle, beau-frère de Roland Georges. Ce pauvre homme, père de 7 enfants ayant tenté de se sauver en barque, fut mitraillé depuis la rive. C'est écœurant de penser que des français ont pu ainsi désigner leurs compatriotes aux allemands. Qui étaient-ils ? Jamais on ne l'a su. |
J'avais là une amie, Jacqueline Grisneaux, jolie fille très gaie et dynamique, élève aussi de l'ouvroir Saint-Louis. On la voyait souvent se lever, toute pâle et courir à la cave. Quelques minutes après, la sirène hurlait et les avions arrivaient. Elle les sentait venir ; c'était vraiment de la prémonition.
Ses parents tenaient l'établissement de bain à la limite des citées Saint-Euchaire. Le jour du bombardement, Jacqueline et sa sœur Jeannette sont allées se réfugier dans une cave voisine. Hélas, une bombe est tombée juste sur cette cité, creusant un énorme entonnoir. Elles ont été ensevelies avec plusieurs voisins. Le déblaiement a été très long. Les sauveteurs ont dit plus tard, que quand ils ont trouvé Jacqueline, elle était intacte et semblait dormir, sans doute morte asphyxiée. Les pauvres parents n’avaient que ces deux filles. Vraiment marqués par le sort, ils sont morts tous deux une trentaine d'années plus tard, asphyxiés dans leur sommeil par un poêle défectueux.
Le 11 septembre, encore une journée d'horreur. Il faisait très beau, pendant une accalmie de tirs, nous étions montés prendre l’air devant notre porte. Nous bavardions un peu avec des voisins et deux femmes qui allaient rentrer chez elles. Soudain, le canon s'est remis à tonner. Nous sommes redescendus précipitamment. Avec nous, est descendu monsieur Lefebvre dit "La groseille" qui venait d'être blessé à la jambe et à l'épaule.
J'avais toujours à la cave une petite pharmacie. Monsieur Charront et moi avons soigné le blessé aussi bien que possible en attendant les secours car il fallait lui retirer les éclats d'obus. Il rentrait d'une mission pour les FFI et nous a appris qu'une compagnie américaine d'une dizaine d'hommes avait été anéantie l'avant-veille dans les bois de Marbache.
Quand nous avons pu remonter, nous avons découvert avec horreur, les cadavres des deux femmes avec qui nous avions parlé ; Mesdames Ferbus et Levèque, tuées par des éclats d’obus.
Le lendemain, le voisin débrouillard et monsieur Charront ont tué un cheval, je ne sais où. Ils l'ont découpé et distribué dans le quartier. Ma grand-mère avait récolté quelques haricots en grain et nous avions mis la table, nous apprêtant à faire un vrai bon repas avec viande et légumes.
A ce moment, les chefs de sécurité sont passés nous ordonnant de partir sans délais, le secteur devenant plus dangereux d’heure en heure. La mort dans l’âme, nous avons entassé rapidement quelques affaires dans une valise, quelques rares provisions dans le symbolique panier de pêche et nous sommes partis en laissant le repas sur la table. Sur le conseil des agents de sécurité nous sommes descendus sous l’usine par les estacades, sorte de canaux peu profonds, bordés d’un étroit chemin cimenté sur lequel on marchait à la file indienne, dans l’obscurité. Soudain quelqu'un trébucha ; on entendit un plouf et maman s'écria :
- Je suis sûr que c'est mon gros (surnom immérité du paquet d’os qu'était devenu mon pauvre papa).
De fait, c’était bien lui. Peut-être entraîné par le poids du panier à pêche ?
Enfin, sorti de ce tunnel nous avons rejoint la voie ferrée et retrouvé là mon oncle Jules et ma tante Jeanne, venant des citées Saint-Euchaire.
Mais ma pauvre tante a dû bientôt renoncer. Elle était épuisée et voulait retourner chez elle. Nous avions le cœur gros de les voir repartir tous deux. Ma grand-mère et maman pleuraient.
Soudain, je me suis aperçue que papa boitait, sans doute à cause de sa récente chute. Je lui ai pris le panier à pêche pour le soulager un peu. Je portais une jupe cloche qui mérita deux fois son nom ce soir-là. Dans ce panier, maman avait mis du sucre acheté au marché noir, et patiemment trié car il contenait des crottes de souris. Mais ce sucre, ayant chuté avec mon père dans les estacades, avait fondu et dégoulinait sur ma jupe de mauvaise toile qui, devenue raide comme du carton, me tapait dans les mollets à chaque pas. On a ri plus tard à ce souvenir. Mais pour l’heure, on marchait dans le fossé au long des rails nous baissant le plus possible car nous étions encore dans le champ de tir entre Pompey et Clévant.
Arrivés à Marbache, après avoir escaladé le talus pour retrouver la route, nous sommes descendus dans les caves d’une grande cité, à l’entrée du pays, pour nous reposer. Presque aussitôt, il y eut un bombardement. Une bombe est tombée à une centaine de mètres creusant un entonnoir au centre de Marbache. Nous sommes repartis à l’aube, en prenant la direction de Saizerais. Dans les bois, de chaque côté de la route, gisaient les cadavres des soldats allemands. On pensait à ces jeunes soldats qui étaient passés devant chez nous quelques jours auparavant. Presque des enfants, qui nous faisaient pitié malgré tout. Ils partaient renforcer les défenses vers Saizerais. Il n’a pas dû en rester beaucoup ! Nous avons ainsi marché jusqu’à Rosières, où le maire nous a disséminés dans le village. Nous étions environ une quinzaine dans une maison abandonnée tout au bout du pays. Il n'y avait que deux pièces sans étage. On dormait par terre, entassés sur du foin. Il y avait parmi nous de jeunes enfants pas très propres et j'ai attrapé des puces et des poux, bien difficiles à déloger sans aucun produit sous la main. Maman avait bien de la patience pour l'épouillage !
Chaque famille était nourrie par les habitants du pays, heureusement en majorité des cultivateurs, qui ne manquaient pas de légumes.
C'est à Rosières que j'ai vu les premiers américains. Ils étaient installés dans de grandes tentes à l'orée du bois, là où est l'actuel camp d'aviation. C'est l'origine de la base Toul- Rosières.
Dans notre groupe, nous n'étions que deux jeunes filles, Jeanine et moi, n'ayant rien d'autre à faire que nous promener. Elle cherchait toujours a m'entraîner vers le camp car elle flirtait avec un GI. Je résistais, préférant l'attendre à la sortie du village assise à l'ombre d'un arbre.
Un jour, un américain est passé et s'est arrêté. Il parlait un peu le français et m'a dit de ne pas fréquenter cette fille qui n'était pas sérieuse. Vexée, je lui ai répondu qu'on était bien obligées de vivre ensemble pour quelques jours et que je ne pouvais pas l'ignorer. Alors, ce John, très gentil et sérieux est revenu tous les jours devant notre refuge. Il nous montrait les photos de ses parents, d'une sœur qui avait mon âge. Il me parlait des chanteurs américains et fredonnait des chansons en s'étonnant que je ne les connaisse pas. Il nous apportait du café soluble, des biscuits et des bonbons. Jamais il n'a eu un geste déplacé.
Par contre, un jour où nous étions allés, papa et moi jusqu'à Tremblecourt nous avons failli nous faire tuer par un noir américain ivre, qui s'amusait à canarder les environs de l'église. Nous avons rebroussé chemin à toute allure.
Nous avons dû rester une quinzaine de jours à Rosières. Enfin, le maire nous fit savoir que Pompey était libéré, les allemands ayant tenu Bouxières jusqu'au 23 s'étaient rendus. Nous pouvions rentrer chez nous.
Pour plus de sûreté, nous sommes revenus par Liverdun où nous avons pu nous rafraîchir au passage chez ma tante Lartillot, la soeur de mon grand-père paternel. Elle avait deux filles, l'aînée Marie a pris voile sous le nom de sœur Dominique, chez les Sœurs de Saint-Charles. La seconde. Germaine, mariée à Raymond Trouvin, avait un fils, Gérard, hélas infirme de naissance. Elle était sans nouvelles de son mari, mobilisé dans la marine et se faisait beaucoup de soucis.
En me voyant, elle s'est écriée :
- Dieu merci, tu es de retour. Ici, tout le monde te disait morte.
En fait, le cadavre de madame Levèque était resté près de chez nous après notre départ, recouvert d'une couverture. Seuls dépassaient ses cheveux blonds et le bruit courait que j'avais été tuée.
Nous avons ainsi appris une partie du déroulement des dernières batailles. Dans la nuit du 9 au 10 septembre, les allemands avaient dynamité l'ouvroir et quelques maisons voisines, parce qu'elles gênaient leur tir. Puis la centrale électrique de l'usine a sauté. Le 12 septembre, les habitants du faubourg et du village ont dû s'enfuir comme nous, mais vers Frouard, en grimpant une échelle sur le pont partiellement détruit. Il fut de nouveau dynamité le 14.
Le 15, les cités et l'usine de Montataire (où se situe l'actuel port de Frouard) étaient incendiées. Il y eut encore des fusillés et des victimes des canonnades.
Les américains et les FFI étaient entrés le 15, mais les allemands résistaient encore à Bouxières et la bataille ne fut achevée que le 23, après la reddition.
De Gaulle est venu à Nancy le 25.
Quelques années plus tard, en 1948, Pompey a été citée à l'ordre de l'armée pour son courage avec ces mots "l'usine qui abritait 500 réfractaires au STO, était un centre important de passage d'évadés. Hommage fut rendu aux pompiers, à la défense passive, et surtout au groupe de résistance armé qui a maintenu l'ennemi 11 jours de l'autre côté de la Moselle".
Quel bonheur de retrouver notre vieille cité, la table mise, le repas moisi ! Oser sortir sans craindre les obus.
Mais la guerre n'était pas finie. Les avions passaient toujours au-dessus de nous en direction de l'Allemagne qu'ils pilonnaient. Des villes entières, comme Dresde étaient anéanties. En hiver, ce fut la contre-offensive des Ardennes. Encore une hécatombe des deux côtés.
A Pompey, dès leur arrivée, les américains avaient organisé des cantines dans les préaux de l'école du centre. Elles servirent ensuite à la Croix Rouge pour préparer des repas aux sinistrés. Je m'étais portée volontaire avec d'autres jeunes pour ces repas. La préparation, la distribution et la vaisselle nous occupaient presque la journée. Là aussi, j'ai eu une petite aventure qui fera rire mes petits-enfants.
Les américains avaient laissé traîner bien des choses derrière eux. Un jour j'ai trouvé un objet en caoutchouc et j'ai soufflé dedans. Hilarité générale ! Il a fallu m'apprendre ce qu'était un préservatif. Quelle honte, je ne savais plus où me mettre. Cinquante ans ont passé. A l'heure actuelle, avec l'atroce menace du sida, même les enfants connaissent les préservatifs et même bien d'autres choses que j'ignorais encore à 18 ans. Il n'y avait pas la télévision.
 |
J'ai oublié de mentionner une autre activité. Depuis 2 ou 3 ans j'avais accepté de distribuer les hebdomadaires de la "bonne presse" tous les samedis : "Pèlerin", "Vie catholique", "Témoignage chrétien", "Croix de l'Est". Papa m'aidait et distribuait côté nord, Fond de la Vaux, Maroc. Je prenais du centre jusqu'à l'épicerie Ménolfi (actuel bureau de tabac rue du docteur Zivré). Quand l'"Eclair de l’Est" est reparu, un responsable de vente vint me pressentir pour le portage journalier. Accepté ! J'aimais marcher, mais c'était quand même dur, car après l'effondrement du pont, il fallait aller pour 7 heures prendre les journaux en haut de Frouard, près de chez Munch. Par tous les temps, il me fallait passer sur la petite passerelle des Vannes, côté Frouard. Pour y accéder, je traversais en barque avec un nommé Barbas, appelé "le poilu". |
C'était un excentrique qui vivait seul dans une baraque aménagée au milieu des champs, sous l'Avant-Garde. C'était un blagueur et certains jours de crue quand j'avais peur de l'eau sale et bouillonnante, il me disait qu'il savait nager et ne m'abandonnerait pas en cas de naufrage.
Au retour, Madame Douillot, mère de nos curés jumeaux, m'offrait un simili café pour me réchauffer. Un jour me voyant trempée, elle m'a demandé si j'avais perdu mon falzard ; après explication j'ai compris qu'elle voulait dire riflard (parapluie). Son argot n'était pas au point.
Les mois passaient. Journaux les matins, couture l'après-midi.
Le 22 octobre 1944, pour mes 19 ans, maman avait fait un gâteau. J'avais invité trois amies. L'une d'elles, Colette Godefroy, dont les parents étaient épiciers avait apporté un peu de sucre et du café. La fiesta ! C'était la première fois qu'on fêtait mon anniversaire. Alors, pour marquer ce jour, j'ai demandé à grand-mère de sortir son service en porcelaine, un joli service constitué patiemment grâce aux primes de Caïffa. Il était rangé dans l'armoire, à l'étage et n'avait jamais servi. Après quelques réticences, la grand-mère à dit oui. Toute contente, je suis montée le chercher, mais allez savoir pourquoi et comment, en redescendant, j'ai lâché trois tasses, peut-être quatre, je ne sais plus. La catastrophe !
Ce qui m'a le plus épaté, c'est qu'on ne m'a rien reproché. Peut-être un cadeau d'anniversaire ?
Autre cadeau : maman avait acheté avant la guerre un cretonne crème, un bon métrage pour faire une enveloppe d'édredon. Elle l'avait gardé précieusement et me l'a offert pour en faire une robe. Comme ce tissu était tout uni, j'ai brodé pendant cet hiver une cascade de petites fleurs multicolores sur le corsage et le bord des manches. C'était très joli.
Le soir de Noël j'avais fait ma petite crèche et je chantonnais "douce nuit", quand tout-à- coup, la porte s'est ouverte et deux noirs américains sont entrés, complètement ivres, ils avaient chacun une bouteille de cognac à la main et se sont mis à hurler "douce nuit" dans leur langue. Heureusement, un autre GI est entré, se doutant de ce qui se passait. Il les a expédiés promptement. Puis il est resté bavarder avec nous ; il parlait assez bien français. Il est revenu tous les soirs pendant cet hiver et nous apportait du café, des biscuits, du chocolat. Ah ! Ce grand Joe, qu'il était donc gentil. Il était heureux de se trouver un peu en famille. Mais un jour, il a dû partir plus loin pour une nouvelle offensive dont il n'est pas revenu. Il est sans doute sous une croix blanche, sur le sol français qu'il était venu délivrer.
Nous avons eu souvent des problèmes avec les noirs. Ils nous poursuivaient les soirs, après la chorale. Un soir, avec Marguerite nous avons dû courir à perdre haleine, poursuivies par deux noirs ivres. Arrivées chez nous, nous avons traversé la cuisine en courant et monté l'escalier comme une flèche. Marguerite qui avait un chignon, avait ses nattes dans le dos. Mes parents nous avaient vues passer, bouche bée, puis avaient compris en voyant les deux énergumènes derrière nous. Mon père les a mis dehors.
Cette aventure étant arrivée plusieurs fois, notre curé, mis au courant, a décidé que toutes les répétitions seraient générales, hommes et femmes, et non plus par pupitre. Elles duraient donc un peu plus longtemps, mais ces messieurs nous raccompagnaient galamment jusqu'à notre porte. Ouf ! Il était temps, car notre organiste, Colette, avait si peur qu'elle parlait d'abandonner, la dernière poursuite l'ayant laissée au bord de la syncope.
Cela aurait été dommage, car c'était un fameux numéro notre Colette. Elle avait un prix de conservatoire et chantait comme un rossignol tout en nous accompagnant au clavier. On l'appelait souvent mademoiselle swing. Elle l'était si bien qu'un jour, à la suite d'un pari, elle a joué la marche nuptiale, en rythme swing. J'ai cru que notre curé aurait une syncope, mais à la tribune, quel fou rire !
Une autre anecdote : Colette était très jolie et coquette. Un jour, à la messe, elle portait un joli chapeau à voilette. Notre chef de chœur battait la mesure avec sa baguette, devant l'harmonium. Soudain, la voilette fut happée au passage et le chapeau s'envola dans l'église.
Elle était trop jolie pour rester vieille fille et elle fut la première à se marier dès la libération. Elle nous fut enlevée par un beau capitaine venu en garnison à Pompey.
Au printemps, mon cousin Georges rentré du STO, m'offrit un jour une sortie cinéma à Nancy. Le pont n'était pas encore refait et il n'y avait qu'une passerelle provisoire. Il nous fallait donc prendre le tramway à Frouard, près de l'actuel hôtel de ville. |
 |
Comme il n'y avait plus de chauffeur, le GI a fini par s'en aller aussi, en tirant des coups de feu en l'air. Nous avons dû attendre encore un bon moment avant que le chauffeur revienne, mais nous n'avons pas revu les autres passagers.
Le 30 avril, Hitler se suicidait avec Eva Braun. Le 1er mai, c'était Goebbels et sa famille. Et le 8 mai, la capitulation de l'Allemagne. Enfin !
Il faut avoir vécu la guerre pour comprendre la joie qui nous habitait. Les cloches sonnaient à toute volée. On pleurait de joie et on s'embrassait dans les rues.
Il y eut un grand bal à la salle des fêtes pour fêter la libération. Là, pas de permission à demander, on s'y marchait sur les pieds. C'était mon premier bal (et le seul pour bien longtemps). Je ne savais pas danser mais je dansais quand même. "Ben barren polka", "J'attendrai”, et surtout "Tipperary" qu'on chantait à pleins poumons, n'importe comment avec les américains.
Nous avions préparé au patronage, pendant l'hiver, une pièce patriotique, l'Alsacienne, que nous avons présentée sur scène après la libération. J'y incarnais la France, Jeannette l'Alsace et Jacqueline la Lorraine. Pendant les intermèdes j'ai chanté "Si on pouvait arrêter les aiguilles" et une chanson humoristique sur les restrictions "Donne-moi quoiqu't'as, t'auras d'quoi qu'j'ai", pas très stylé mais amusant. La salle des fêtes était comble et nous avons eu un beau succès.
Après toutes ces années d'angoisse, on se sentait enfin revivre. L'hiver était passé. Le printemps et la paix revenus.
Alors, de semaine en semaine, puis de jour en jour, petit à petit, les prisonniers rentraient au pays.
*********
Pourquoi certains faits apparemment sans importance restent-ils fixés dans notre mémoire ? C'est tout de même bizarre que je me rappelle exactement à quoi j'étais occupée par ce bel après-midi de mai 1945, quand eut lieu cette conversation avec Madame Schlecht.
La porte fenêtre était ouverte sur le jardin tout fleuri. Une superbe bordure de muguet embaumait l’atmosphère. Il faisait bon travailler dans cette ambiance. Je garnissais de smocks une jolie robe bleue pour une fillette qui porterait bientôt le voile de la mariée dont la couturière terminait la robe.
Elle me dit soudain : |
 |
A la chorale, ce même soir, mon amie Marguerite me dit :
- Tiens, mon copain Riri est rentré.
- Quel Riri ?
- Henri Ancé, tu ne connais pas ? Ah, bien sûr, il est de mon âge, 28 ans, ce n'est pas ta génération.
- Alors, Marguerite, c'est un prétendant pour toi ?
- Ah non, pas du tout. Henri, c'est un bon copain, rien de plus, et surtout un copain de mon frère.
Ce frère, Jean, était rentré lui aussi quelques jours auparavant. J'avais été témoin de son retour alors que je déjeunais avec Marguerite et sa maman, et je m'étais retirée discrètement les laissant à leur larmes de bonheur.
Le dimanche suivant, au retour des vêpres, nous flânions avenue Gambetta, quand Marguerite s'écria soudain :
- Tiens, voilà Henri avec ses parents.
J'étais frappée par la mauvaise mine de ce jeune homme, mais encore plus par son père qui marchait péniblement, appuyé au bras de sa femme. Marguerite est allée les saluer. J'étais restée à l'écart, ne voulant pas les gêner. Et puis j'ai oublié cette rencontre.
Mais une semaine plus tard, il y eut un nouveau venu à la chorale. C'était Henri.
Pendant les répétitions, il regardait souvent dans notre direction et je taquinais Marguerite. II était peu bavard, mais peu à peu, il s'enhardit et nous raccompagna aux retours de chorale.
Marguerite me disait :
- Ça m'ennuie beaucoup ; ce pauvre Henri, je ne voudrais pas le peiner, mais il se fait des illusions.
Et moi de répondre :
- Pourtant, il est bien ce garçon. Et il tient à toi, puisqu'il nous suit partout. Réfléchis, il a ton âge, il est beau, gentil. Si tu es si difficile, tu resteras vieille fille (ce fut d'ailleurs son destin, mais c'était aussi une vocation. Plus tard, elle voua sa vie au service d'un prêtre).
En 1945, on ne trouvait pas de pellicules dans le commerce, et je me plaignais parfois de ne pouvoir me servir de l'appareil photo laissé par mon frère.
Henri, m'ayant entendue est allé à Nancy chez des cousins photographes (le studio Pallier) qui lui ont donné une pellicule.
Puis, il a attendu Marguerite à la sortie de l'usine où elle était dactylo, et lui a demandé où j'habitais pour m'apporter la pellicule.
J'étais tellement stupéfaite et ravie que je lui ai sauté au cou pour l'embrasser, et comme il tournait justement la tête, mon baiser lui est tombé au bout du nez, ce qui nous a bien fait rire. C'est dans cette ambiance détendue que je l'ai présenté à mes parents.
Le lendemain, Marguerite s'est plainte à moi :
- Tu comprends, il a imaginé ce stratagème pour venir m'attendre à la sortie des bureaux. Ça ne peut plus durer !
Depuis la fin de la guerre, des troupes de théâtre commençaient à venir présenter des pièces et nous y allions en équipe.
La première eut lieu à la salle des fêtes. Marguerite avait tenu à ce que je sois placée entre elle et Henri. Je n'en étais pas contrariée mais je trouvais cela stupide.
Une voisine des cités était derrière nous. Elle me dit le lendemain :
Dis donc, ton voisin, hier soir, il n’a pas dû voir grand-chose de la pièce.
Et comme je la regardais, étonnée, elle me dit en riant :
Il ne t'a pas quitté des yeux. A mon avis, tu as un amoureux !
J'étais très ennuyée, convaincue qu'il essayait de voir Marguerite et que je le gênais !
Mais quelques jours plus tard, alors que je portais mes journaux, tout simplement, ma vie a basculé.
En arrivant devant l'hôpital, je vis de loin Henri qui fendait du bois en face du café. Et c'est là. tout bêtement, que le petit Dieu Éros (ou la Providence ?) a fait son travail. Le coup de foudre ! Un vrai coup au cœur, les jambes molles, j'avançais comme une automate. Quand je suis arrivée près de lui, il a levé la tête. Il avait les cheveux plein de sciure, un tablier bleu de cafetier lui ceignait la taille ; vraiment, rien de poétique, et pourtant je n'ai rien oublié.
N'oubliez pas qu'il y a cinquante ans, on se donnait encore du monsieur et mademoiselle, tant qu'on était pas très liés. Et ça donnait ceci :
Bonjour, Mlle Marthe.
Bonjour, Monsieur Henri.
Savez-vous qu'il y a une pièce de théâtre à Frouard après-demain "Les Oberlé". C'est très beau, j'ai lu ce livre quand j'étais prisonnier. Vous irez ?
Oui, bien sûr. On ne va pas manquer ça.
Alors à bientôt ?
Oui à bientôt.
C’est tout, et tout avait changé.
Je ne m'attendais vraiment pas à ce qui m'arrivait. Je me suis même arrangée pour passer une deuxième fois devant chez lui, alors que ce n'était pas mon chemin pour le retour, mais il n'était plus là.
Il m’a avoué plus tard que, connaissant mon itinéraire, le tas de bois était un bon prétexte pour me guetter.
Naturellement, à la soirée théâtre, Henri était près de moi. Il avait pris un programme pour nous deux et sur ce programme, il a écrit : Je vous aime.
Sur le chemin du retour, il m'a retenue un peu derrière les autres pour me demander si j'acceptais de sortir avec lui. Alors, pensant aux fréquentes mises en garde de mes parents, je lui ai répondu :
- Je veux bien, mais il faut d'abord que vous veniez voir mon père.
Ce qu'il fit bravement le lendemain.
Mes parents étaient un peu réticents, le connaissant à peine et le trouvant trop âgé pour moi. Mais surtout, c'était dur à avaler pour eux ; j'étais encore leur gamine et ils envisageaient mal une séparation.
Pour ma grand-mère, c'était pire. Elle ne cachait pas ses craintes. Pour elle, Henri était un homme qui cherchait à s'amuser après sa captivité et me laisserait tomber au bout de quelques mois. Elle s'en est méfiée jusqu'à mon mariage, me répétant souvent que j'étais mineure et qu'il existait des lois pour me protéger.
Moi, je riais de leur crainte. J'avais confiance. Je savais, j'étais sûre que c'était pour la vie et l'avenir m'a donné raison.
Ce fut pour nous un été magnifique. Que de belles promenades nous avons faites dans les bois, au bord du canal ou de la Moselle. Henri le taciturne devenait bavard avec moi. J'étais stupéfaite devant ses connaissances. Il avait beaucoup lu et étudié pendant ses cinq ans de captivité et il avait une mémoire prodigieuse. Il me parlait de ses auteurs préférés, Saint-Exupéry, Albert Camus, Steinbeck, Gilbert Cesbron.
Il aimait beaucoup Edmond Rostand et m'avait offert "l'Aiglon". Justement cette pièce fut jouée à Nancy en septembre et j'eus la grande joie d'aller au théâtre municipal pour la première fois. C'était si beau que j'en ai pleuré. J'ai revu cette pièce cette année au théâtre du Peuple, à Bussang, avec autant d'émotion. A presque cinquante ans d'écart, de revivais ces souvenirs.
Et puis, surtout, sous son air bourru qui faisait un peu peur à tous, sauf à moi, c'était un tendre. Il avait une telle façon de me regarder que je me sentais plus belle et meilleure que je n'étais. Il me berçait des promesses que font tous les amoureux du monde et je ne demandais qu'à y croire.
Parfois quand on s'asseyait à l'ombre, au bord d'un bois ou près de la Moselle, il me chantait des chansons que je ne peux plus entendre sans pleurer "Ferme tes yeux ma mie" et la fameuse chanson des prisonniers " Attends-moi mon amour".
Il me disait que sur son bat-flanc de PG, il rêvait déjà de moi sans me connaître, qu'il me voulait blonde et gaie et n'avait pas été déçu.
Pendant 5 ans, il s'était promis qu'en rentrant il se marierait, aurait un fils, bâtirait sa maison et planterait un arbre.
Et moi, un peu abasourdie, je lui avouais n'avoir pas eu le temps de rêver, je voulais même attendre de coiffer Sainte Catherine avant de me marier. Mais voilà, le cœur a ses raisons que la raison ignore ! Et j'ai écouté mon cœur, sans regret.
Deux mois après son retour, il avait pris son travail à l'usine, mais on se voyait quand même tous les jours. Je traînais un peu en portant mes journaux et je me trouvais toujours sur l’avenue Gambetta sur le coup de Midi. Il arrivait en vélo, s'arrêtait une minute, le temps d'un bisou et me glissait une petite lettre avant de repartir. Ah ! Ces billets doux ! Si j'avais gardé tous ceux qu'il m' a écrit dans sa vie, j'en aurais un bon paquet. Combien de fois, plus tard, j'ai trouvé à mon réveil un petit mot griffonné sur la table de nuit quand il partait de bonne heure.
Pendant tout cet été, il est venu chez nous tous les soirs, et toujours avec quelques fleurs. On s'asseyait devant la porte et on bavardait. J'étais toujours bien surveillée. J'avais le droit de le reconduire jusqu'à la gare, pas plus loin.
- La confiance règne, disait Henri en souriant.
Il m'a dit souvent, que s'il avait voulu s'accorder quelques privautés, il en aurait trouvé le moyen, mais il m'aimait trop pour me choquer.
N'ayant connu jusque-là que le patronage et les bonnes sœurs et le quasi enfermement de la guerre, j'étais restée vraiment trop naïve et cela a donné lieu à quelques anecdotes un peu poivrées dont nous avons bien ri plus tard.
Par exemple, un jour, j'ai fredonné la fameuse chanson de George Milton "C'est pour mon papa", dont un refrain se termine par " et mon père a aussi des sacs en peau de zébi”. Henri me dit en riant :
- Il ne faut pas chanter ça, c'est vulgaire.
- Ah, pourquoi, qu'est-ce que c'est du zébi ?
Un peu gêné, il me répondit :
- Vous demanderez à votre mère.
Or ce jour-là c'était la fête à Frouard. Nous étions invité pour le café chez ma tante. Mes parents nous y avait précédé. En arrivant, j'ai demandé à maman :
- Dis maman, qu'est-ce que c'est un sac en peau de zébi ?
Tout le monde a éclaté de rire et maman m'a répondu :
- Tu demanderas à Henri quand vous serez mariés. J'ai seulement réalisé ce que ça pouvait être. La gaffe !!! J'aurai voulu me fourrer dans un trou de souris.
Un autre jour, Henri, sans doute d'humeur un peu égrillarde (ou peut-être voulait-il "m'instruire" un peu ?) fredonna une chanson humoristique intitulée "Tu n'as pas compris".
Un couplet disait ceci :
Pendant un Fox-Trott d'une ardeur maligne
Qui mêlait nos corps, nos jambes et nos bras
Je pensais heureux, il est certains signes
Qu'elle doit sentir et qu'elle comprendra
Mais qu'avais-tu donc dans ta petite caboche
Tu m’a murmuré, j'en fus ahuri
Pourquoi mettez-vous vos clefs dans cette poche
Tu n 'as pas compris
Et moi j'ai dit :
- Quelles clefs ?
A quoi il m'a répondu en chantant :
Tu n'as pas compris.
Vers la fin de juillet, il m'emmena à Nancy et m'offrit une jolie robe bleue. C'était pour moi une surprise inattendue et surtout inespérée. Mais je n'étais pas au bout de mes surprises car au retour, il voulut me présenter à ses parents.
Je me rappelle des moindres détails de cette soirée. J'étais, bien sûr, très intimidée, et même un peu inquiète. Car, alors que nous approchions du café, j'avais vu Madame Ancé qui bavardait sur le seuil avec une voisine. Celle-ci, nous ayant vu, lui a chuchoté quelque chose à l'oreille en nous montrant du doigt. Alors, au lieu de s'avancer vers nous comme je m'y attendais, elle a tourné des talons et rentré à l'intérieur. J'ai eu le pressentiment que je n'étais pas la bienvenue.
Le père d'Henri, Charles, était assis devant la table de la cuisine, la tête dans ses mains. Le pauvre homme ne pouvait presque plus parler mais il s'est efforcé d'être aimable. Sa femme au contraire, évitait mon regard et restait muette. Moi, j'étais paralysée. Heureusement qu'Henri était là pour tenir la conversation, mais j'avais hâte de partir.
Ce fut encore pire le lendemain ; alors que je croisais dans la rue Madame Ancé qui reconduisait chez elle sa vieille maman, je m'avançais pour les saluer, elle a tourné la tête comme si elle ne me connaissait pas. J'avais le cœur gros, ne me sentant pas acceptée et me demandant pourquoi.
Je n’osais pas en parler à maman pour ne pas l'inquiéter.
Le lendemain, j'ai raconté à ma tante Jeanne ce qui me contrariait.
- Ne te fais pas de souci, me dit-elle, je connais bien Marie. Elle passe souvent me voir en allant aux bains. Je lui parlerai et je saurai ce qu'il en est.
Quelques jours plus tard, j'eus la clef du mystère.
- Voilà me dit ma tante, ce n'est pas bien grave. Marie sait comment est mort ton frère. Elle a peur que tu sois malade comme lui. C'est tout !
- Ce n'est que cela ? Et bien, je vais la tranquilliser.
Et le jour même, je suis allée voir mon cher docteur Zivré.
- Tiens me dit-il, que deviens-tu, Bernanos ? Tu vas au moins rentrer au couvent ?
- Pas du tout docteur, je vais bientôt me marier.
- Tant mieux, j'avais peur que tu te laisses embobiner par les gâgattes. Ta mère n'aurait pas besoin de cela mais de quelques petits enfants. Et qu'est-ce qui ne va pas ?
- Et bien docteur, mon fiancé, c'est Henri Ancé, et sa mère craint que je sois malade comme mon frère. Aussi, je voudrais que vous me fassiez un certificat pour la rassurer.
- Un certificat ? J'en donnerai un de vive voix à Charles qui vient me voir chaque semaine. Sois tranquille, il sera rassuré.
- Merci docteur, qu'est-ce que je vous dois ?
- Tu me dois le respect. Et à bientôt pour le mariage.
En sortant de chez le docteur, le cœur battant, je suis allée tout droit au café.
A cette heure de l'après-midi, il n’y avait pas de clients. La grand-mère Cornibé raccommodait des chaussettes devant une des tables. Dans la cuisine, le père était assis à la même place que le premier jour, la tête dans ses mains et sa femme terminait sa vaisselle.
Après les avoir salués, je leur ai dit que je sortais de chez le docteur et ce qu'il m'avait dit. Monsieur Ancé s'est dressé, blanc de colère, en regardant sa femme qui s'est mise à pleurnicher en lui disant :
- Tu comprends, Charles, on n'a qu'un fils, alors j'avais peur pour lui et pour son avenir.
Son mari lui a montré la porte en articulant :
- Vas., lui., cueillir., des., roses..
Les mots sortaient difficilement de sa gorge. J'étais désolée, comprenant trop tard qu’il ignorait la conduite de sa femme et ne partageait pas ses craintes. Elle est revenue du jardin avec un bouquet de roses et je suis partie un peu soulagée.
Ce même soir, quand Henri est arrivé avec son petit bouquet cueilli en cachette, il a vu les roses sur la table et m’a dit stupéfait :
- Mais ce sont des roses de mon père ?
Oui. je suis passée chez vous.
Il avait les larmes aux yeux en me disant :
- Eh bien, il faut que vous lui plaisiez bougrement, car il n'en donne que rarement.
J’ai eu ces mêmes roses plus tard dans mon jardin, je les aimais aussi, et même doublement pour le souvenir qu’elles me rappelaient. Je les regrette beaucoup.
Quelques semaines plus tard, en août, monsieur Ancé a voulu aller une fois encore dans son jardin du Montsaugeon, sur la route de Liverdun. Il y avait construit une petite cabane en bois où il rangeait les outils de jardinage, là, une chaise longue lui permettait de se reposer à l’ombre.
Nous avons ramassé des mirabelles, Henri et moi. C’était la première fois que je pouvais cueillir et déguster directement ces fruits sur l’arbre avec un savoureux plaisir.
Comme nous redescendions près de la cabane avec nos paniers bien garnis, nous avons entendu Madame Ancé dire à son mari :
- Mais, Charles, elle n'a rien, rien du tout !
Et lui, a répondu de sa voix rauque :
- Et toi, qu'est-ce que tu avais ?
Une fois encore, j’étais mortifiée. Mais Henri m’a pris par le cou en mettant un doigt sur mes lèvres, et en faisant non de la tête comme pour dire "ça n’a pas d’importance".
Dans la soirée, il m’a consolée en me disant que le café et quelques terrains aux alentours, ce n’était pas le Pérou et que pour lui, je valais tous les biens du monde.
Je ne demandais qu'à le croire, mais tout au fond de moi, l'inquiétude commençait à creuser son petit sillon.
Le 20 octobre, eut lieu le mariage d'Antoinette, la cousine Germaine d'Henri avec André Benoît.
Mariage pas très gai malheureusement, Antoinette étant la sœur de Roland Georges, fusillé deux ans auparavant. Toute la famille était très marquée par cette tragédie. Sa femme était là avec ses trois jeunes enfants. Et puis, la santé de Monsieur Ancé se dégradant de jour en jour, il ne quittait presque plus son lit et son épouse restait avec lui. Le surlendemain, 22 octobre, le jour de mes vingt ans fut celui de mes fiançailles.
Nous sommes allés tous deux à la messe de sept heures où le prêtre a béni ma bague, une petite bague sans valeur, mais à mes yeux, c'était le symbole du bonheur. Ensuite, nous avions rendez-vous pour fixer ce bonheur chez les cousins photographes, puis nous sommes rentrés déguster le repas que maman nous avait mijoté avec bien du mérite, car le rationnement continuait.
J'ai eu le plaisir de recevoir une gerbe blanche envoyée par Madame Schlecht et d'autres fleurs offertes par des voisins.
L'ombre au tableau c'était toujours la maladie du père d’Henri. Dès l’automne, celui-ci ne venait plus les soirs. Il restait près de son père. Puis il m’a demandé si j’acceptais de venir leur tenir compagnie. Je prenais un ouvrage de broderie pour occuper mes mains. Henri lisait le journal à son père.
C'est alors que j’ai un peu mieux connu la grand-mère paternelle d’Henri, Louise Ancé née Paillier, qui vivait dans une grande pièce au-dessus du café. C’était une grande femme sèche, qui ne sortait jamais, ne souriait jamais.
Elle m’intimidait beaucoup. Je la craignais même, car la maman d’Henri m’en avait dit beaucoup de mal. Mais j’ai compris ensuite que la pauvre femme avait beaucoup souffert du comportement de sa belle-fille. Celle-ci lui avait fait une réputation de méchanceté et avait même réussi à la brouiller avec son fils.
J’en avais eu l’intuition en voyant ce pauvre homme, sur la fin de sa vie, repousser sa femme pour accueillir sa mère. Elle venait chaque soir près du lit de son fils. Ils se regardaient tous deux tristement, lui ne pouvant plus parler, elle, se murant volontairement dans le silence.
La grand-mère Louise, veuve depuis 1911, avait perdu un fils de 24 ans, Henri Alexandre, à la guerre de 1914, puis une fille de 25 ans, Marguerite, en 1931.
Après la mort de son mari et de son fils, elle avait acheté et tenu seule le café de l’Espérance jusqu’en 1931. Suite au décès de sa fille, elle en fit donation à son fils Charles, qui résidait alors sur la route de Liverdun, en location chez la famille Juif (ces précisions sont pour mes enfants qui peuvent ainsi situer les lieux d’enfance de leur père). C'est là qu'ils avaient perdu une fille de 16 mois, Marie-Thérèse, alors qu'Henri avait une douzaine d'années. II se rappelait bien l'avoir gardée souvent, pendant que sa mère rabattait des pantalons pour l'atelier Jullien, où elle travaillait déjà avant son mariage.
Elle cessa cette activité en 1931, quand ils vinrent s'installer rue Haute pour gérer le café. En fait, c'était elle qui s'en occupait, son mari travaillant toujours à l'usine en qualité de mouleur.
J'apprenais d'Henri tous ces détails pendant ce triste hiver de 1945 durant lequel nous aurions dû être si heureux.
Mais notre bonheur était gâché par une issue qu'on savait prochaine. Ce fut le 5 janvier 1946 que monsieur Ancé s'éteignit après tant de souffrance. Je partageais la peine d'Henri revenu depuis si peu de temps pour voir mourir un père qu'il aimait par-dessus tout.
Il voulut ensuite que notre mariage fut fixé le plus tôt possible.
L'Église ne célébrant aucun mariage pendant le carême, il fallait choisir une date avant ce carême ou après Pâques. Pour Henri, après Pâques, c'était trop loin. La date retenue fut donc le 2 mars, dernier samedi avant le carême.
Il me parla alors de son ami Maurice Lallement, son frère d'armes et de captivité, à qui il voulait demander d'être son témoin. Ils avaient été faits prisonniers sur la ligne Maginot. Maurice était orphelin. Avant la guerre, il vivait assez pauvrement avec sa sœur, à Granges sur Vologne. Il avait travaillé très tôt aux tissages et n'avait pas passé son certificat d'études. Alors Henri l'a fait travailler pendant leur captivité. Il a si bien rempli sa tâche qu'après la guerre, Maurice a passé son certificat d'études et un peu plus tard, un CAP d'ajusteur.
A la lettre d'Henri, il répondit que lui aussi allait se marier au mois d'avril et qu'il viendrait donc à notre mariage avec sa fiancée.
Un gros nuage se pointait à l'horizon auquel nous n'avons pas prêté grande importance à ce moment.
Avec la fin de la guerre et le retour des prisonniers, il y avait pénurie de logement.
La mère d'Henri souhaitait qu'on reste avec elle et nous ne voulions pas ajouter à sa peine en la laissant seule si rapidement.
De toute façon, nous n'avions pas le choix. Mais leur logement était très petit. En dehors de la cuisine, dont je parlerai plus tard, il n'y avait à l'étage que deux chambres, celle d'Henri, toute petite et borgne, ouvrant sur celle de ses parents. La plus grande pièce, indépendante, au-dessus du café était occupée par la grand-mère Louise.
Nous avons été dépannés par une cousine d'Henri, Valentine Simon, née Paillier. Elle était directrice d'école maternelle à Nancy-Bonsecourt.
Valentine, veuve très tôt à la guerre de 1914, avait élevé seule sa fille Hélène (dite Lelette) qui avait l'âge d'Henri.
Celle-ci s'était mariée à un poète farfelu, André Vernier connu à Nancy sous le sobriquet d'Albinos à cause de ses yeux d'un bleu délavé. D'après Valentine, c'était un détraqué sexuel qui poursuivait partout sa femme, jusque dans sa classe (elle était institutrice dans la même école que sa mère).
Ce mariage a duré juste le temps de lui faire quatre filles en quatre ans avant de divorcer (Françoise, Dominique, Anne-Lise, et Marie-Claude).
La cousine Valentine avait une maison, voisine du café, dont elle louait le rez-de-chaussée à une vieille dame. Elle nous offrit d'habiter la chambre au premier étage.
Elle y avait un lit et une table. Maman me donnait un buffet et quelques chaises. Pas d'eau, aucune commodité. Il nous faudrait vivre au 31 le jour, et dormir au 29 la nuit.
On espérait que ça ne durerait pas longtemps. Quel optimisme !
Un autre problème, les vêtements.
Toujours tributaire des points textiles, il me fallait choisir entre la robe blanche (dont je rêvais) et le tailleur dont j'avais grand besoin.
Ce fut madame Schlecht qui me tira d'embarras. L'une de ses amies gérait une teinturerie à Nancy. Elle m'offrit de me louer une robe dont je n'aurais à payer qu’une caution et le nettoyage. C'est ainsi qu'une belle robe de satin blanc réalisa mon rêve.
Une voisine à qui j'avais rendu quelques services en couture et raccommodage, me donna son voile de mariée.
Avec mes points textiles, j'ai donc pu acheter du tissu noir, puisque nous étions en deuil, et je me suis fait faire un tailleur.
J'avais une pièce de soie de parachute dans laquelle j’ai confectionné un chemisier, ajouré de plus de 200 petits pavés, très à la mode d'après-guerre.
Quand à Henri, il avait fait remettre à sa taille un costume noir de son père. Nous étions parés pour la cérémonie.
 |
Le temps était gris et maussade ce 2 mars. Il y eut même quelques flocons de neige dans la matinée. Heureusement, des amis avaient offert gentiment de nous véhiculer. |
Henri avait voulu, outre ses témoins Maurice et Yvonne, la présence des trois petits de Roland Georges qu'il regrettait tant.
On voit aussi sur la photo de famille ma grand-mère Marie Bernanos et son fils Jean, le jeune frère de papa ; Maurice Cadé, cousin germain d'Henri. C'est dommage qu'on n'y voit pas les autres grands-mères. Celle d'Henri, grand-mère Louise, ne voulait pas se laisser photographier. Elle a même déchiré la photo prise à table pour ne laisser aucun souvenir d'elle.
La grand-mère Cornibé était malade, chez la tante Augustine Cadé, sœur de ma belle- mère.
Quand à mémère Byelle, elle était sans doute occupée à la cuisine pour aider Madame Simon, une voisine fine cuisinière qui avait préparé le repas.
Nous étions donc une quinzaine, un peu serrés dans notre cuisine.
Ma belle-mère n'avait pas voulu que le repas se fasse au café à cause du deuil récent, mais un mois plus tard elle a loué la salle pour un autre mariage. Je lui en voulais, car j'avais entendu cette réflexion faite à Valentine :
- Tu comprends, si on fait la noce ici, c'est moi qui vais tout payer. Pas si bête !
Alors que maman avait tout acheté peu à peu au marché noir et s'était occupée de toute la préparation, ne laissant à ma belle-mère que l’achat des vins et des gâteaux.
Je n’avais rien dit pour ne pas peiner Henri. Je sentais bien que ma belle-mère ne m’aimait pas, mais j’espérais encore gagner son affection par ma gentillesse. Pauvre de moi ! Je ne me doutais pas de combien de larmes elle me ferait payer pendant des années l'amour qu'Henri me portait.
Ce 2 mars 46 ne fut donc pas une journée de liesse. Peu nous importait. Pour nous, seule comptait la joie d'être ensemble pour la vie. Tout le reste nous était indifférent.
Le dimanche, après la messe, nous avions invité les membres de la chorale pour le pot d'amitié à la salle paroissiale. Les cadeaux traditionnels nous attendaient : crucifix et statue en bronze du Christ. Mais pour nous ce qui importait, c'était la sincère amitié qui nous entourait. Cette chorale des années 1940 à 50 a toujours laissé en moi une pointe de nostalgie. Je n'ai jamais retrouvé dans d’autres chorales une telle camaraderie, peut-être due aux années difficiles que nous avions traversées ensemble. Après tant d’années, quand on se rencontre entre anciens choristes, ce sont des "te souviens-tu" à n’en plus finir.
Et voilà ma vie de jeune fille terminée, une page tournée. Que nous réservait l’avenir ? C’est juste à ce moment qu’Odette Laure chantait
Adieu la fleur de ma jeunesse
Adieu aimable liberté
Adieu aimable liberté de fille
C'est aujourd'hui qu'il me faut la quitter.
Février 1995.
Je viens de relire ces pages commencées il y a 13 ans, interrompues par des blocages de 2 ou 3 années, pendant lesquelles je n'avais plus envie d’écrire, où peur de me souvenir ? C’est vrai que j'ai souvent pleuré en les écrivant. C'est dur de se replonger dans les années passées et j'ai souvent fait des cauchemars. Je ne sais pas si je pourrais raconter la suite de mon histoire parce que s'il est facile de remonter le fil du temps par les souvenirs gais, les plus belles heures passées, c'est très douloureux d'extirper les autres si bien enfouies au fond du cœur qu'on les croyait oubliées.
Mais si je vais plus loin, il me faut dire autre chose. Tant pis si je deviens grand-mère "la morale", mais je n'ai pas peur des grands mots.
Tout cela est aussi difficile à écrire pour moi (sachant que je serai lue parfois avec scepticisme, si ce n'est avec ironie) aussi gênant que de me déshabiller en public, mais j'ai tout dit sans fausse pudeur.
Je n’ai plus qu’à dire AMEN.
